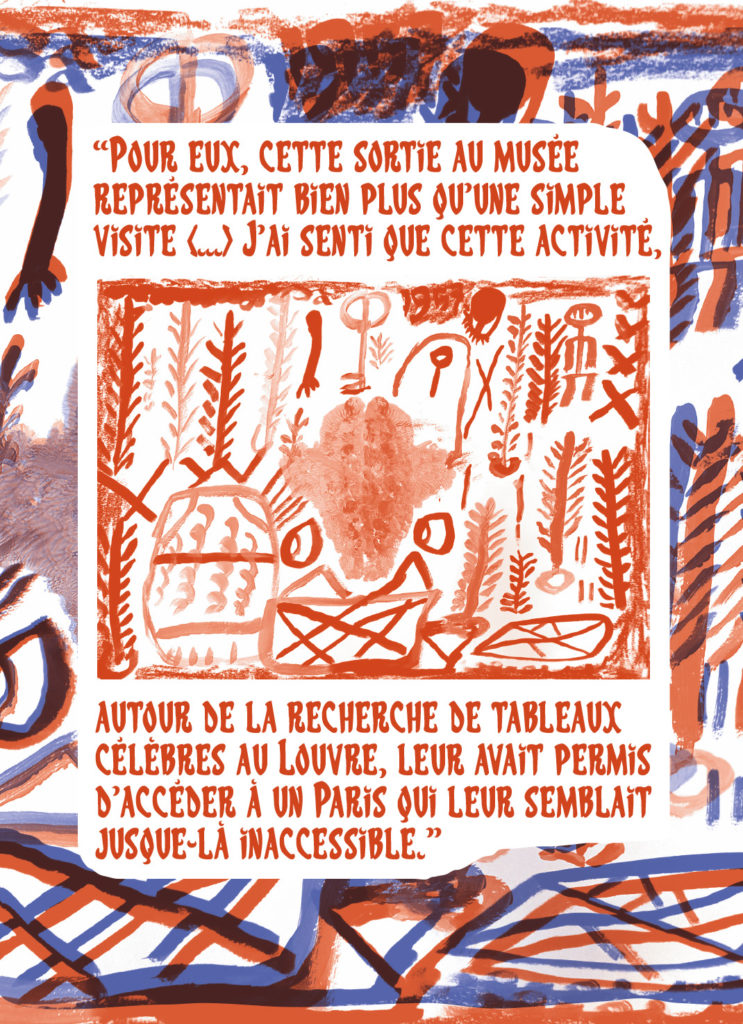Ayant de l’appétence pour les arts visuels, je propose des activités artistiques dès que je sens que mes apprenants sont réceptifs et en demande. À la base, j’ai une formation de médiatrice culturelle. La transmission de messages à travers l’art m’a toujours attirée. J’ai ensuite effectué une reconversion professionnelle pour devenir enseignante en FLE et en alphabétisation auprès de publics adultes.
Mon premier poste d’enseignante FLE était à Bordeaux. C’est ensuite, au Sénégal, à l’Institut français de Dakar, que j’ai utilisé pour la première fois l’art comme support pédagogique, pour un public adulte francophone. Dès que j’en avais l’occasion, j’utilisais différents types d’art en cours. L’Institut possédant une galerie d’exposition (la Galerie Le Manège), je didactisais les expositions d’artistes pour les rendre accessibles aux apprenants tout en construisant une séquence de cours autour de celles-ci.
Il m’est même arrivé de bâtir une séquence sur plusieurs semaines à partir des œuvres d’un apprenant artiste : différentes notions de grammaire et de vocabulaire étaient travaillées à travers ses productions. Une autre fois, l’activité a pris une dimension collective : tous les apprenants ont contribué à réaliser l’exposition de ce même artiste. La finalité de cette séquence était d’organiser le montage de l’exposition et d’inviter d’autres classes au vernissage.
Aujourd’hui, je travaille avec des adultes allophones, souvent non scolarisés dans leur pays d’origine. Cette approche mêlant sensibilisation à l’art et apprentissage linguistique se poursuit avec eux. En présentant une œuvre d’art, les apprenants développent leurs compétences orales et écrites tout en s’ouvrant à un nouveau champ culturel. L’expérience se révèle particulièrement enrichissante, notamment pour celles et ceux qui n’ont jamais visité de musée. Elle leur permet de découvrir qu’une œuvre possède sa propre identité et une histoire, tout comme eux.
Toutes ces initiatives sont à mon initiative, en fonction de mes intuitions et des besoins du groupe. J’ai eu la chance de toujours avoir des apprenants réceptifs et heureux de cette manière d’aborder l’apprentissage du français.
Diversité des apprenants avec un même but
L’objectif est d’établir un parallèle entre l’identité d’une œuvre (nom, origine, date) et leur propre identité (nom, nationalité, âge, profession). Cette activité les sensibilise également à la richesse culturelle et à l’importance des musées en France. Ils découvrent aussi des œuvres qu’ils connaissent visuellement — comme La Joconde ou Le déjeuner sur l’herbe — sans en connaitre l’histoire
ou le sens.
J’ai mis en place cette activité avec des demandeurs d’asile, principalement des hommes, originaires notamment de Turquie, du Soudan et d’Afghanistan.
Afin de donner une dimension pédagogique à la visite du musée et de favoriser une attitude active une fois là-bas, j’ai conçu l’activité en ce sens, avec des questions menant les apprenants à se référer à des œuvres très connues. Le fait de sélectionner des tableaux célèbres à l’échelle internationale permettait à chacun de participer, même sans notion en histoire de l’art. Les tableaux sur lesquels ils travaillaient leur étaient familier. C’est pour cette raison que j’avais notamment choisi :
- La Joconde de Leonard de Vinci
- La Liberté guidant le peuple de Delacroix
- Le radeau de la Méduse de Géricault
- La dentellière de Vermeer
Plusieurs cours d’apprentissage de la lecture et de l’écriture ont été dispensés sur trois mois. En parallèle, les apprenants ont visionné une vidéo présentant un musée dans lequel apparaissaient plusieurs œuvres, dans l’idée d’expliquer le lieu et sa fonction… Cependant, avant cela, je leur avais d’abord demandé ce qu’ils voyaient et, selon eux, à quoi servait cet endroit : quel était son but ? quel était son nom ? Je commence toujours par poser des questions avant de nommer un objet, un lieu. C’est pour ne pas partir du postulat qu’ils n’ont aucune connaissance sur la thématique abordée, et que je serais la seule à pouvoir leur donner l’information. Cette démarche vise à éviter toute attitude paternaliste et à ne pas faire naitre un sentiment d’infériorité chez les apprenants. Il arrive d’ailleurs qu’ils aient ou trouvent eux-mêmes les réponses à mes questions.
Progressivement je les amène á comprendre les informations nécessaires pour identifier et renseigner une œuvre :
- Le titre de l’œuvre
- La date de création
- La dimension
- Le nom de l’artiste
- Le matériau avec laquelle elle a été conçu
Durant trois séquences de cours, les apprenants ont travaillé sur des exercices à trous consistant à renseigner les informations relatives à une œuvre. Pour cela, ils ont réalisé des exercices d’identification visuelle portant sur la date, la dimension d’une œuvre, et également la hiérarchie des informations à propos d’une œuvre. Le parallèle a été fait avec l’identité d’un individu où les informations principales sont le prénom et le nom. Ces exercices étaient un avant-goût de ce qu’ils allaient devoir faire durant la visite au Louvre. C’était un entrainement afin qu’ils ne se sentent pas en situation d’échec et, à éliminer les éventuels éléments parasites pour qu’ils comprennent bien la consigne.
Visite et sentiment des apprenants au musée
Comme évoqué précédemment, les apprenants étaient ravis de visiter le musée du Louvre. D’ailleurs, avant même d’entrer ils prenaient déjà des selfies et des photos de groupe. Selon moi, cet engouement a rendu assez facile l’acquisition des notions apprises en cours. Cette joie a, facilité l’acquisition des notions abordées, d’autant plus qu’il s’agissait de demandeurs d’asile, désireux d’accéder à des connaissances susceptibles de favoriser leur intégration à travers la culture française.
Le fait de pouvoir nommer des œuvres célèbres témoignait à la fois de leur motivation et des efforts fournis. Cela pouvait également jouer en leur faveur lors de leur entretien à l’OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides).
J’avais confectionné un livret avec des photos de tableaux de plusieurs artistes, remis une fois sur place. Il se composait des huit œuvres mentionnées ultérieurement. Pour chacune d’elles, les apprenants devaient renseigner soit la dimension, soit le titre, soit le nom de l’artiste. Parfois, ils devaient compléter l’ensemble des informations demandées.
Le musée du Louvre étant immense, et afin de ne pas rendre la recherche des œuvres trop difficile, j’ai veillé à sélectionner des tableaux situés dans une même zone pour limiter les déplacements. Cela permettait d’éviter toute surcharge ou découragement des apprenants. Ils avaient un plan du musée avec eux et travaillaient en binôme. Je m’assurais que chaque groupe parvenait à trouver chacune des œuvres à son rythme.
Le plus difficile, a posteriori, n’était pas tant pour les apprenants de récolter les informations demandées, mais plutôt de réussir à se faufiler jusqu’aux œuvres, comme La Joconde, à cause de la foule. Le fait de ne pas pouvoir approcher certaines œuvres ou de se retrouver dans un espace très fréquenté aurait pu poser problème : certains apprenants auraient pu se sentir submergés par le monde, décrocher et préférer s’asseoir en attendant la fin de la visite.
Dans un esprit de valorisation de soi et de leurs origines, j’ai veillé, lorsque cela était possible, à sélectionner des œuvres en lien avec les pays d’origine des apprenants. Dans ce cas, il s’agissait du tableau de Jean-Auguste Ingres Le Bain turc. L’apprenant turc était tellement fier de voir une œuvre d’art faisant écho à sa culture qu’il s’est pris en photo à côté.
Apprendre autrement, ressentir pleinement
Le témoignage des apprenants à la suite de cette activité a été très positif. Pour eux, cette sortie au musée représentait bien plus qu’une simple visite : ils n’en ont dit que du bien. Il y avait de la fierté d’avoir réussi l’exercice, de comprendre enfin à quoi sert un musée et d’en maîtriser les codes de visite. J’avais pourtant perçu de la fatigue chez certains, notamment à cause de la difficulté à repérer les œuvres dans la foule, mais malgré cela, l’expression qui se lisait sur leurs visages était celle de la joie.
Ils ont également apprécié le fait d’avoir appris de nouvelles notions de la langue française dans ce contexte inhabituel. Pour beaucoup, c’était comme franchir un obstacle supplémentaire, en plus de celui de la langue. J’ai senti que cette activité, autour de la recherche de tableaux célèbres au Louvre, leur avait permis d’accéder à un Paris qui leur semblait jusque-là inaccessible. L’expression de bonheur sur leurs visages et les photos prises ensemble témoignent du plaisir qu’ils ont eu à participer à cette expérience.