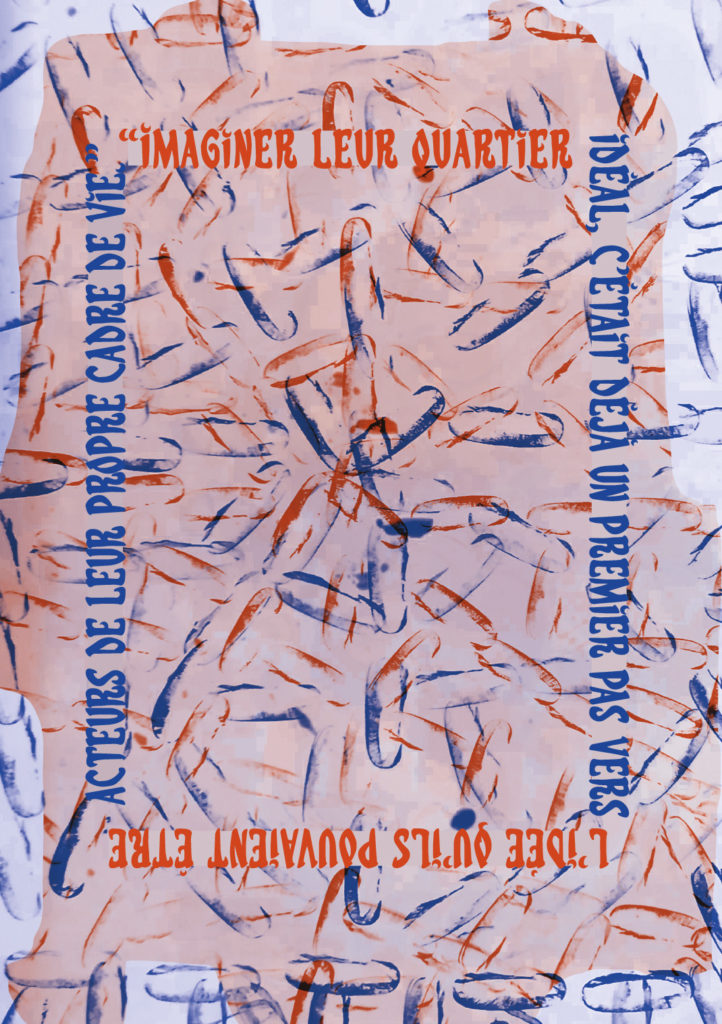Ce projet est donc parti d’une réflexion menée avec les apprenants eux-mêmes. Comment en es-tu venue à le lancer et pourquoi ça avait du sens pour eux ?
Fadella Nouri : En alphabétisation, il faut toujours partir de situations qui parlent aux apprenants. S’ils ne voient pas à quoi sert ce qu’ils apprennent, la motivation est plus difficile à maintenir. Beaucoup arrivent avec des attentes très scolaires, comme l’envie de maîtriser l’alphabet au plus vite. Mais je préfère les accompagner à leur rythme, en fixant des objectifs accessibles qui captent leur attention et leur permettent d’avancer pas à pas, en construisant des bases solides avant d’aller plus loin.
C’est en partant de cette idée que j’ai commencé à leur poser des questions sur leur environnement. Je leur ai demandé : « Dans quel quartier vous habitez ? » et là, je me suis rendu compte que ce mot, quartier, n’avait pas la même signification pour tout le monde. Certains me répondaient juste le nom de leur rue, d’autres parlaient de leur commune entière, mais sans réellement se représenter ce qu’est un quartier.
On a donc pris le temps d’en discuter ensemble : Qu’est-ce qu’un quartier ? Comment on le définit ? Où il commence, où il finit ? Petit à petit, ils ont commencé à verbaliser leurs impressions : « Mon quartier est sale », « C’est triste, il n’y a rien à faire », « Personne ne se parle. » C’était une vraie prise de conscience pour eux.
C’est là qu’est venue l’idée du projet : Et si on imaginait ensemble un quartier idéal ? Pour rendre ça encore plus concret, on a décidé de créer une maquette. Chacun a pu y apporter sa vision : certains voulaient plus de parcs, d’autres des marchés ou des lieux de rencontre. Ce n’était pas juste un exercice d’imagination, c’était une manière de réfléchir ensemble à ce qui rend un quartier agréable à vivre et au rôle qu’ils pouvaient y jouer.
Ce projet leur a permis non seulement de travailler l’expression orale et le vocabulaire, mais aussi de prendre conscience qu’ils avaient une place et un impact dans leur environnement. Imaginer leur quartier idéal, c’était déjà un premier pas vers l’idée qu’ils pouvaient être acteurs de leur propre cadre de vie. Et cette prise de conscience, pour moi, elle est aussi importante que l’apprentissage de la langue.
Le titre du projet est fort et évocateur. Comment as-tu choisi ce nom et qu’est-ce qu’il représente pour toi et les apprenants ?
F. N. : Ce titre illustre bien le cheminement des apprenants. Au départ, chacun parlait de son quartier à travers son prisme personnel, sans nécessairement prendre en compte sa dimension collective. Cette première étape est essentielle, car beaucoup d’entre eux n’avaient jamais réfléchi à leur quartier en tant qu’espace à part entière, avec ses spécificités et son impact sur
leur quotidien.
Au début, chacun décrivait son quartier de manière très personnelle : « Mon quartier, c’est là où je vais au marché » ou « Chez moi, il n’y a pas de parc, c’est triste. » Puis, en confrontant ces perceptions individuelles, nous avons commencé à construire quelque chose de plus collectif. Les échanges ont permis de mettre en lumière des points communs, mais aussi des différences qui enrichissaient la réflexion.
C’est là que le passage du « moi » au « nous » a pris tout son sens, en transformant leurs perceptions individuelles en une vision partagée. Ensemble, ils ont imaginé un quartier idéal : un espace où tout le monde se sentirait bien, où il y aurait plus d’espaces verts, des lieux de rencontre, et des voisins qui se parlent. Ce titre traduit bien cette réflexion : imaginer un quartier idéal, ce n’était pas seulement rêver d’un meilleur environnement, mais aussi comprendre comment chacun pouvait y contribuer. Il y avait un réel souci autour du vivre ensemble dans ce quartier idéal. Par exemple, ils ont beaucoup tenu à ce qu’il y ait une église et une mosquée, pour que toutes les communautés religieuses du groupe soient représentées.
Ce titre incarne donc tout cela : l’évolution des apprenants, leur capacité à passer d’une vision individuelle à une démarche collective, et surtout leur envie de transformer leur quotidien en s’appuyant sur leurs idées, leurs besoins et leurs envies.
Tu as accompagné un groupe d’apprenants aux parcours très variés dans ce projet. Peux-tu nous parler d’eux ? Qui étaient-ils et comment ont-ils vécu cette expérience ?
F. N. : C’était un groupe composé d’apprenants qui avaient des expériences de vie très différentes. Certains avaient déjà été scolarisés une année ou deux dans leur pays d’origine avant d’interrompre leur apprentissage, tandis que d’autres n’avaient jamais eu l’occasion d’apprendre à lire ou écrire, dans aucune langue. Cette diversité faisait toute la richesse du groupe, mais représentait aussi un défi : il fallait sans cesse adapter les activités pour que chacun puisse avancer à son rythme.
Ce qui me frappait, c’était leur persévérance. Malgré des journées bien remplies — responsabilités familiales, démarches administratives –, ils trouvaient encore l’énergie d’apprendre. Pour eux, assister aux cours de français n’était pas seulement une question d’apprentissage scolaire, mais un moyen de mieux comprendre leur environnement et de se sentir plus à l’aise dans la société. Cela illustre bien ce que représente cette démarche pour beaucoup d’entre eux : un espace où ils peuvent enfin se recentrer sur eux-mêmes, ressentir une progression et, surtout, reprendre confiance.
Le groupe fonctionnait aussi avec une belle entraide. Certains progressaient plus vite que d’autres, mais au lieu que cela crée un écart, ça renforçait leur solidarité. Dès qu’un apprenant comprenait une notion, il se tournait vers son voisin pour l’expliquer à sa manière. Parfois, ils utilisaient des gestes, reformulaient dans une autre langue, ou encore illustraient une situation pour mieux se faire comprendre. Cette dynamique était précieuse, car elle leur montrait qu’ils pouvaient aussi apprendre les uns des autres, et pas uniquement du formateur.
Et puis, au-delà de la langue, ce projet leur a permis de réaliser qu’ils n’étaient pas seuls. Beaucoup pensaient au début que leurs difficultés étaient individuelles, qu’ils étaient les seuls à se sentir perdus. Mais en discutant, ils ont compris qu’ils partageaient les mêmes défis, les mêmes blocages, les mêmes envies de progresser. Cette prise de conscience, ça a été une vraie force pour le groupe.
Au-delà du langage, ce projet a permis aux apprenants d’acquérir d’autres compétences essentielles. Tu peux nous en dire plus sur ce qu’ils ont appris et comment cela les aide au quotidien ?
F. N. : Oui, bien sûr ! Ils ont pu s’approprier le français dans des situations réelles, et pas seulement en mémorisant du vocabulaire. On a beaucoup travaillé sur la capacité à poser des questions, à comprendre une réponse et à oser parler, même avec des erreurs. Ce sont des choses qui peuvent sembler basiques, mais pour quelqu’un qui débute en français, c’est une véritable étape.
On a donc fait beaucoup de jeux de rôle et de mises en situation, pour qu’ils s’entraînent dans des contextes concrets. Par exemple, on a simulé des conversations pour demander une information, s’orienter dans un quartier, expliquer une adresse à quelqu’un. L’idée, c’était qu’ils puissent transférer ces apprentissages à leur quotidien. Parce que ce n’est pas seulement savoir dire « Bonjour » ou
« Où est la maison communale ? », c’est aussi oser aller vers l’autre, ne plus avoir peur de prendre la parole.
Ce projet a aussi renforcé des compétences sociales essentielles, notamment la collaboration et la gestion des interactions en groupe. Construire ensemble une maquette, imaginer un quartier idéal, ce n’est pas juste un exercice de créativité, c’est apprendre à écouter les autres, défendre ses idées sans s’imposer, et trouver des compromis. Par exemple, certains voulaient ajouter un grand parc, tandis que d’autres pensaient que des magasins de proximité étaient plus importants. Ils ont dû argumenter, expliquer leurs priorités et s’adapter aux besoins des autres.
Mais au-delà de ça, j’ai aussi vu des apprenants prendre confiance en eux d’une manière plus large. Par exemple, une dame qui, au début, n’osait pas du tout parler en français, m’a raconté qu’après avoir travaillé sur les échanges du quotidien en classe, elle avait enfin osé demander des tomates à un marchand du marché sans hésitation. Ça peut sembler anodin, mais pour elle, c’était un vrai cap. Ce genre de petit déclic, c’est ce qui change leur rapport à la langue et leur donne l’envie d’aller plus loin.
Accompagner des apprenants en alphabétisation, c’est aussi faire face à des défis, que ce soit pour eux ou pour toi en tant que formatrice. Quels ont été les principaux obstacles qu’ils ont rencontrés, et comment les as-tu aidés à les surmonter ?
F. N. : L’un des plus grands défis pour eux, c’est la peur de se tromper. Beaucoup arrivent en formation avec une estime d’eux très basse, convaincus qu’ils ne savent rien faire, simplement parce qu’ils ne parlent pas encore français. Or, c’est faux. Par exemple, ils savent se repérer dans la ville, utiliser des gestes ou des mots simples pour se faire comprendre, ou encore gérer des situations complexes du quotidien sans forcément passer par le langage, grâce à des stratégies qu’ils mettent en place pour pouvoir se débrouiller dans leur quotidien. Leur faire prendre conscience de ces savoir-faire invisibles les aide à retrouver confiance en eux et à oser s’exprimer davantage.
Un autre défi, c’est la diversité des rythmes d’apprentissage. Dans un même groupe, certains progressent très vite, tandis que d’autres ont besoin de plus de temps pour assimiler les bases. Ce n’est pas toujours facile à gérer, mais j’essaie de proposer des activités adaptées pour que tout le monde trouve sa place. Souvent, ceux qui avancent plus vite aident les autres, ce qui renforce un bel esprit de solidarité.
Et puis bien sûr, il y a la difficulté d’apprendre une langue quand on n’a jamais été scolarisé ou très peu. Lire, écrire, parler… tout demande du temps et de la patience. Beaucoup aimeraient progresser rapidement, et il faut leur rappeler que chaque petit pas compte.
En tant que formatrice, je dois être attentive à ne laisser personne décrocher. Parfois, un apprenant va dire qu’il a compris, mais son regard montre le contraire. Dans ces moments-là, je prends le temps de répéter autrement, reformuler, ou donner un exemple plus concret. Parce que si quelqu’un se sent perdu et qu’il n’ose pas le dire, il risque de se décourager.
C’est un travail exigeant, qui demande beaucoup de patience et de créativité. Mais c’est aussi extrêmement gratifiant. Quand je vois un apprenant oser essayer une phrase qu’il n’aurait jamais osé dire avant, ou simplement se sentir fier de lui, je me dis que tous ces efforts en valent la peine.
Face à ces défis, ton rôle va bien au-delà d’un simple enseignement. Comment décrirais-tu ta posture en tant que formatrice ?
F. N. : Être formatrice, ce n’est pas seulement transmettre des connaissances, c’est accompagner, écouter et créer un cadre sécurisant où les apprenants osent progresser. Avant même de parler d’apprentissage, il faut d’abord instaurer un climat de confiance. Si un apprenant a peur de se tromper, il bloque et n’ose plus progresser.
Je veille donc à rendre chaque séance la plus accessible et bienveillante possible. Cela passe par des gestes répétés qui deviennent des repères visuels, une reformulation constante, et surtout, des exemples concrets tirés de leur quotidien. Par exemple, lors d’un exercice sur les lieux du quartier, une apprenante ne comprenait pas le mot « boulangerie ». Plutôt que de simplement traduire, je lui ai demandé où elle achetait son pain, comment elle appelait cet endroit dans sa langue. Ce lien avec son expérience lui a permis d’intégrer naturellement ce mot.
Je suis aussi attentive aux signaux non verbaux. Parfois, un apprenant ne dira pas qu’il est perdu, mais son regard ou son silence en disent long. À ce moment-là, je ralentis, je reformule, ou je lui donne un exemple supplémentaire pour qu’il puisse raccrocher sans se sentir mis en difficulté.
Ce que j’aime dans mon métier, c’est la diversité des approches possibles. Il n’y a pas une seule bonne méthode : pour un même concept, je peux utiliser des jeux, des objets, du dessin ou des mises en situation. Mon but, c’est que l’apprentissage soit vivant, engageant et qu’ils repartent avec le sentiment d’avoir appris quelque chose d’utile.
Et surtout, je célèbre chaque petite victoire. Retenir une nouvelle phrase, oser parler devant le groupe, réussir à expliquer où on habite… Tout cela compte. L’important, ce n’est pas d’aller vite, c’est de ne pas s’arrêter.
Tu as évoqué l’importance d’adapter l’apprentissage aux besoins de ton groupe. Quels types d’outils pédagogiques utilises-tu pour rendre les séances plus accessibles et engageantes ?
F. N. : Avec le temps, j’ai réalisé qu’il était rare de trouver des supports qui correspondent exactement aux besoins de mes apprenants. Chaque groupe est différent, et les outils doivent s’adapter à leurs réalités, à leurs expériences et à leur manière d’apprendre. C’est pourquoi je crée moi-même une grande partie de mes supports, en m’inspirant de ce qui les entoure et en transformant des exercices classiques pour les rendre plus concrets et interactifs.
J’utilise beaucoup de supports visuels et manipulables, comme des cartes plastifiées, des images à associer à des mots, ou encore des jeux de rôle où ils doivent interagir comme dans la vraie vie. Par exemple, au lieu de simplement apprendre le vocabulaire des directions sur papier, on fait un exercice où un apprenant guide un autre à travers la salle en utilisant uniquement des indications orales. C’est ludique, et surtout, ils se souviennent bien mieux du vocabulaire parce qu’ils l’ont vécu.
Je détourne aussi des exercices issus de manuels de français, mais en les simplifiant ou en les rendant plus dynamiques. Un exercice de grammaire peut devenir par exemple un jeu de cartes. De cette façon, ils ne sont jamais passifs : ils expérimentent, testent, et s’amusent tout en apprenant.
Un autre point essentiel dans mes séances, c’est l’ancrage dans leur langue maternelle. Je ne fais pas de traduction systématique, mais j’encourage les apprenants à faire des liens entre les mots qu’ils connaissent et ceux qu’ils découvrent en français. Cela les rassure et leur permet de voir leur langue comme une ressource plutôt que comme une barrière.
Enfin, la gestuelle joue un rôle central. J’ai des gestes précis pour accompagner certains mots, et je les répète toujours de la même manière. Peu à peu, ces gestes deviennent des repères visuels et aident les apprenants à mémoriser sans effort. Par exemple, quand je dis « tourner à gauche, » je mime systématiquement l’action. Cela devient une sorte de langage corporel intégré à l’apprentissage.
Mon objectif avec ces outils, ce n’est pas juste de transmettre du contenu, mais de créer un environnement où apprendre devient un plaisir. Je souhaite que mes apprenants se sentent capables, qu’ils osent essayer sans crainte, et surtout qu’ils voient que la langue française peut être un espace d’exploration et d’expérimentation, et pas seulement un défi à surmonter.
Si tu devais retenir une chose essentielle de cette expérience, ce serait quoi ?
La capacité des apprenants à s’approprier un projet quand ils y trouvent du sens. Au départ, parler de leur quartier semblait abstrait, mais en les amenant à verbaliser leur réalité, à partager leurs expériences et à construire ensemble, ils ont pris conscience qu’ils avaient un rôle à jouer dans leur environnement. Ce projet leur a donné une voix et une place. Ils ont compris qu’ils pouvaient agir sur leur environnement, et ça, c’est une victoire qui dépasse largement l’apprentissage du français.