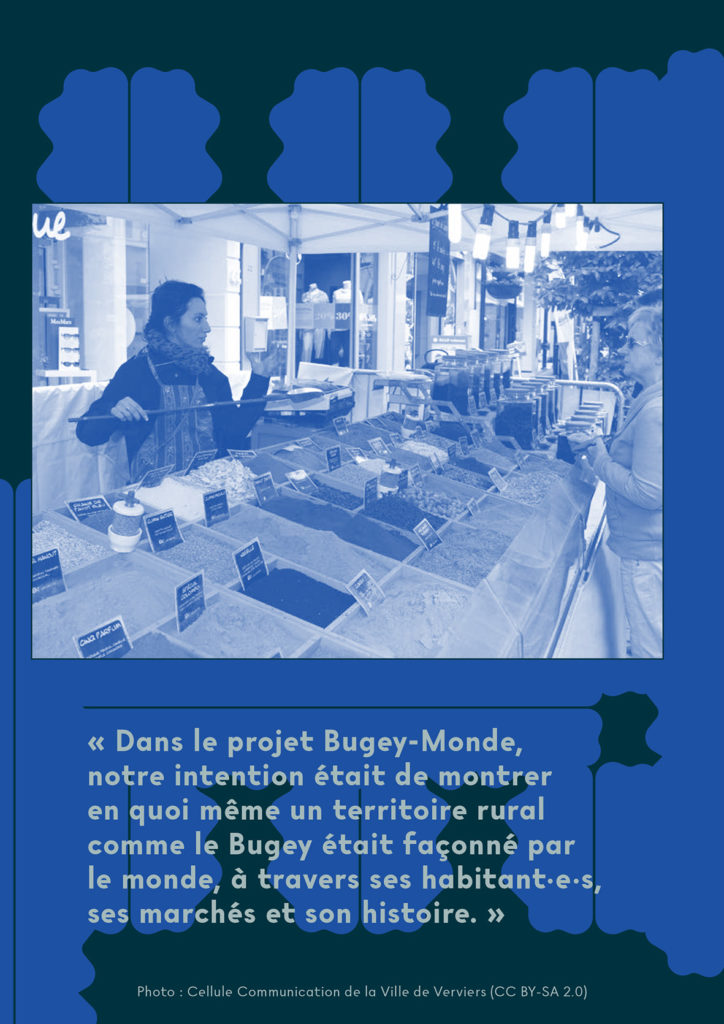Notre espace de pensée est réduit par nos socialisations, nos éducations, nos relations, nos sources d’informations… Dans notre vie quotidienne, au travail, dans des lieux publics, lors d’une réunion associative, dans la famille, avec des amis, à la lecture d’un article, il nous arrive tous et toutes de nous sentir à côté, de ne pas comprendre de quoi traite l’objet de ce que nous entendons, voyons, lisons…, d’être incapable de donner notre point de vue, de n’avoir aucune idée sur le problème traité… ou, à l’inverse, de croire tout savoir. Que proposent nos associations d’éducation populaire qui permettent de « travailler » notre ouverture au monde ainsi que des situations sociales dans lesquelles nous sommes impliqué·e·s, sur le long court, de manière régulière ? Comme une nouvelle hygiène de vie qui demande méthode, régularité, et en totale adaptation à ce que chacun·e est ?
Dans les pratiques, nous retrouvons des propositions pour penser par soi-même et avec d’autres, comme autant d’entrainements pour ne pas se laisser glisser vers des simplifications souvent tronquées ou trompeuses : des ateliers d’arpentage de livres, de films documentaires ou encore des ateliers pratiques d’entrainement mental.
Parmi son attirail utile pour élaborer pensées et formations, le Réseau des Créfad1 s’appuie sur la méthodologie de l’entrainement mental2. Cette approche, qui articule raisonnement logique, approche dialectique et délibération éthique, a été élaborée pour se confronter à la complexité dans l’action. Dans ce texte, nous faisons dialoguer une formation intitulée Agir le monde élaborée par l’association d’éducation populaire entre-autres avec la méthodologie de l’entrainement mental (en nous appuyant particulièrement sur sa dimension logique) pour en relever ses constituants et finalités. Cette dimension logique se présente relativement simplement et peut être résumée en quatre questions à se poser individuellement ou collectivement pour ralentir le rythme effréné de nos vies qui nous empêche de penser la complexité du monde. Quatre questions pour s’interroger sur sa propre manière de percevoir le monde.
Cette formation Agir le monde pointe les lacunes et les limites de notre perception de la dimension Monde, notamment dans nos actions professionnelles. Comment agir sur le monde si nous ne le connaissons pas ?
De quoi s’agit-il ?
La formation a vu le jour en 2016 dans le Bugey, zone rurale et de moyenne montagne située en France, entre Lyon et Chambéry. Construite par l’association entre-autres, elle s’intitulait : Agir le monde : identifier les frontières dans nos pratiques professionnelles. Elle ciblait les personnes engagées dans les métiers de la relation : animation, travail social, éducation…
La nécessité de cette formation est apparue alors que les deux fondatrices de l’association, Claire et Charlotte, avaient étudié les relations internationales et avaient eu une expérience de travail dans la coopération pour le développement, au Zimbabwe, en Afrique du Sud et en Haïti. « Depuis la création d’entre-autres, nous étions intervenues ponctuellement auprès de travailleurs humanitaires internationaux, en lien avec le Centre de Recherche sur l’Action Humanitaire à Genève. Nous intervenions régulièrement dans le cadre de la préparation au départ des volontaires de solidarité internationale du Service de Coopération pour le Développement, basé à Lyon, et de la formation des travailleur·euse·s sociaux dans des écoles de Lyon et de Bourg-en-Bresse. »
En 2020, dans le contexte de la guerre en Syrie et des craintes migratoires qu’elle avivait sur le territoire d’intervention de leur association, Claire et Charlotte ont lancé le projet Bugey-Monde en prenant appui sur la formation Agir le monde. « Dans ce projet Bugey-Monde, notre intention était de montrer en quoi, même un territoire rural comme le Bugey était façonné par le monde, à travers ses habitant·e·s, ses marchés et son histoire. Ce projet a bénéficié directement des constats posés et du programme de formation que nous avions alors élaborés. »
Dans la méthodologie de l’entrainement mental, cette première question – De quoi s’agit-il ? –invite à distinguer les éléments du réel. Ce qui est. Identifier des faits, tangibles, reconnus et les distinguer des idées, élaborées, discutables. Les faits renvoient à des références vérifiées (étudiées avec méthode) ou mesurées (chiffres, statistiques). Les faits renvoient aussi à ce que JE vis ou à ce que j’ai vécu en situation (ressenti, émotion)3. La proposition étant de distinguer ces différentes familles de faits.
Les faits relatifs à une situation ne sont pas si nombreux ! Il est possible de les lister, les classer, les décrire, les définir, les comparer… mais il est indispensable de les situer dans l’espace et dans le temps.
Quels sont les problèmes ?
La formation Agir le monde faisait sens pour l’association. « Parce que nous avions fait le constat, à travers nos expériences, que la dimension Monde est soit absente de nos actions, soit marginalisée, soit instrumentalisée :
- Absente quand toutes les références que nous proposons sont d’auteur·rice·s français·e·s. Pas même francophones mais français·e·s.
- Marginalisée quand notre façon d’inclure dans nos actions le monde consiste à animer un atelier à partir des Objectifs de Développement Durable (ODD)4 ou un jeu des chaises5 une fois par an, ou d’organiser de temps à autre un voyage au-delà de nos frontières.
- Instrumentalisée, quand notre connaissance, lacunaire, du monde sert à délégitimer nos revendications sociales (« c’est quand même mieux en France qu’ailleurs ») ; à justifier nos comportements par ce que nous pensons savoir de la culture nationale, religieuse ou continentale des personnes que l’on accueille, ou de leurs parents ou de leurs grands-parents (« les Africains ne sont jamais à l’heure, ce n’est pas leur faute, c’est leur culture alors je suis stricte pour leur apprendre la ponctualité ») ; ou à renforcer notre impuissance (« c’est déjà compliqué à l’échelle locale, alors à l’échelle du monde… »).
Comment agir sur le monde si nous ne le connaissons pas ? Claire et Charlotte ont alors pensé un contenu de formation, sur trois jours, avec, comme grand objectif de travailler nos perceptions de l’espace-monde.
Tout comme les étudiant·e·s, les enseignant·e·s, les chercheurs et chercheuses, les acteurs et actrices de l’éducation populaire connaissent la difficulté à « problématiser », c’est-à-dire à choisir le problème que l’on souhaite traiter « pour cette fois-ci » et à le formuler. Car les lectures que l’on peut faire d’une situation sont multiples, dépendent du point de vue adopté (celui du barman, de la juge d’instruction ou de ma mère) et des aspects qu’il peut recouvrir : juridique, social, économique, culturel, politique, déontologique…
Il s’agit aussi d’identifier l’existence des contradictions. La capacité à penser de manière dialectique6 la coexistence d’éléments contradictoires, sans vouloir tout résoudre maintenant, fait partie de l’entrainement à envisager la complexité du monde.
Pourquoi est-ce ainsi ?
Oui, pourquoi tant d’ignorance ou de préjugés ? Dans la formation, il fallait parler de nos connaissances lacunaires de l’expérience des habitant·e·s du monde. S’expliquer en mobilisant des ressources précises et plus larges.
« Nous nous sommes appuyées sur un projet créé par Hans Rosling, statisticien et créateur de la Fondation Gapminder, qui s’appelle le World Ignorance Project7. » Dans la vidéo de présentation de ce projet, Hans Rosling pose trois questions, donne trois choix et demande au public de répondre :
- Comment a évolué le nombre de décès causés par des catastrophes naturelles ?
- Comment a évolué la part de la population mondiale vivant dans l’extrême pauvreté ?
- Quelle a été la durée moyenne de scolarisation des femmes qui ont aujourd’hui 30 ans ?
Le statisticien a préalablement enregistré les réponses de journalistes européens et états-uniens ainsi que du grand public suédois. La grande majorité des répondant·e·s a, à chaque fois, donné la réponse la plus pessimiste, quand c’est la réponse la plus optimiste qui se vérifiait statistiquement. Quatre idées reçues à déconstruire étaient omniprésentes :
1 Le monde va de pire en pire.
2 Le monde se divise en deux catégories : les très riches et les très pauvres.
3 C’est la richesse qui amène le développement social et non l’inverse.
4 Les faits divers sont statistiquement significatifs.
Il concluait en interrogeant : comment pouvons-nous imaginer l’amélioration de notre monde si nous ne le connaissons pas et si nous n’avons pas conscience de son évolution ? Il proposait alors d’identifier ces biais de l’intuition fondée sur des idées reçues, et de les combattre en revenant aux faits (grâce aux statistiques) et en développant un programme d’éducation au monde.
Avec la question Pourquoi est-ce ainsi ?, il s’agit d’identifier des pistes d’explications de la situation. Et d’accepter qu’elles sont légion, car nous ne réfléchissons pas tous et toutes pareil et nous ne mobilisons pas les mêmes références. Il convient donc de nommer qui parle, qui émet les hypothèses sur les causes et les conséquences, avec quelle pertinence ou quelle légitimité ; d’identifier/se mettre d’accord sur les explications qui correspondent à la situation travaillée ; d’identifier les désaccords et éventuellement d’entrer en conflit sur cette base. Ces relations de causes à effets peuvent être logiques8 : la physique, la cuisine, le code civil… Elles peuvent également être symboliques9 : la tradition, les croyances, l’inconscient collectif… Il ne s’agit pas de dire que toutes les explications se valent tout le temps, mais plutôt de les confronter et de tester leur robustesse. Identifier les explications et les arguments que l’on mobilise habituellement peut s’avérer utile, soit pour étoffer la puissance de son argumentaire, soit éventuellement pour changer d’avis si l’on trouve une raison de le remettre en cause de manière fondée.
Alors, que faire ?
« À partir de nos cheminements, de nos problématisations et de cette démonstration de nos biais cognitifs et culturels avérés, il s’agissait de monter une formation permettant une mise en perspective de notre expérience du monde. »
La formation proposait des lectures, pour élargir les points de vue, défaire les idées reçues, l’arpentage de livres d’auteur·rice·s diverses10, une lecture du Manifeste Pour une Politique de la relation11, dont l’association entre-autres est signataire et qui affirme que nous vivons dans des villes-monde, des quartiers-monde, des villages-monde, héritiers de l’histoire de notre pays et du monde ! Ce Manifeste propose de changer de perspective, de penser les cultures en termes de relation et de fécondation plutôt que de différences essentielles.
Un rappel était opéré sur l’actualité de l’histoire coloniale de la France, à travers la carte des départements, régions et collectivités d’Outre-mer et la spécificité de leurs droits. Ou encore par la lecture du discours de Christiane Taubira présentant la proposition de loi affirmant que la traite et l’esclavage sont des crimes contre l’humanité, prononcé le 18 février 1999 en séance de l’Assemblée nationale, à laquelle elle avait invité neuf jeunes de Guyane, « qui sont là pour constituer une chaîne fraternelle. Ils sont amérindiens, bonis, créoles, haïtiens, français – on dit ‘métro’ chez nous – et chinois pour symboliser les quatre continents qui, en Guyane, construisent au quotidien la fraternité. »12
Ensuite, un travail sur nos perceptions de l’espace-monde était proposé à travers la réalisation de dessins représentant le monde tel que les participant·e·s se le représentaient. « Nous souhaitions compléter ce temps par une réflexion sur les projections du monde et leurs effets psychologiques, en termes de proximité et de distance, mais aussi de centralité et de marginalité. »
Et enfin, un temps de chantier sur les pratiques professionnelles consistait à inviter les participant·e·s à regarder leurs pratiques professionnelles, à partir de tout le matériau mobilisé auparavant. Quelle place le monde a-t-il dans leurs pratiques ? Quelle place pourrait-il y prendre ? Avec quels objectifs ?
« Nous avons proposé cette formation dans les établissements où nous intervenions (écoles de travail social, associations d’éducation populaire, centres sociaux et maisons des jeunes et de la culture, associations de solidarité internationale). Les retours ont été mitigés : soit cette formation était déjà prise en charge, soit le thème n’était pas prévu dans les parcours, soit la ville la plus proche semblait déjà si loin qu’une perspective monde était vertigineuse… L’espace-monde ne fait toujours pas recette ! Nous avons toutefois réutilisé des modules ou des matériaux pour d’autres actions, avec les volontaires en solidarité internationale et dans la suite qu’a pris le projet Bugey-Monde en 2020. Nous avons essayé de garder dans toutes nos actions une vigilance à convoquer des auteur·rice·s ou des images conçues au-delà de nos frontières. »
Retour dans le réel avec la question Alors, que faire ? Une fois qu’on a pris le temps de lister des faits, d’identifier différents types de problèmes, de formuler des hypothèses permettant d’expliquer la situation, alors peut-être peut-on agir de manière plus pertinente. Que peut-on faire ? invite à identifier les méthodes, moyens, techniques que l’on a à disposition pour agir et atteindre ses objectifs. Mais également à se poser la question de la finalité de son action, de la portée de ses actes. En cela, elle permet de se poser la question de sa propre éthique13 en situation. Que puis-je faire dans ce monde complexe, dans une situation que j’ai désormais analysée et sans doute mieux comprise, en accord avec mes valeurs et ma perception de ce qui est juste ?
Ce texte à tiroirs cherche à allier la méthode (la formation, l’entrainement mental) et l’exigence éthique du fond (comprendre le monde, appréhender l’espace-monde). L’entrainement mental, comme la formation permanente, continue ou l’éducation populaire, est constitué d’« un ensemble d’impératifs éthiques, épistémologiques et politiques, dessinant une perspective d’engagement, faisant rupture avec les modèles de rationalité dominants qui président à l’encadrement de la pensée, de l’action et de la parole (…) »14. Il favorise une compréhension du monde et de l’espace-monde via une pensée critique, nécessaire pour agir à l’encontre du néolibéralisme et du néofascisme.
- Le Réseau des Créfad est une coordination de 16 associations d’éducation populaire (dont La Méandre et entre-autres), actives et ancrées dans de multiples contextes ruraux et urbains, qui œuvrent de diverses manières pour construire et agir ensemble, mais aussi dans et par un interassociatif solidaire. Elles se réfèrent collectivement au Manifeste de Peuple et Culture de 1944, héritage partagé, en particulier dans son invitation à résister aux habitudes, aux préjugés, aux idées reçues, aux dominations que l’on subit et exerce… Cet héritage, dont celui de l’entrainement mental, se transforme aujourd’hui au fil du cheminement des associations et par la rencontre avec d’autres sources, d’autres références, d’autres cultures.
- Pensé dans le cadre de la pédagogie de l’école des cadres d’Uriage (France) pendant la seconde guerre mondiale (entre 1940 et 1942), l’entrainement mental devient un principe d’éducation des élites ouvrières à partir de 1944 et accède au statut de méthode avec Peuple et Culture (mouvement d’éducation populaire) dans le cadre des formations du Centre d’éducation ouvrière de Grenoble (fin 1944-début 1945). Ce mouvement l’utilisera jusque dans les années 1980 pour la formation des cadres de la fonction publique et/ou d’entreprises, mais aussi celle des ouvriers ou apprentis, des travailleurs et travailleuses du social notamment. L’entrainement mental s’est également étoffé via la pratique et des échanges entre formateur·rice·s, notamment au sein du groupe Passeur·e·s de l’entrainement mental du Réseau des Créfad. Voir : Catherine DURAY, Questionner les évidences qui peuplent notre quotidien et auxquelles nous ne prenons pas garde, in Journal de l’alpha, n°234, 3e trimestre 2024, pp. 68-69 (Transmettre l’entrainement mental, levier vivant pour penser et agir dans la complexité), www.lire-et-ecrire.be/ja234
- Charlotte HERFRAY, Penser vient de l’inconscient. La méthode de l’entraînement mental, Érès, 2012.
- Les Objectifs de Développement Durable sont 17 objectifs adoptés par l’Organisation des Nations Unies en 2015, à travers lesquels chaque État a été invité à penser sa politique nationale et son aide publique au développement : www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable
- Le jeu des chaises est un jeu de simulation destiné à symboliser la répartition inégale de la population et des ressources mondiales : www.iteco.be/revue-antipodes/se-jouer-des-inegalites
- La dialectique dans l’entrainement mental renvoie à l’idée que dans toute chose, toute action, son contraire coexiste. C’est considérer que la négation d’une chose est présente dans cette chose. La dialectique apporte une approche complémentaire à la logique – dans laquelle le « ou » est la règle – en invitant à considérer le « et ». C’est prendre le parti de la jonction, du lien, et porter une attention au processus.
- www.ted.com/talks/hans_and_ola
- Dans la pratique de l’entrainement mental, on entend par « logique » une manière d’organiser, d’analyser, d’examiner le réel à partir d’un ensemble de mécanismes (règles, lois, conventions, principes, normes…), à distinguer de l’instinct, de la perception ou de l’expérience vécue… Une logique a toujours une finalité et s’appuie sur un ou plusieurs des mécanismes cités, situés dans un contexte sociopolitique déterminé.
- Dans son emploi en entrainement mental, le symbolique correspond au mécanisme qui relie le signe et le sens, qui accorde du sens à quelque chose qui fait signe, qui fait que quelque chose représente, dans une situation, autre chose que ce qu’il est et prend une valeur qui dépasse ses traits et propriétés. Ce mécanisme du symbolique inscrit un fait dans un système de sens qui n’est pas toujours identifié par tous et toutes.
- Par exemple : Collectifs (avec la contribution de Michel LE BRIS et Alain MABANCKOU), L’Afrique qui vient. Anthologie, Hoëbeke, 2013.
- https://maisondespassages.org/IMG/pdf/
- www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee
- En entrainement mental, l’éthique se situe dans le concret. C’est une délibération pour soi, qui engage sa propre responsabilité lorsqu’il faut poser un choix pour agir dans une situation qui nous affecte chacun·e et dans laquelle des valeurs, des principes, des règles morales entrent en contradiction. La pensée éthique affronte ces contradictions dans les choix ou les actions que chacun·e met alors en œuvre.
- Pierre DAVREUX, Éduquer après Auschwitz, 2005, www.entrainement-mental.info/eduquer.html