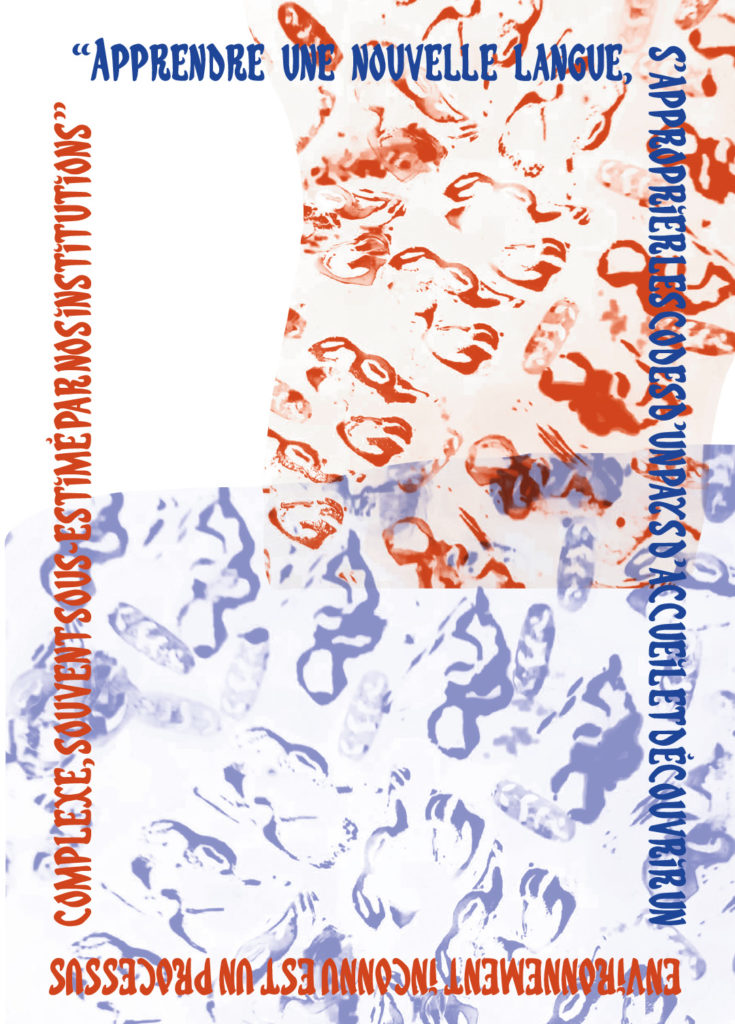Poser ses valises et baliser le périmètre
Depuis le milieu des années 1990, l’Europe a vu se multiplier les politiques d’intégration pour les nouveaux arrivants sur son territoire1. Les Pays-Bas ont été le premier pays européen à mettre en place un parcours d’intégration pour les primo-arrivants non-européens incluant tout d’abord des cours de langue et des cours d’introduction aux institutions et pratiques de la société d’accueil. Les autres Etats membres de l’Europe ont suivi le mouvement avec l’idée que la pratique de cours d’intégration pouvait rendre compte de l’efficacité des politiques nationales en matière d’intégration. Ainsi les politiques d’intégration européennes ont toutes convergé vers des parcours d’intégration partiellement ou totalement obligatoires qui instaurent trois volets principaux : l’apprentissage d’une des langues nationales, l’accompagnement socio-professionnel et une formation citoyenne pour comprendre le fonctionnement du pays d’accueil2.
Bien que la politique d’immigration belge soit une compétence fédérale et que l’intégration des personnes se réfère aux compétences régionales, la Belgique n’a pas échappé à l’influence de ses voisins européens. Chacune des trois régions du pays a développé son propre parcours d’intégration.
Les trois parcours d’accueil ou d’intégration, selon l’appellation proposée dans les différentes régions du pays3 ont globalement une structure commune. Ils sont accessibles à toutes les personnes primo-arrivantes4, mais obligatoires uniquement pour certaines5. Ils se composent de 4 étapes. L’article se concentrera sur quelques initiatives mises en place du côté francophone à Bruxelles et en Wallonie.
Avant d’analyser ces situations plus en détail, il nous semble néanmoins important de clarifier, d’un point de vue institutionnel, certains enjeux politiques liés à ces législations. Dès 2013, Lire et Ecrire a pris position sur les décrets relatifs aux parcours d’accueil pour les primo-arrivants en participant à l’avis du Conseil supérieur de l’Éducation permanente (CSEP), dont elle est membre6. Ces projets de décret sur le parcours d’intégration des primo-arrivants suscitant des débats par rapport à leur caractère obligatoire, leur impact sur l’accès à la formation et le contenu des modules dispensés : «…Dans le cadre de leur décret, les associations d’éducation permanente ont pour objectif de permettre un regard critique sur le fonctionnement de la société et non de dispenser une sorte d’orthodoxie accélérée sur la Belgique et son fonctionnement. » Et le CSEP de refuser que « la politique d’accueil soit confiée à des acteurs marchands, qui ne donnent aucune garantie en matière de pratiques d’émancipation. » En outre, un public ne pouvant chasser l’autre, il est exclu, pour le Conseil Supérieur, « que les moyens des politiques existantes, qui n’arrivent déjà pas aujourd’hui à répondre à la demande, soient utilisés pour la mise en œuvre de ces nouveaux décrets. De nouveaux moyens devront être dégagés tant pour développer de nouvelles actions que pour soutenir les actions existantes. »
Dans ce contexte, Lire et Ecrire n’a pas accepté de participer à la mise en œuvre de ces politiques en tant qu’opérateurs de formation. Qu’il y ait ou non obligation, notre association a toujours craint d’être instrumentalisées par une politique qui semble poursuivre, au-delà des objectifs avoués, un objectif d’activation des personnes d’origine étrangère (extraeuropéenne), entrainant un contrôle accru de ce public ainsi que des situations d’exclusion.
Entrer dans un dispositif en plusieurs étapes
Tout d’abord, un accueil s’effectue dans l’un des bureaux d’accueil pour primo-arrivants — un BAPA7 à Bruxelles ou un CRI8 en Wallonie. Au cours de ce module d’accueil, la personne primo-arrivante est reçue lors d’un entretien avec un travailleur social pour établir « un bilan de sa situation personnelle (santé, enfants, logement, compétences en langue française, expériences personnelles, formations professionnelles, diplômes, équivalences éventuelles…). Elle est également informée des différents services existants. (…) Tout cela en vue d’une orientation optimale. »9. En plus de ce bilan social, une information sur les droits et devoirs des citoyens résidant en Belgique est donnée ; une aide aux démarches administratives peut être proposée et un test d’évaluation du niveau de français est réalisé.
En fonction des bilans réalisés et selon les besoins des personnes, celles-ci sont orientées vers un opérateur linguistique où elles pourront suivre des cours de langue. C’est la deuxième étape. Les étapes suivantes consistent en un accompagnement social10 et une formation à la citoyenne dont l’objectif est d’approfondir des sujets abordés lors du module d’information sur les droits et devoirs mais d’approcher aussi des sujets tels que l’histoire et la géographie de la Belgique, l’organisation politique et institutionnelle, le marché de l’emploi et les relations sociales en Belgique. Cette formation à la citoyenneté se veut être espace interculturel11.
Enfin, dernier élément, à partir du moment où la personne signe une convention avec le bureau d’accueil, elle dispose à Bruxelles de 18 mois et en Wallonie de 3 ans maximum pour réaliser son parcours12.
Se situer et déchiffrer de nouvelles cartes
Face à l’hétérogénéité du public primo-arrivants qui s’inscrit à ce parcours, on peut s’interroger sur les dispositifs existants pour les personnes alpha non-francophone13. Pour ce faire, on s’est appuyé sur des rencontres avec trois travailleur·euses œuvrant dans ces dispositifs : une responsable de projet dans l’un des BAPA bruxellois, une formatrice dans l’un des organismes officiellement reconnu comme opérateur linguistique dans le cadre du parcours d’accueil pour primo-arrivants et un travailleur de l’un des Centres Régionaux d’Intégration wallon (CRI).
Les travailleurs que nous avons interrogés reconnaissent tous l’importance de distinguer les approches pédagogiques et de réfléchir à des dispositifs pour les personnes analphabètes et non-francophones ; ces apprenants nécessitent un accompagnement pédagogique spécifique, mobilisant ne serait-ce que par exemple « des supports visuels et des activités concrètes pour faciliter la compréhension et la mémorisation », nous dit la formatrice.
Les cours linguistiques étant limités dans le temps — 400h au maximun comprises dans le parcours — ne permettent pas toujours d’accéder au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues14. Par conséquent, les opérateurs proposent des activités complémentaires : les ateliers de conversation, les possibilités de bénévolat, les sorties culturelles ou encore la participation à des événements festifs qui peuvent créer des espaces d’apprentissage informels et ainsi « en plus du temps passé en formation, les apprenants apprennent beaucoup à travers des situations réelles du quotidien, et ces apprentissages sont directement liés à leur parcours social, professionnel et aux
relations qu’ils tissent dans la société qui les accueille. C’est pourquoi l’orientation vers des activités en dehors des cours de français à proprement parler est également nécessaire pour favoriser leur progrès dans la langue du pays d’accueil », nous raconte la formatrice. Ces activités complémentaires viennent également pallier au manque de place dans certains modules de formation. En effet, les délais d’attente pour entrer en formation linguistique, niveau débutant, et spécifique à l’alpha pour non-francophones dépassent parfois les 6 mois, nous explique la responsable de projets.
Les formateurs impliqués dans les formations à la citoyenneté tâchent de s’appuyer sur des méthodes adaptées mais bien que l’offre de formation en français facile15 s’élargisse, « elle reste minime », nous explique la responsable de projets en BAPA. Les personnes n’ayant pas les connaissances en français oral suffisantes pour suivre ces modules peuvent toutefois trouver une formation dans une autre langue que le français et qu’ils maîtrisent à l’oral. D’après les personnes interrogées, ces initiatives restent encore insuffisantes ; les formateurs sont sensibilisés aux enjeux de l’analphabétisme lors de leur formation de base de formateur en citoyenneté16 mais n’abordent pas spécifiquement le travail pédagogique avec ces publics. D’après la responsable de projet, « Un travail sur la posture du formateur avec des publics peu scolarisés demande de revoir la manière dont nous avons l’habitude de donner nos formations ». De plus, « les bureaux d’accueil n’ont pas toujours les travailleurs qui parlent les langues demandées par les apprenants ; alors on doit faire appel à un service de traduction extérieure et parfois coanimer une formation avec un traducteur ; ce qui peut compliquer encore davantage la dynamique de la formation ».
Les témoignages de ces professionnels soulignent la nécessité d’adapter continuellement les pratiques de formation au public qu’ils ont en face d’eux, selon les moyens dont ils disposent et en fonction des besoins des apprenants. Ces réflexions peuvent donner naissance également à des projets plus spécifiques tels que les Ateliers sociolinguistiques, mis en place chez certains opérateurs ou bureaux d’accueil. Dans ces ateliers, « On utilise activement la langue. Ce ne sont ni des cours de français langue étrangère ni des cours d’alphabétisation à proprement parler — les apprenants sont mélangés – et les ateliers sont thématiques en fonction des besoins rencontrés par une majorité de nos bénéficiaires ». Il s’agit d’une approche pédagogique globale qui permet de développer des aptitudes sociales et communicatives permettant aux participants à ces ateliers d’agir rapidement et efficacement dans des situations précises. L’approche implique des partenariats avec des professionnels de l’espace social visé ; les mises en situation étant un élément déterminant de la méthodologie17. Cependant ces dispositifs restent marginaux dans l’environnement des parcours d’accueil et d’intégration et s’ajoutent aux heures de formation obligatoires auxquels les personnes doivent participer.
Et pour aller plus loin ?
Une réflexion sur le temps d’apprendre semble essentielle pour ces professionnels, tant les parcours des apprenants diffèrent. « Apprendre une nouvelle langue, s’approprier les codes d’un pays d’accueil et découvrir un environnement inconnu est un processus complexe, souvent sous-estimé par nos institutions », explique la responsable de projets. La période d’adaptation varie considérablement d’une personne à l’autre, influencée par son parcours de vie, son bagage scolaire et sa disponibilité d’esprit au moment de son inscription en formation. Or, les repères des apprenants primo-arrivants ne coïncident pas toujours avec ceux des organismes de formation ou des pouvoirs publics, qui imposent parfois des cadres peu adaptés à la diversité des rythmes d’apprentissage. Ce décalage implique la nécessité de repenser les dispositifs existants : « comment renforcer les partenariats et favoriser une plus grande centralisation tout en individualisant davantage les parcours ? Comment garantir que les apprenants peu ou pas scolarisés trouvent pleinement leur place dans ces dispositifs ? », questionne le travailleur du CRI.
Comme le soulignaient déjà Aurélie Storme et Anne Godenir en 201418, l’implication des personnes dans des activités à but social ou professionnel facilite l’apprentissage de la langue. Il serait donc absurde, voire contre-productif, de hiérarchiser ces processus en considérant que la maîtrise linguistique doit précéder toute forme de participation à la vie sociale. Dès lors, il semble primordial de « penser des approches pédagogiques souples, adaptées aux besoins spécifiques de ces publics, et qui articulent encore davantage apprentissage linguistique et inclusion sociale », nous dit la formatrice.
Un point d’ancrage à trouver
L’accueil et l’accompagnement des primo-arrivants peu ou pas scolarisés en Belgique francophone révèlent des tensions entre cadre institutionnel et besoins réels des publics concernés. Si les dispositifs existants offrent un parcours structuré incluant un apprentissage linguistique, un accompagnement social et une formation citoyenne, ils se heurtent à des limites importantes : délais d’attente, rigidité des parcours et parfois l’inadéquation entre le temps institutionnel et le temps nécessaire à l’apprentissage. Les professionnels interrogés soulignent l’importance d’une approche plus souple et mieux adaptée à ces publics en mettant en avant les initiatives déjà présentes sur le terrain actuellement et dont le secteur pourrait s’inspirer. Dès lors, on peut se demander : comment repenser ces dispositifs pour qu’ils soient à la fois accessibles, flexibles, et en tenant compte de la diversité des situations individuelles des apprenants ?
- Jacobs, D., & Rea, A., The end of national models? Integration courses and citizenship trajectories in Europe, dans International Journal on Multicultural societies. 9, N°2, 2007, p. 264-283.
- Rea, A., L’étude des politiques d’immigration et d’intégration des immigrés dans les sciences sociales en Belgique francophone, dans Martiniello, M. & Rea, A. (dir.), Immigration et intégration en Belgique francophone, Bruxelles, De Boeck, 2007.
- Parcours d’intégration en Wallonie (https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=) ; Parcours d’accueil pour primo-arrivants à Bruxelles (https://etaamb.openjustice.be/fr/ordonnance-du-20-juillet-2023_n2023044135.html) et Inburgering en Flandres (https://codex.vlaanderen.be/zoeken/document.aspx?DID=1023121¶m=inhoud)
- Les décrets bruxellois et wallon définissent un primo-arrivant comme une personne étrangère de 18 ans et plus, séjournant légalement en Belgique depuis moins de 3 ans et possédant un titre de séjour en règle de plus de 3 mois. Le projet bruxellois précise que ne seront concernées que les personnes de plus de 18 ans et le projet wallon que seront exemptés les citoyens — et leur famille — d’un État membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen et de la Suisse.
- https://bewelcome.brussels/fr/groupe-cible/
- https://lire-et-ecrire.be/Position-de-Lire-et-Ecrire-sur-les
- BAPA : Bureau d’accueil pour primo-arrivants. Il existe actuellement 3 bureaux d’accueil pour la région bruxelloise : VIA, BAPA-BXL et CONVIVIAL (https://bewelcome.brussels/fr/bapa/)
- CRI : Centre régional d’intégration. En Wallonie, il en existe huit, répartis sur tout le territoire de la Wallonie.
- https://www.cricharleroi.be/parcours-dintegration/
- https://bewelcome.brussels/fr/bapa/
- « La méthode appliquée à la formation est celle de la démarche interculturelle en favorisant les échanges et les croisements entre les pratiques d’ici et d’ailleurs », (https://www.cricharleroi.be/parcours-dintegration/)
- https://www.via.brussels/. Auparavant, les conventions en Wallonie étaient également de 18 mois mais, depuis le 1er janvier 2025, les primo-arrivants disposent de 3 ans pour effectuer leur parcours (https://www.droitsquotidiens.be/fr/actualites/parcours-dintegration-en-wallonie-quelques-changements)
- Depuis décembre 2023, la Belgique francophone dispose d’une nouvelle nomenclature permettant d’orienter les adultes en formation vers des dispositifs de formations dont les méthodes d’apprentissages correspondront à leur profil. Ainsi, nous sommes intéressés à une partie de ce public, les adultes infra-scolarisés. Selon la nouvelle nomenclature, les adultes infra-scolarisés sont des adultes qui ne maîtrisent pas les langages fondamentaux (oral, lecture, écriture et calcul) et savoirs de base équivalents au CEB dans aucune langue (https://alphabetisation-adultes.be/page-1/lalphabetisation-en-belgique-francophone)
- Le niveau recommandé par les prescrits institutionnels, dans le cadre de ces parcours, est le niveau A2 du Cadre Européen commun de référence pour les langues. Le niveau A2 est également le niveau exigé pour prétendre à l’introduction de son dossier en vue d’obtenir la nationalité belge.
- En Wallonie, avant le 01/01/2025, les formations à la citoyenneté étaient déclinées en deux modalités : l’une destinée aux personnes ayant le niveau A2 oral acquis ; celle-ci était appelée Formation à l’intégration citoyenne et pour les personnes n’ayant pas le niveau A2 oral acquis, les Ateliers d’Orientation Citoyenne. A Bruxelles, les bureaux d’accueil prennent eux-mêmes des initiatives en proposant des formations dites en « français facile » pour des personnes ayant le niveau A2 à l’oral.
- Les formateur·rice·s en citoyenneté dans le cadre du parcours pour primo-arrivants doivent justifier d’une formation spécifique dispensée par le Centre Bruxellois d’Action Interculturel pour Bruxelles (https://www.cbai.be/formations/fofoci/) ou par un Centre Régional d’Intégration (https://discri.be/formations-des-cri/)
- http://www.aslweb.fr/asl-menu/
- Godenir A. et Storme A., Intégration et maîtrise de la langue dans la perspective du nouveau décret de la Région wallonne, dans Journal de l’alpha « Maîtrise de la langue et intégration », n°196, Lire et Ecrire Communauté française, p. 65.