Chaque ouvrage présent dans notre centre de documentation constitue une manière de voir le monde et en propose une lecture bien précise. Qui plus est, notre fonds documentaire a été construit selon une grille de lecture particulière : celle des valeurs de l’éducation populaire. Depuis ses 50 ans d’existence, il s’étoffe en fonction de ce qui semble pertinent, intéressant pour, d’une part, toutes personnes engagées dans des actions d’éducation permanente, d’autre part, pour toutes celles actives dans le secteur de l’alphabétisation. Comment dès lors, pour cette sélection, ne choisir que quelques documents parmi les plus de 12.800 qui composent notre catalogue en ligne et couvrent les rayonnages de notre bibliothèque ? Il suffirait peut-être de les sélectionner au hasard, les yeux fermés, en arpentant les rayons…
Pour autant, cette sélection bibliographique, bien qu’éclectique, n’est pas le fruit du hasard. Car, malgré le regard, que tout document pourrait offrir, sur un morceau du tout que forme le monde, ces années de veille documentaire montrent, notamment, que ce ne sont pas nécessairement les propos les plus récents qui sont les plus éclairants. J’insiste sur ce fait face au présentisme et au jeunisme actuels qui ont tendance à imposer le « faisons table rase du passé », de ses idées comme de ses acteur·rice·s, également pour contrer la tendance à se référer à la modernité apparente des ouvrages. Méfions-nous de ce qui nous parait moderne ou, à l’inverse, de ce qui parait dépassé, mise en page comprise. Les couleurs criardes peuvent cacher du morne et du désuet comme le terne peut contenir du vivant et de la nouveauté. C’est ainsi que pour comprendre le monde d’aujourd’hui, des ouvrages d’un passé proche ou lointain peuvent se montrer judicieux.
Aussi, de nombreuses démarches, réflexions et théories philosophiques, sociologiques, politiques, pédagogiques, issues de courants de pensées progressistes ont été publiées durant les décennies, voire les siècles passés. Elles sont pourtant, parfois, peu lues, connues, peut-être même comprises, en tout cas toujours trop dérangeantes pour l’ordre établi, celui construit sur les inégalités en tous genres.
Afin de s’outiller pour mieux comprendre le monde, la documentation choisie ici rassemble divers·e·s auteur·rice·s, des historien·ne·s, sociologues, pédagogues, écrivain·e·s, journalistes… : Jean Ziegler, Titiou Lecoq, David Van Reybrouck, Eduardo Galeano, Monique et Michel Pinçon-Charlot, Étienne Lécroart, Anne Morelli, d’autres encore. Elle est bâtie sur plusieurs critères.
Le premier consiste à proposer des pistes pour penser et combattre les inégalités mondiales car « oui, tout est lié, voyez-vous. C’est bien la même histoire. Il n’y en a qu’une seule, malheureusement contée par ceux qui en sont sortis riches. Plus rarement racontée du point de vue de ceux qui en ont payé le prix. Tout est donc lié. »[i] Le deuxième se base sur l’actualité du contenu, non pas en termes de date de publication mais de force novatrice de la pensée proposée face aux défis d’aujourd’hui. Et le dernier critère se soucie du pouvoir de la création artistique, littéraire.
Cette sélection se termine par la présentation de documents qui proposent des démarches pédagogiques, choisis parmi de nombreux autres que l’on peut trouver à notre centre de documentation et vers lesquels nous vous orienterons volontiers selon la ou les thématiques que vous souhaitez aborder avec vos groupes.
¶
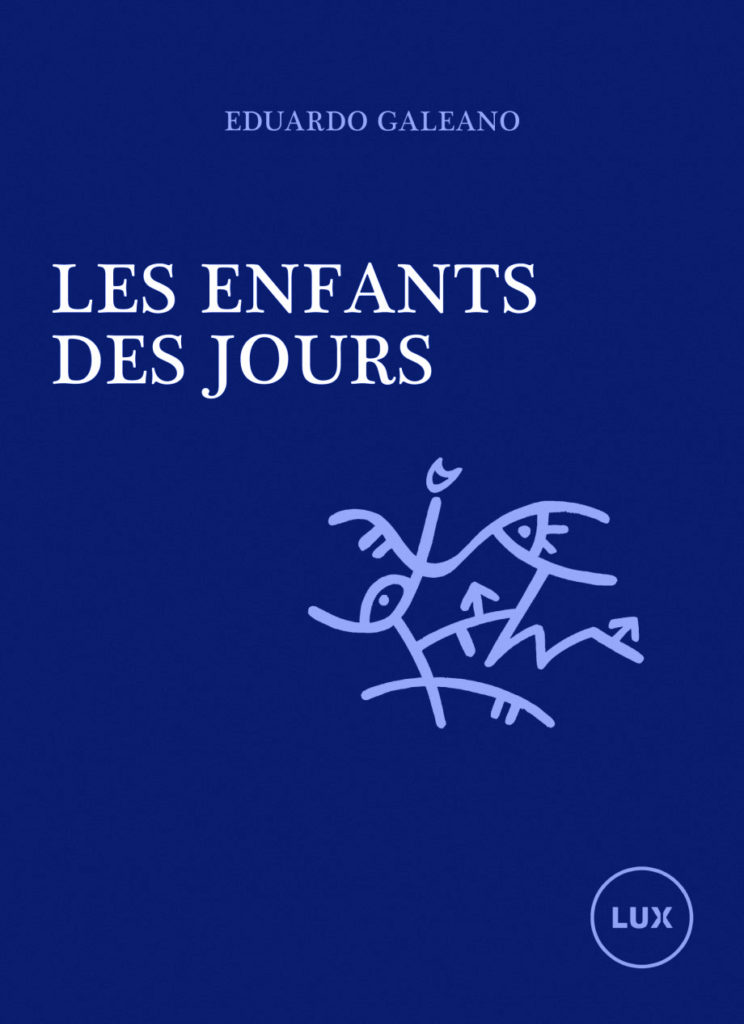
Eduardo Galeano, Les enfants des jours. Un calendrier de l’histoire humaine, Lux, 2016, 412 p.
« Chaque jour a une histoire à raconter. » Ce livre est une forme de « calendrier de l’histoire humaine ». Faisant fi des frontières et du temps, chaque page raconte une histoire tirée de la longue biographie de l’humanité. L’ensemble forme un livre des jours, pour ne pas oublier et pour apprendre à trier le bon grain de l’ivraie dans l’étourdissante succession des événements du passé.
Mosaïste chevronné, Eduardo Galeano nous livre 366 instantanés qui rendent hommage à des anonymes ou ressuscitent héroïnes et héros effacés. Afin que demain ne soit pas juste un autre nom pour aujourd’hui.
Comme ici :
« 15 janvier. En 1919, la révolutionnaire Rosa Luxembourg fut assassinée à Berlin.
Ses assassins la brisèrent à coup de crosse et la jetèrent dans les eaux du canal.
En chemin, elle perdit l’une de ses chaussures.
Une main ramassa cette chaussure, abandonnée dans la boue.
Rosa voulait un monde où la justice ne serait pas sacrifiée au nom de la liberté ni la liberté sacrifiée au nom de la justice.
Chaque jour, une main ramasse ce drapeau.
Abandonné dans la boue, comme la chaussure. »
Les textes de l’auteur témoignent aussi de la poésie de son écriture et de l’intérêt de penser le monde et l’Histoire dans sa globalité et depuis la diversité terrienne.
¶
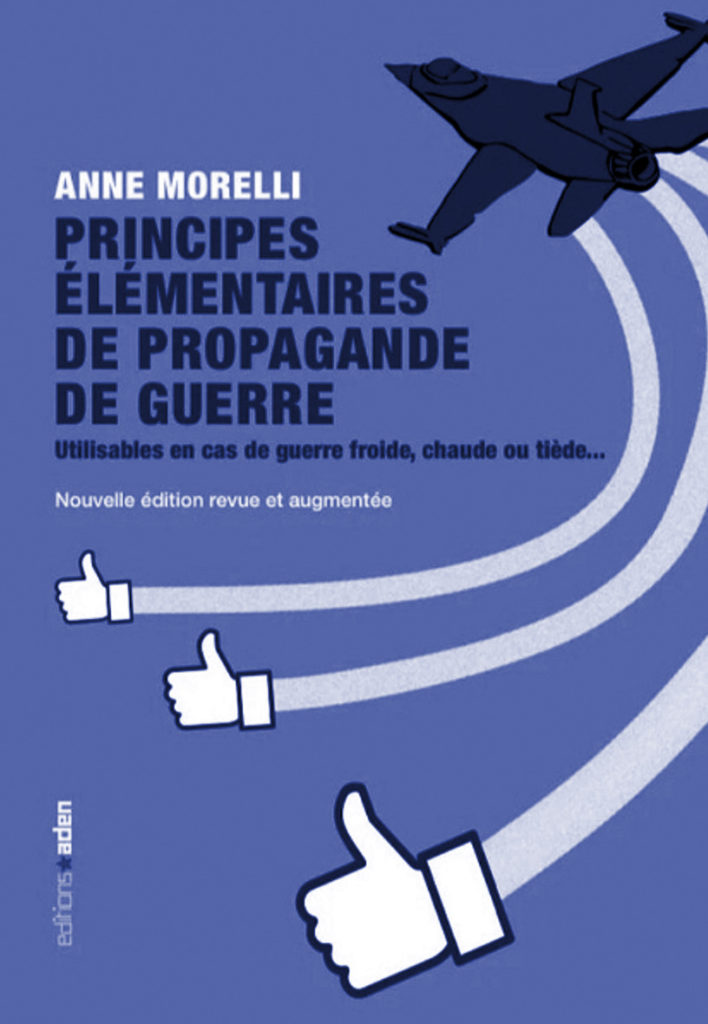
Anne Morelli, Principes élémentaires de propagande de guerre. Utilisables en cas de guerre froide, chaude ou tiède…, Aden, 2023 (nouvelle édition revue et augmentée), 185 p.
Y a-t-il moyen de nous faire approuver une guerre qui, à l’origine, ne nous intéresse pas ou que nous désapprouvons ? Les dix principes de propagande de guerre décrits dans ce livre montrent comme cela devient possible, régulièrement et avec efficacité, pour tous camps, à l’aide de leurs « services de communication ».
Pour ce faire, Anne Morelli s’est inspirée du livre du travailliste britannique Arthur Ponsonby, Falsehood in Wartime, écrit à la suite de la Première Guerre mondiale et paru en 1928, qu’elle réactualise et systématise :
1 Nous ne voulons pas la guerre.
2 Le camp adverse est le seul responsable de la guerre.
3 L’ennemi a le visage du diable.
4 C’est une cause noble que nous défendons et non des intérêts particuliers.
5 L’ennemi provoque sciemment des atrocités ; si nous commettons des bavures, c’est involontairement.
6 L’ennemi utilise des armes non autorisées.
7 Nous subissons très peu de pertes ; les pertes de l’ennemi sont énormes.
8 Les artistes et intellectuels soutiennent notre cause.
9 Notre cause a un caractère sacré.
10 Ceux qui mettent en doute la propagande sont des traîtres.
¶

Monique et Michel Pinçon-Charlot, Étienne Lécroart (illustr.), Pourquoi les riches sont-ils de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres ?, La ville brûle, 2018 (nouvelle édition actualisée et complétée), 63 p.
Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon, sociologues passés maîtres dans l’art de décortiquer les inégalités, proposent ici une édition complétée et actualisée de leur petit manuel de pensée critique. Avec clarté, pédagogie et humour, ils expliquent les mécanismes et les enjeux du monde social. Cette opération de dévoilement a pour ambition de permettre aux jeunes et aux moins jeunes de dépasser le stade du ressenti pour accéder à la compréhension des déterminismes sociaux qui entrent en jeu : les riches, les pauvres oui, c’est injuste… mais pas seulement !
Pourquoi les riches sont-ils toujours plus riches et les pauvres toujours plus pauvres ? s’attaque aux mécanismes de la domination sociale. Qu’est-ce qu’une classe sociale ? À quoi reconnaît-on les riches ? Que font-ils avec leur argent et pourquoi ne le partagent-ils pas avec ceux qui manquent de tout ? A-t-on besoin des riches ? Dans cet ouvrage, 20 questions, croquées avec finesse et humour par l’illustrateur Étienne Lécroart, rendent compte d’une réalité sociale complexe pour aiguiser l’esprit critique et donner l’envie de changer le monde.
¶

David Van Reybrouck, Nous colonisons l’avenir, Actes Sud, 2023, 46 p.
« L’humanité aborde le prochain siècle sans pitié aucune, avec la même avidité et la même myopie qui lui ont permis autrefois de s’approprier des continents entiers. Le colonialisme s’inscrit désormais dans le temps, et non plus dans l’espace ; le pire n’est peut-être pas derrière nous, mais devant nous. Nous nous comportons en effet en colonisateurs des générations futures. Nous les privons de leur liberté, de leur santé, peut-être même de leur vie – tout comme les colonisateurs l’ont fait par le passé. Nous spolions nos petits-enfants, nous dévalisons nos enfants, nous empoisonnons notre progéniture. »
Dans ce plaidoyer en faveur de la justice climatique, David Van Reybrouck propose des solutions politiques aptes à renouveler la vie démocratique. Un constat sans appel qui se transforme en authentique leçon de résistance.
¶
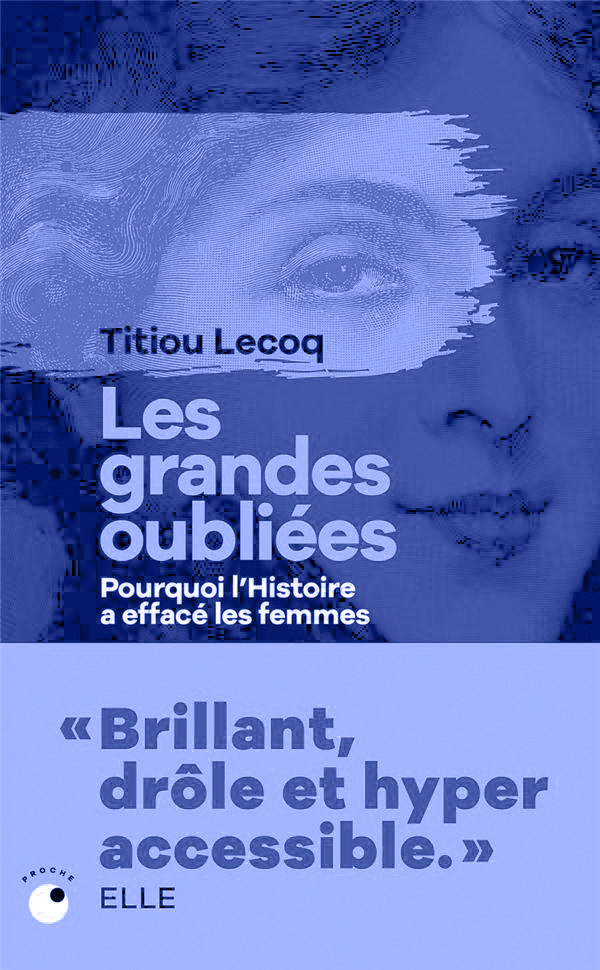
Titiou Lecoq, Les grandes oubliées. Pourquoi l’Histoire a effacé les femmes, L’Iconoclaste, 2021, 325 p.
De tout temps, les femmes ont agi. Elles ont régné, écrit, milité, créé, combattu, crié parfois. Et pourtant elles sont pour la plupart absentes des manuels d’histoire. « C’est maintenant, à l’âge adulte, que je réalise la tromperie dont j’ai été victime sur les bancs de l’école. La relégation de mes ancêtres femmes me met en colère. Elles méritent mieux. Notre histoire commune est beaucoup plus vaste que celle que l’on nous a apprise. »
Pourquoi ce grand oubli ? Suivant la ligne du temps, de l’âge des cavernes à nos jours, Titiou Lecoq s’appuie sur les découvertes les plus récentes pour analyser les mécanismes de cette vision biaisée de l’Histoire. Elle redonne vie à des visages effacés et raconte ces invisibles, si nombreuses, qui ont modifié le monde.
¶
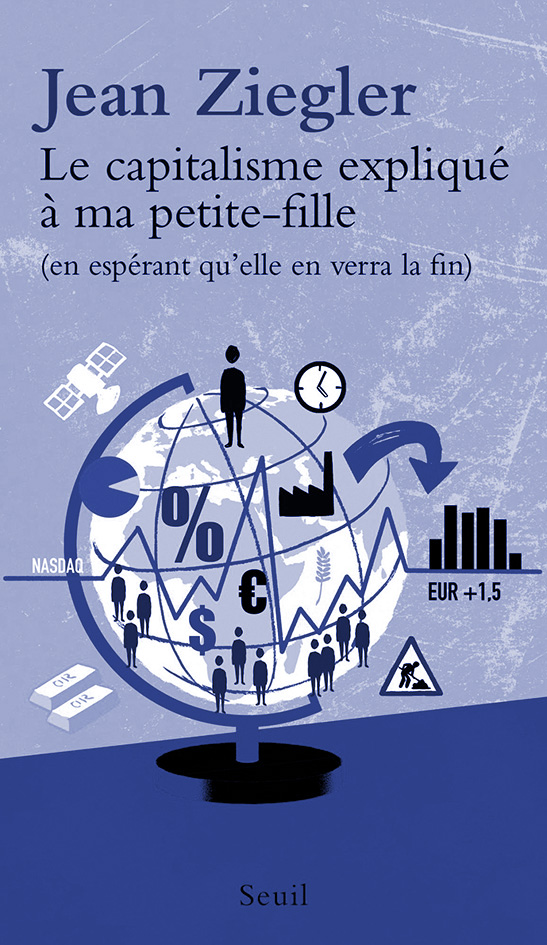
Jean Ziegler, Le capitalisme expliquée à ma petite-fille (en espérant qu’elle en verra la fin), Seuil, 2018, 115 p.
Le capitalisme domine désormais la planète. Les sociétés transcontinentales défient les États et les institutions internationales, piétinent le bien commun, délocalisent leur production où bon leur semble pour maximiser leurs profits, n’hésitant pas à tirer avantage du travail des enfants esclaves dans les pays qu’on désigne aujourd’hui comme « les moins avancés » (PMA). Résultat : sous l’empire de ce capitalisme mondialisé, plus d’un milliard d’êtres humains voient leur vie broyée par la misère, les inégalités s’accroissent comme jamais, la planète s’épuise, la déprime s’empare des populations, les replis identitaires s’aggravent sous l’effet de la dictature du marché. C’est avec ce système et l’ordre cannibale qu’il impose au monde que Jean Ziegler propose de rompre, au terme d’un dialogue subtil et engagé avec sa petite-fille.
¶

Raoul PECK, J’étouffe, Denoël, 2020, 48 p.
« Ce matin, en me levant… J’ai pleuré. Je pensais qu’un autre monde était possible, sans qu’on ait à mettre le feu partout. Maintenant je n’en suis plus sûr du tout. »
Dans ce texte publié initialement dans l’hebdomadaire Le 1, Raoul Peck, réalisateur et ancien ministre de la Culture de la République d’Haïti, dénonce le racisme systémique qu’il constate en France, fruit d’une histoire liée à l’essor du capitalisme et à la montée des inégalités sociales. « Car, comprenez-vous, le racisme brutal, laid, malveillant, n’arrive pas ainsi du vide. Il fait partie d’une histoire bien orchestrée. Une histoire qui commence dès le 11e siècle (….) »
¶
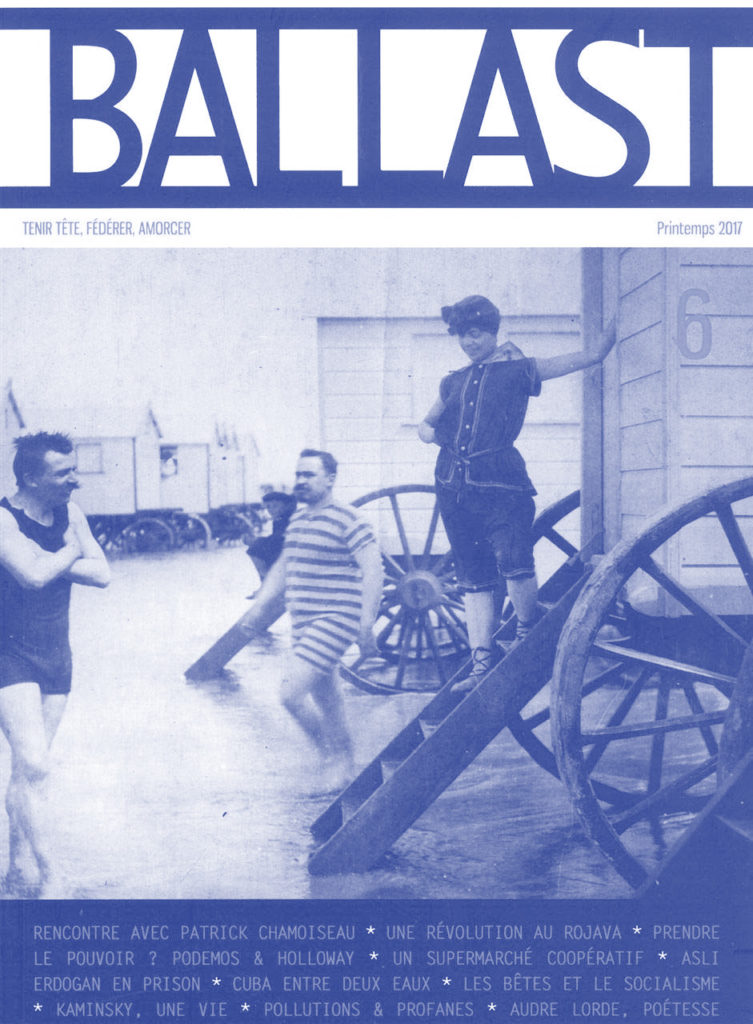
Rachid ZERROUKI, Freire, hooks, Freinet : les pédagogues révolutionnaires, in Ballast, n°6, Aden, printemps 2017, 8 p., www.revue-ballast.fr/freire-hooks
Un pédagogue brésilien engagé aux côtés des opprimés dans la lutte pour leur libération, une féministe afro-américaine théoricienne du black feminism, un instituteur communiste français concepteur d’une pédagogie coopérative et émancipatrice : c’est fort de ce tour d’horizon que l’auteur, professeur des écoles, jure dans cet article qu’il est possible d’« enseigner en allumant des feux plutôt qu’en remplissant des vases ».
¶
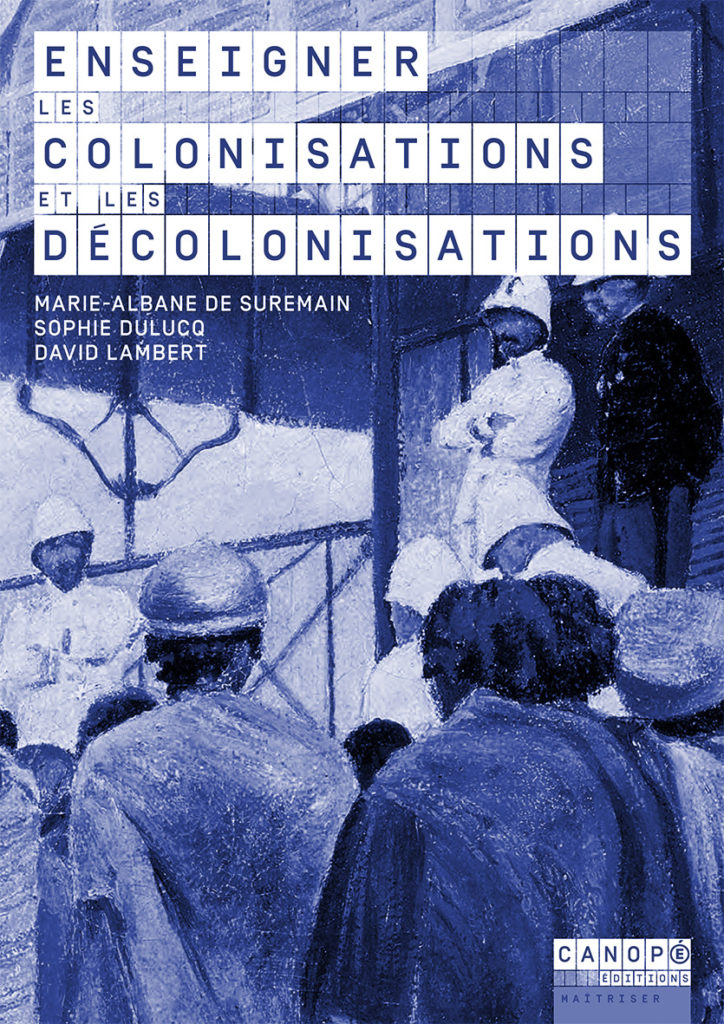
Marie-Albane DE SUREMAIN, Sophie DULUCQ et David LAMBERT, Enseigner les colonisations et les décolonisations, Réseau Canopé, 2016, 280 p.
Faire connaître l’histoire des colonisations et des décolonisations, comprendre une question sensible et proposer des outils pour aborder de manière sereine cette problématique, tel est l’objectif de cet ouvrage qui propose :
- des mises au point scientifiques par thèmes rendant compte des dernières recherches historiques ;
- une approche au plus près des sociétés coloniales restituant la diversité des acteurs – colonisés et colons – ainsi que la complexité de la situation coloniale ;
- des dossiers documentaires (textes, cartes, photographies, etc.), assortis de présentations scientifiques et proposant des pistes d’utilisation pédagogique adaptées à différents niveaux de classe.
¶

CNCD (coord.), [In]égalités mondiales. Mallette pédagogique 15+, CNCD, 2023 (nouvelle édition augmentée)
Cette mallette pédagogique, conçue pour les professionnels de l’éducation, de la formation et de l’animation, propose une diversité d’outils pédagogiques pour aborder les enjeux du système-monde actuel : en tout, 21 outils pédagogiques conçus par une quinzaine d’associations et classés selon une trame narrative y sont rassemblés.
La mallette contient également un guide pédagogique qui permet de s’approprier la thématique ainsi que chacun de ces différents outils. La première partie fournit toutes les informations nécessaires à la compréhension des mécanismes à la base des inégalités – qu’elles soient fondées sur la domination économique, raciale ou de genre –, de leurs impacts et à l’identification des leviers à actionner pour lutter efficacement pour un monde plus égalitaire pour toutes et tous. La seconde partie propose des pistes pédagogiques. Un tableau des concepts, compétences et thématiques permet de trouver l’outil le plus adapté au sujet sur lequel on souhaite travailler. Des fiches-outils apportent les informations techniques spécifiques à chacun des 21 supports pédagogiques.
La mallette est également conçue pour l’utilisation de plusieurs outils complémentaires dans un trajet commun d’animation.
- Raoul PECK, J’étouffe, Denoël, 2020, texte de 4e de couverture.