Pour faire état des pratiques de lecture en Belgique, la question posée par Statbel, l’office belge de statistique, est : « Avez-vous lu des livres au cours de ces 12 derniers mois, y compris des livres électroniques et des livres audio ? ». Les personnes n’ayant pas lu (ou écouté) de livre, sont considérées comme non lectrices1. Le contenu de la question est un indicateur d’une représentation de ce qu’est lire. Elle rejoint ces assertions qui traversent l’imaginaire collectif : « Untel ne lit pas, mis à part les journaux. », « Lire uniquement des BD n’est pas lire, une BD n’étant pas un « vrai » livre », etc… Elle montre également l’illusion de modernité ou d’ouverture que peut prendre une vision quand on y ajoute une dimension numérique. Cette formulation permet aussi de souligner à quel point la question des pratiques de lecture est intimement liée à celle des supports. Comme toute pratique culturelle, elle fait appel aux représentations et/ou aux vécus que les groupes sociaux en ont et fait partie des signes de distinction sociale. On peut se référer, par exemple, à l’expression « roman de gare ». Bien qu’elle évoque le livre, support de lecture le plus valorisé, elle exprime à elle seule le mépris pour des textes de fiction qui se lisent « facilement », et qui ont un succès populaire (achetés, lus, appréciés par un grand nombre de personnes).
Dans un centre de documentation dédiée à l’alphabétisation, nous ne préjugeons ni pour les apprenant.e.s ni pour leurs formateur·rice·s des types de supports écrits à privilégier dans les formations. Nous ne mettons pas en exergue « une manière de vivre »2. Notre rôle est avant tout, d’être attentif.ve.s à proposer les nombreux mondes, cheminements, formes d’expressions, sources d’informations qui s’offrent et/ou s’imposent à nous dans un langage écrit. Contes, textes de théâtres, poésie, albums, BD, romans en tous genres, articles de journaux, de magazines, recettes de cuisine, modes d’emploi, documents administratifs, essais, livres d’histoire, d’apprentissage, cartes géographiques, sms,…tous sont des écrits issus de la diversité des pratiques de communication et de création qui traversent les individus et les groupes sociaux. Nous ne pouvons ainsi décider d’autorité et dans l’absolu ce qui serait « la » pratique « indispensable » pour tous les groupes d’adultes en alphabétisation. Les exigences d’un contexte sociétal et institutionnel, les situations de vie, les centres d’intérêts et les sources de plaisir des personnes, seront autant de critères pour répondre à la question : parmi toutes les pratiques de lecture, en tenant compte du groupe en particulier auprès duquel la formation est donnée, à quel moment développer quelle(s) pratique(s) ? Quels sont les apprentissages qui y mèneront ? Quels supports sont à privilégier ?
C’est ainsi que lorsqu’on parle de pratiques pédagogiques qui favorisent ou ne favorisent pas l’accès à la lecture, il serait intéressant de préciser quelle(s) pratique(s) de lecture sont visées. L’apport d’Evelyne Charmeux à ce sujet est salutaire : « On peut dire qu’une personne sait lire, lorsqu’elle est devenue capable de trouver, dans un écrit, les réponses aux questions qu’elle
se posait avant de lire, ou des solutions aux problèmes qu’elle rencontrait dans la réalisation de ses projets. (…) Or, les situations qui nécessitent de la lecture sont diverses, fort nombreuses, et les objets qu’on y utilise demandent des manipulations différentes. (…) Il faut apprendre EN SITUATION avec les outils correspondants, le journal pour apprendre à lire la presse, les manuels de maths et sciences pour pouvoir s’en servir, des BD pour découvrir qu’elles ne se lisent pas comme les contes dans les livres, etc. Rien à voir avec la question des « méthodes », querelle stérile, s’il en est. Apprendre à lire est une affaire de contenus d’enseignement, et non de méthodes. Le déchiffrage n’est pas la lecture ; il en gêne l’acquisition. C’est la lecture qu’il faut enseigner »3.
Autour d’Evelyne Charmeux, les invitations qui suivent, à penser les pratiques de la lecture, sont l’œuvre de sociologues, psycholinguistes, chercheur·euse·s-praticien·ne·s en sciences de l’éducation, didacticien·ne·s, pédagogues, formateur·rice·s. Ils, elles interrogent les définitions de ce qu’est l’écrit en général, la lecture en particulier et abordent les questions des pratiques pédagogiques et, pour certain·e·s proposent des démarches issues d’expériences menées dans des groupes en alpha.
¶

Chantal HORELLOU-LAFARGE, Monique SEGRE, Sociologie de la lecture, La Découverte, 2003, 130 p.
Ce livre dont la dernière édition date de 2016, retrace l’évolution des techniques de fabrication et de diffusion de l’écrit et de l’expansion de la capacité à lire de l’ensemble des groupes sociaux. Il cerne les contours et significations de cette pratique culturelle « pas comme les autres ». Il y est décrit la diversité sociale des usages de l’écrit et ses modes d’appropriation. Le chapitre 4 « Une pratique culturelle différenciée » traite, selon les catégories sociales et le genre, des lieux d’accès à la lecture, de la librairie à la bibliothèque en passant par le supermarché ainsi que des supports et des fonctions de l’écrit (se documenter, se divertir, …). Sans surprise sur le fait que les capitaux sociaux économiques et culturels influencent fortement et font de la lecture, un élément de distinction sociale, il est intéressant de trouver dans cet ouvrage une synthèse des comportements significatifs des différents groupes sociaux face au monde de l’écrit. Ces éléments sont autant d’indicateurs pour les formateur·rice·s sur leurs propres pratiques et celles des personnes en formation en alpha.
¶
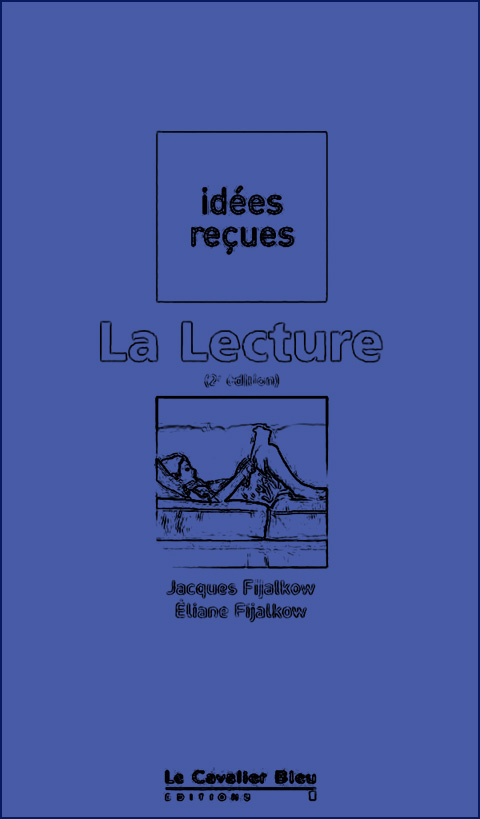
Jacques Fijalkow et Eliane Fijalkow, La lecture, Le Cavalier Bleu, collection « idées reçues », 2010, 128 p.
Dès la première page, cet ouvrage est une invitation à sortir des réponses simplificatrices. Il y est retracé les définitions de la lecture selon les époques et les acceptations qu’il en reste aujourd’hui : « D’une part celui d’une technique (…), d’autre part celui de la découverte et de l’interprétation d’un contenu (…). Un apprentissage réussi de la lecture suppose bien sûr la maitrise des deux ». Les autrices ont choisi de partir des idées reçues sur la lecture pour les déconstruire et les penser en s’appuyant sur la recherche dans les domaines pertinents (sciences de l’éducation, sociologie, psycholinguistique, etc…). Une série de 17 phrases, 17 prêt-à-penser, sont questionnées, certaines selon des aspects sociétaux, comme « Les gens ne lisent plus », d’autres sur les apprentissages de la lecture « Savoir lire, c’est être capable de lire oralement sa page de lecture ». Un dernier chapitre interroge le regard posé sur les personnes en apprentissage : « La lecture, un problème » et propose de se pencher sur ce qui est dit comme problèmes dans les apprentissages, notamment la dyslexie.
¶
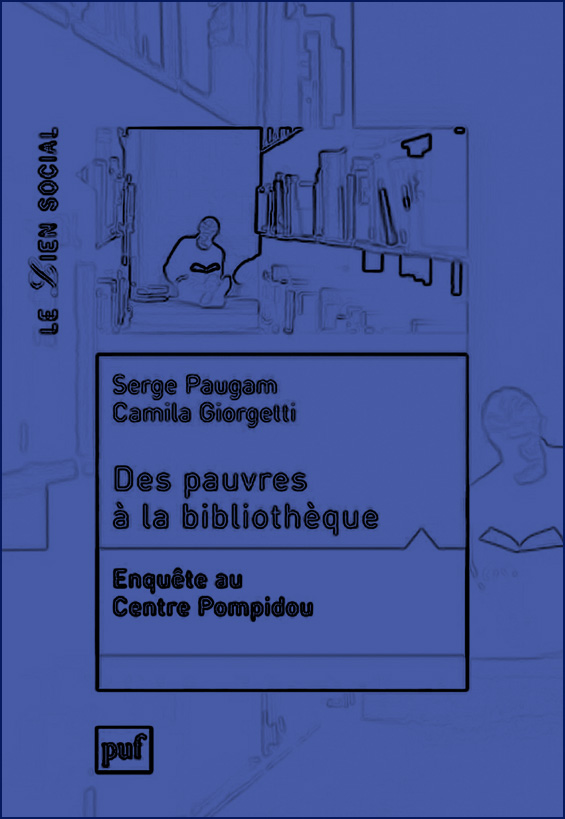
PAUGAM Serge, GIORGETTI Camila, Des pauvres à la bibliothèque : Enquête au Centre Pompidou, PUF, collection Le lien social, 2015, 186 p.
L’image de l’analphabétisme ou de l’inculture est souvent associée à la pauvreté. Il peut sembler aller de soi que les ‘pauvres’ sont peu disposés à fréquenter les bibliothèques ; il leur manquerait les ressources élémentaires pour se fondre dans un espace destiné au savoir et à la culture. Pourtant, ils sont présents dans les bibliothèques publiques et souvent beaucoup plus qu’on ne l’imagine. Ce constat prend la forme d’une énigme. Comment expliquer qu’ils les fréquentent alors que tout parait les condamner d’avance à y tenir une place marginale, à y être dévalorisés socialement ? En se fondant sur une enquête qualitative (observations, entretiens approfondis) réalisée à la Bibliothèque publique d’information du Centre Pompidou à Paris, ce livre permet d’établir une correspondance entre les trois phases de la disqualification sociale (fragilité, dépendance et rupture) et des usages spécifiques de la bibliothèque correspondant à des attentes particulières, des relations contrastées avec les autres usagers et un rapport aux normes de la bibliothèque lui aussi différencié. Fréquenter une bibliothèque est pour les ‘pauvres’ un moyen de constituer et de renforcer leurs liens sociaux et, par là-même, de conjurer le processus de disqualification sociale.
¶
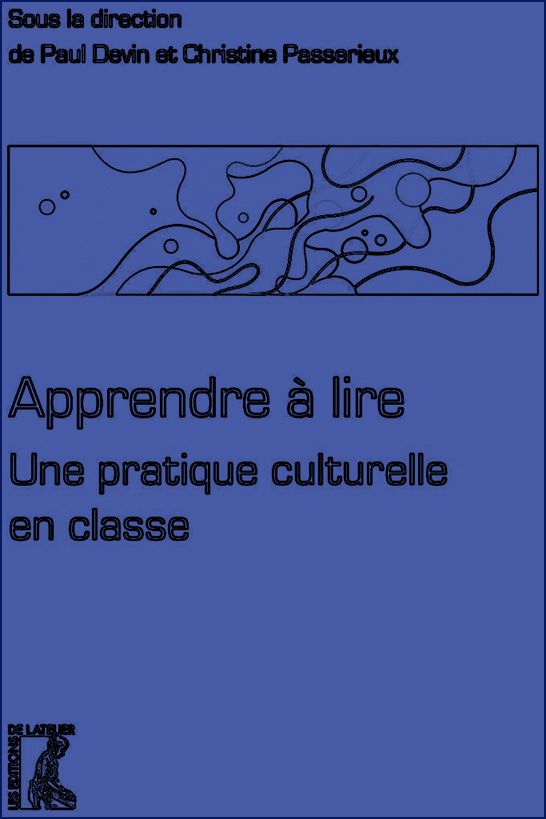
PASSERIEUX Christine et DEVIN Paul (Sous la direction de) Apprendre à lire : Une pratique culturelle en classe, Editions de l’Atelier, 2021, 140 p.
« On pouvait raisonnablement penser disposer d’un cadre favorable au développement des compétences des enseignant.e.s qui affirmerait clairement que la réussite des élèves, en matière de lecture, ne pouvait s’accommoder ni de l’absence d’un enseignement structuré du code, ni de sa suprématie aux dépens des autres compétences nécessaires, celles liées à la compréhension des écrits et au développement de leur usage culturel ». Ce cadre n’a pourtant jamais existé car, comme le titre du premier chapitre, écrit par Paul Devin, l’indique : les « querelles, polémiques autour de l’enseignement de la lecture » empêchent « le consensus ». L’auteur retrace l’histoire de ces polémiques, les courants de ces dernières décennies et comment s’est construit un faux débat, une dualité entre la méthode globale et la méthode syllabique où cette dernière l’emporte dans les textes officiels et les discours lambda au détriment des réelles questions et enjeux sociétaux, didactiques, pédagogiques qui sont développés dans les chapitres suivants dont celui écrit par Jacques Bernardin « L’entrée dans l’écrit, enjeu d’acculturation ».
¶

PETIT Michèle, L’art de lire ou comment résister à l’adversité, Editions Belin, Collection Nouveaux mondes, 2008, 317 p.
D’étonnantes expériences littéraires se multiplient dans des pays confrontés à des conflits armés, des crises économiques, des catastrophes naturelles. En Colombie, en Argentine ou au Brésil, enfants, adolescents et adultes qui, jusque-là, avaient vécu au plus loin des livres se rassemblent autour de mythes ou de légendes, de poésies ou de bandes dessinées. Ils s’en saisissent pour résister à l’adversité et préserver un espace de rêve et de liberté. Bien plus qu’un outil pédagogique, la lecture est alors une réserve où puiser pour donner sens à sa vie, la penser, imaginer d’autres possibles. L’apport vital de la lecture dans des temps de crises n’est plus le privilège des « lettré.e.s ». Celles et ceux qui animent ces cercles de lecteur·rice·s travaillent à quelque chose de bien plus vaste que le soin, qui est d’ordre culturel, éducatif et politique. Michèle Petit raconte ces pratiques et analyse leurs dispositifs.
¶
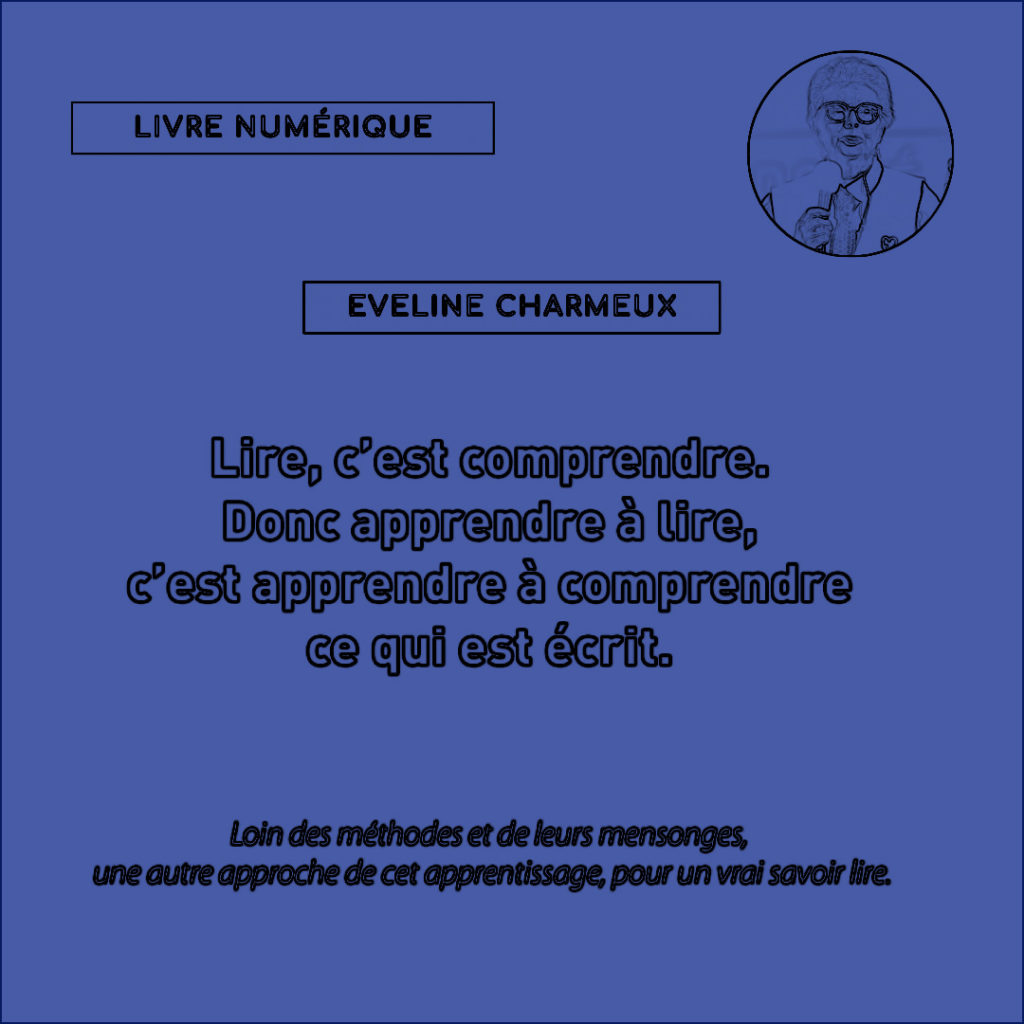
Eveline CHARMEUX, Lire, c’est comprendre, apprendre à lire, c’est apprendre à comprendre ce qui est écrit, SEDRAP, 2018
Dans une interview en ligne pour le Café pédagogique en 20184, Evelyne Charmeux parle elle-même de ce qu’elle entend dans son livre comme étant les pratiques de la lecture qui permettent d’apprendre à lire. Alors qu’on lui demande si elle défend la méthode globale, elle répond : « Pas du tout. Je montre dans mon livre une approche de la lecture qui n’a rien à voir ni avec la méthode globale ni avec la syllabique. Une méthode est forcément mauvaise car elle impose une démarche qui ne s’appuie pas sur les savoirs déjà là des enfants. Mon livre montre comment les enfants entrent dans l’écrit. Ma démarche invite à s’appuyer sur le connu des enfants. On part des écrits que les enfants connaissent, comme leurs chansons, pour regarder comment c’est écrit et créer du connu. On peut leur proposer de nouveaux textes comme des contes, ou des recettes de cuisine et les laisser les explorer et dire ce qu’ils reconnaissent. On voit ce que ça veut dire. A ce moment-là on regarde les mots quand on sait ce qu’ils veulent dire. On ne demande pas aux enfants de créer du sens sans avoir travaillé sur du signifiant. Apprendre à lire c’est découvrir une langue qui se voit et non qui s’entend. En français on ne prononce pas les lettres les plus importantes. » Même si Evelyne Charmeux parle d’enfants, nous pouvons tout à fait transposer ce qu’elle écrit au travail avec des adultes.
¶

Jean-François ROUET, Bruno GERMAIN, Isabelle MAZEL (Sous la direction de), Lecture et technologies numériques : Enjeux et défis des technologies numériques pour l’enseignement et les pratiques de lecture, Collection Lectures en jeu, Scérén- Canopé CNDP, 2006, 254 p.
Cet ouvrage propose une synthèse de la question de la lecture sur écran à partir des diverses recherches conduites dans différentes disciplines : psychologie, ergonomie, sémiologie. Il permet aux enseignant.e.s et formateur·rice·s, autant qu’aux utilisateur·rice·s novices, de se forger une opinion critique sur les apports et les nouveaux défis que posent les technologies numériques pour la lecture. Il rassemble d’une part des éclairages sur l’impact du numérique dans l’apprentissage et les pratiques de lecture, et d’autre part une réflexion sur la mise en œuvre de la compréhension et de l’usage de l’information. Il développe une étude critique approfondie des principaux logiciels d’entrainement à la lecture, accompagnée d’une grille d’analyse visant à aider les formateur·rice·s à exploiter au mieux ces outils. Il présente également des ressources pour les démarches de recherche-action, ainsi que des recommandations qui s’adressent tant aux praticien.ne.s des technologies numériques qu’aux concepteur·rice·s d’outils.
¶
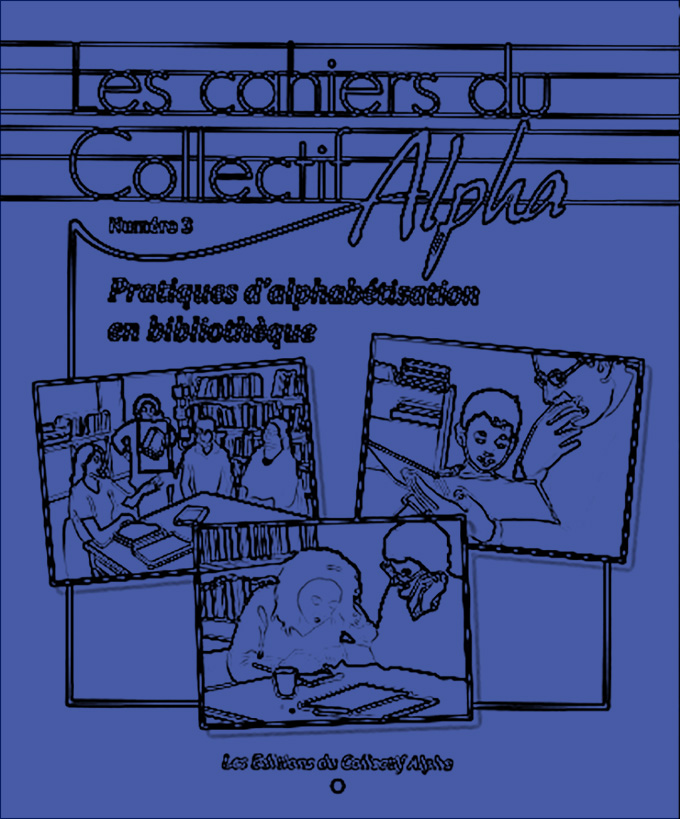
Frédéric MAES, (Sous la direction de), Pratiques d’alphabétisation en bibliothèque, Les cahiers du Collectif Alpha, numéro 3, 2018, 70 p.
Sous ce titre se dévoilent plusieurs projets menés par le Collectif Alpha avec différentes bibliothèques publiques. Leur point commun : amener des apprenant.e·s, des adultes peu ou pas scolarisés, à se familiariser avec la lecture, appelée par ses auteur·rice·s, « plaisir » dans ces lieux de découverte et de partage que sont les bibliothèques. Ces projets visent à « ouvrir des portes vers une culture de l’écrit qui dépasse l’acte technique du déchiffrage ou de la recherche d’une information utilitaire précise, dans l’espoir que cela participe à des changements profonds, changements de pratique et d’image de soi ». Le premier projet met l’accent sur la relation qui se noue autour des livres entre les parents et leurs tout jeunes enfants. Le second favorise la rencontre par paires entre un.e bénévole passionné.e de livres et un.e apprenant.e en alphabétisation. Le troisième projet, enfin, amène le groupe à découvrir le livre sous toutes ses coutures et à réfléchir sur l’acte de lire. Il développe la complémentarité entre le travail de bibliothécaire et celui de formatrice et formateur en alphabétisation.
¶
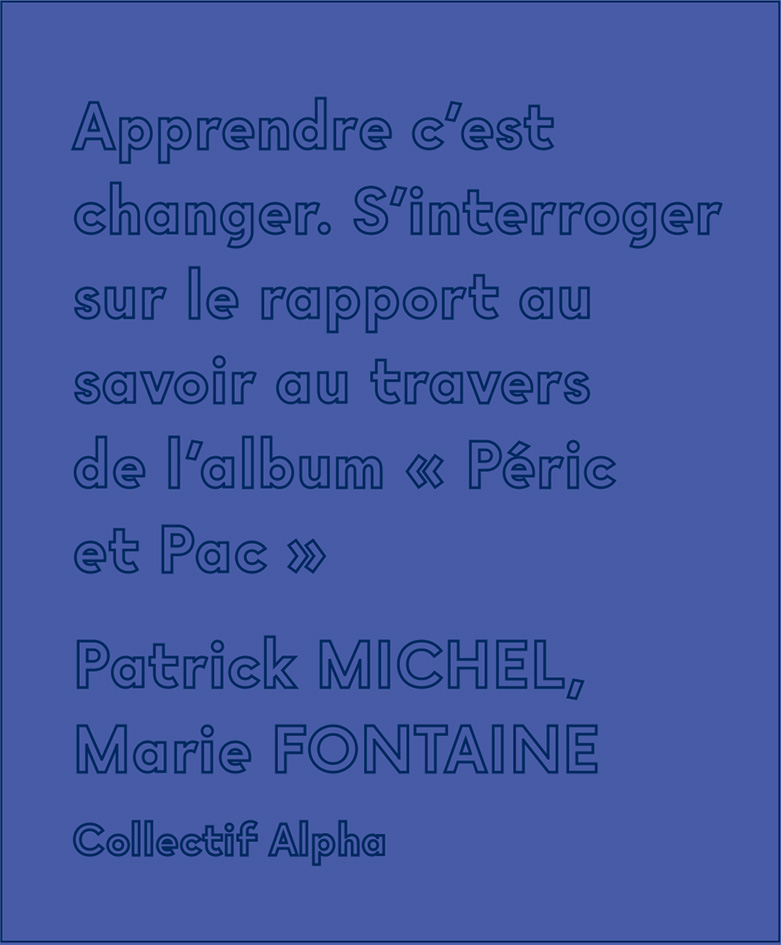
Patrick MICHEL, Marie FONTAINE, Apprendre c’est changer. S’interroger sur le rapport au savoir au travers de l’album « Péric et Pac », Collectif Alpha, 2016
« 1001 escales sur la mer des histoires : 52 démarches pédagogiques pour apprendre (et aimer) les livres » ; « Du sens au signe, du signe au sens : une méthode intégrative pour apprendre à lire et devenir lecteur à l’âge adulte » font partie des ouvrages de référence aujourd’hui en alphabétisation, écrits par Patrick Michel. Il en a publié de nombreux autres tout aussi riches de démarches et réflexions pour nos pratiques autour de l’apprentissage de la lecture en alpha. Pour cette sélection, j’ai choisi de mettre en avant, un document qui est peut-être moins connu, dans lequel il fait part d’une démarche proposant deux axes de travail. Il y est décrit comment entrer dans la lecture avec un album, à priori destiné à des enfants, mais aussi et surtout comment amener les apprenant.e.s à se questionner sur leur processus d’apprentissage, et les transformations que celui-ci occasionne chez eux.elles, tant au niveau de leur identité que de leur rapport aux autres, au monde et au savoir. Ce livre a été transformé par Marie Fontaine en planches format Kamishibaï pour être exploitable selon cette pratique de lecture collective d’origine japonaise, intéressante à découvrir en alpha.
- https://statbel.fgov.be/fr/search search_api_fulltext_block=SILC+2022.
- Expression empruntée ici à Evelyne Charmeux pour décrire ce qu’est « lire », tirée d’un ouvrage qui sera repris dans la sélection bibliographique.
- https://cafepedagogique.net/2014/09/05/e-charmeux-non-dechiffrer-n-est-pas-lire-2/.
- https://cafepedagogique.net/2018/07/11/eveline-charmeux-lire-c-est-comprendre/