Cette sélection bibliographique invite, dans un premier temps, à questionner les notions de territoire, de culture et de langue. Les premiers ouvrages proposés sont des tentatives de décrire les réalités que recouvrent deux termes souvent opposés : francophone et non-francophone. Les documents suivants mettent en lien les notions de langue et de culture. Ils mettent également en lumière la nécessité de l’accueil, de l’altérité et de l’ouverture à la force créatrice de la rencontre. Ils sont suivis de pistes pédagogiques de différentes natures : des réflexions sur l’apprentissage de la langue orale et de la langue écrite, d’autres sur les approches spécifiques avec de nouveaux arrivants dans un espace culturel donné. Des exemples de démarches sur des thématiques fréquentes dans une approche pragmatique sont ensuite partagés. Par ailleurs, pour sortir d’une vision scripto-centrée des apprentissages et de la focalisation sur l’apprentissage du code et du principe alphabétique, sont recensées des mallettes pédagogiques pour penser à la fois les parcours migratoires et les manières de faire culture commune dans le pays d’accueil.
Ces ouvrages de différentes natures soulignent la richesse de notre travail, mais aussi le fait qu’aucun manuel ou document ne répondra à lui seul à la complexité de l’alphabétisation pour adultes. Il est un champ spécifique avec ses propres défis pédagogiques, quelle que soit la maitrise du français oral des participants aux formations.
C’est d’abord avec une série d’atlas qu’il est proposé de s’emparer de la problématique de « l’alpha pour non-francophones », avec l’objectif de relever des critères qui permettraient de délimiter des espaces géographiques, des territoires de pensée ou encore des groupes humains. Des définitions et des cartes présentées dans l’Atlas des langues du monde peuvent constituer une première entrée pour se construire des représentations de qui appartient ou non au monde francophone. La pluralité des langues et des pratiques langagières à travers le monde, leur statut (de langues, dialectes, patois, jargons, créoles, pidgins), de même que leurs formes (selon qu’elles disposent d’un corpus écrit, oral, ou des deux) ont toujours dépendu d’enjeux principalement géopolitiques. Le français est classé, parmi la douzaine de langues majeures à travers le monde, comme une des langues « supercentrales » (p. 36). Apprendre, à des personnes venant d’ailleurs, une langue dominante n’est donc pas qu’une question linguistique et didactique. Nous sommes les héritiers de l’histoire de la langue que nous enseignons. Les relations de pouvoir auxquelles nous sommes vigilants en éducation populaire sont d’autant plus présentes en alphabétisation avec des personnes dont le français n’est pas la langue maternelle.
Plus précisément, l’Atlas des mondes francophones met en évidence la difficulté de circonscrire des mondes physiques, culturels ou encore linguistiques. Parmi ces tentatives de classement, le nombre de locuteurs, malgré les difficultés de recensements, est souvent utilisé. On peut observer la variété des nombres avancés : 90 millions de francophones, 300 millions ou encore 700 millions ! « Les définitions de la qualité de francophone sont très différentes selon la manière dont on croise le critère de l’origine (le français est-il une langue maternelle ou seconde ?), le critère de la maitrise (partielle ou complète ?) et le critère de la fréquence de l’utilisation de la langue (circonstanciel ou constant). » (p. 12). Cet Atlas des mondes francophones montre ainsi la complexité des pratiques et des relations avec la langue française.
Alors que les politiques xénophobes se répandent de manière inquiétante à travers la planète, l’alpha pour non-francophones pousse aussi à s’interroger sur la manière dont on accueille les nouveaux membres d’une société et quelles transformations individuelles et collectives sont à l’œuvre et lesquelles sont attendues. Cette question replacée dans le contexte de formation qui est le nôtre devient : quelle est la place, dans les formations, des langues et des cultures d’origine des personnes qui composent les groupes en alpha ? Aussi, les définitions et visions de l’intégration et/ou de l’émancipation que l’on donnera serviront de cadre de pensée, dans lequel se construiront les approches pédagogiques. Dans une société pressée et oppressante, ces visions sont à mettre en lien avec l’exigence d’efficacité souvent mise en avant, mais peu définie. Une formation efficace dans une visée élitiste, c’est la compétition, l’exclusion des plus éloignés du modèle avancé par l’élite pour lui ressembler au plus vite. Une formation efficace dans une visée pragmatique, c’est la brièveté, le quotidien immédiat pour répondre aux urgences de vie ou de survie. Une formation efficace dans une visée conscientisante, c’est prendre le temps avec tous, de penser, de comprendre les injustices et de construire ensemble des formes d’expressions d’un monde plus solidaire.
¶
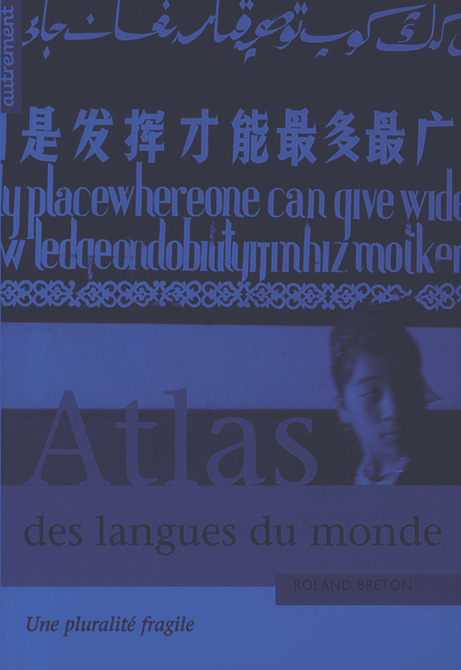
Roland Breton, Atlas des langues du monde, une pluralité fragile, Collection Atlas/Monde, Editions Autrement, 2003
Cet atlas, malgré sa date de parution, peut servir de support pour le·la formateur·rice qui chercherait à mieux cerner le concept de langue, à connaitre l’étendue des langues, parlées et des langues écrites à travers le monde. Il permet ainsi de découvrir les différentes langues des pays d’origine des participants et constitue donc une ressource pour mettre en valeur leur plurilinguisme courant, souvent ignoré ou peu valorisé.
Il met en évidence, dès son introduction, la continuelle variabilité des données quant au nombre de langues et l’étendue de leurs pratiques. « Les langues n’occupent aucun espace. Seuls les locuteurs et leurs institutions peuvent être localisés. » (Préface)
Il apporte également un éclairage sur les hiérarchies créées au fil de l’histoire entre langues orales et langues écrites, alors que ces dernières sont minoritaires : « Chaque langue, vivante ou éteinte, peut être étudiée par différentes disciplines : par la linguistique, dans sa structure interne propre, qui l’apparente plus ou moins à d’autres ; par la sociolinguistique, selon son usage dans les groupes humains et les institutions, par la géolinguistique, dans sa diffusion spatiale ; et par la démolinguistique, dans son poids numérique en locuteurs — tous aspects qui ne cessent d’évoluer. Mais, aux yeux du monde extérieur à ces spécialités, ce qui importe le plus pour une langue, c’est sa production culturelle : son corpus. Il s’agit de la somme théorique de toutes ses œuvres anciennes et nouvelles, écrites ou orales. (…) L’invention de l’écriture a abusivement mené beaucoup d’observateurs extérieurs à considérer les peuples s’exprimant par une langue « écrite » comme étant les seuls peuples historiques tandis que les langues « non écrites » étaient celles de « peuples sans histoire » (p. 41). À nous de ne pas reproduire cette hiérarchie dans notre approche des langues en présence dans les formations, tout en gardant à l’esprit que le français est une langue orale et écrite, que l’apprentissage de l’oral comme de l’écrit est indispensable.
¶
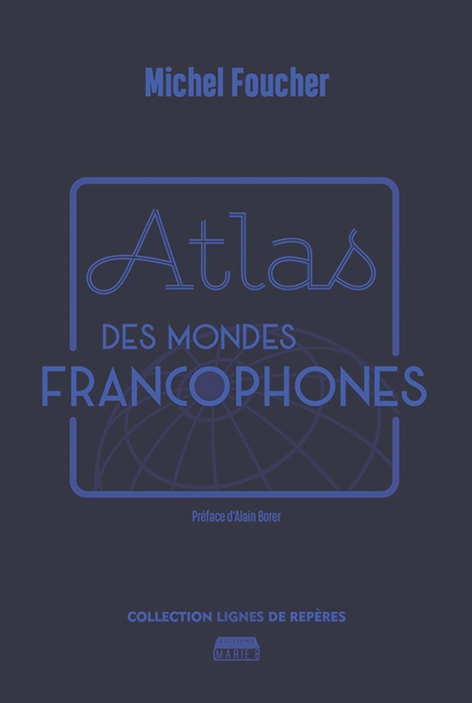
Michel Foucher, Atlas des mondes francophones, Collection Lignes de Repères, éditions Marie B, 2019
Cet atlas lève la confusion entre la francophonie (avec un petit f) et la Francophonie (avec un grand F). Cette dernière est une institution officielle connue sous le nom de l’OIF, Organisation internationale de la Francophonie qui rassemble aujourd’hui 93 États et gouvernements. « Selon l’usage courant, le terme de “francophonie” sans majuscule désignera un espace linguistique, de taille mondiale. La “Francophonie”1 avec une majuscule désigne l’ambition francophone au sens large de solidarité entre pays et peuples ayant le français en partage, ainsi que le système institutionnel qui organise les relations entre les pays francophones. » (p. 9).
Après avoir montré les différentes définitions et interprétations du terme francophone, cet ouvrage rassemble une diversité de cartes faisant état des présences francophones selon les régions du monde : Europe, zone Méditerranée-Golfe, Afrique subsaharienne, Asie, dans les Amériques. Cette partie, géographie de la langue française, est suivie de la partie Les mondes francophones dans laquelle les francophonies dites du Nord (c’est-à-dire de l’hémisphère nord) sont distinguées de celles du Sud. C’est dans ces francophonies du Nord qu’on retrouve un encart au sujet de la Belgique où il est autant question de la place de la langue française dans les politiques européennes que dans les politiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L’échelle nationale est décrite en une phrase : « L’engagement de l’État fédéral est une variable dépendante de l’état des relations internes entre les communautés linguistiques. »
Ces cartes sont intéressantes à consulter pour pouvoir situer la place du français dans les pays d’origine des participants aux formations et éventuellement mener un travail sur la place du français à différentes échelles.
¶
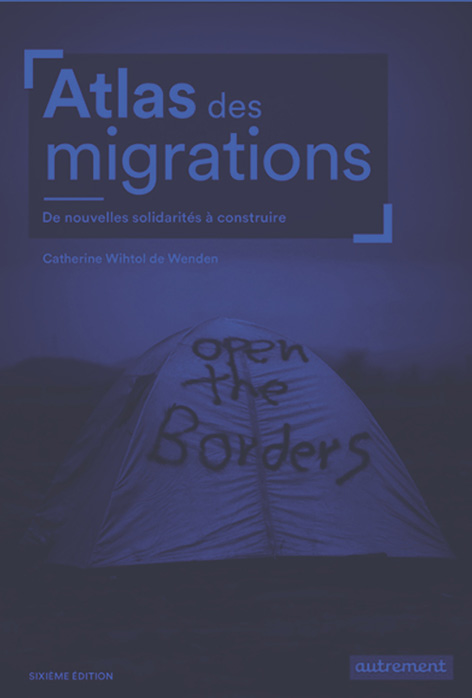
Catherine Withol de Wenden, Atlas des migrations, Collection Atlas/Monde, Editions Autrement, 2021
Le dernier atlas qui complète les deux autres est l’Atlas des migrations. Les apprenants qui voyagent à travers les cultures francophones, à travers la ou les formes de la langue française, qui sont-ils, d’où viennent-ils ? Quelles routes ont-ils empruntées ? Quelles frontières ont-ils traversées pour venir jusqu’ici ? Sont-ils des étrangers ? Des migrants ? Des réfugiés ? Des déplacés ? Des demandeurs d’asile ? Des apatrides ? Des naturalisés ? Des citoyens reconnus par l’administration ? Des sans-papiers ? Cet atlas traite donc des migrations, c’est-à-dire de déplacements de population et non de migrants. On fait souvent l’amalgame entre non-francophones et migrants. Le mot « migrant » est entré dans le langage courant pour désigner des personnes qui arrivent d’ailleurs et avec un implicite de vulnérabilité. Dans la partie introductive, on peut lire combien les mots sont définis différemment selon les critères utilisés qui eux aussi changent selon les politiques nationales, régionales, internationales. L’ONU, l’OCDE, l’Institut international des Migrations ont chacun leur vocabulaire et leur définition. De plus, même si on peut se référer aux définitions qui viennent de catégories juridiques, la réalité des migrations est bien plus complexe. Déterminé qui est légal et qui ne l’est pas, n’est pas suffisant. La définition de l’ONU dans sa simplicité parait la plus généraliste et pourtant ouverte à l’infini des possibilités : « Le migrant international est celui qui est né dans un pays et qui vit pour une durée généralement supérieure ou égale à un an dans un autre pays que le sien. (Au nombre de 272 millions selon les Nations unies en 2019). » (p. 7)
https://www.autrement.com/atlas-des-migrations/9782746760486
¶
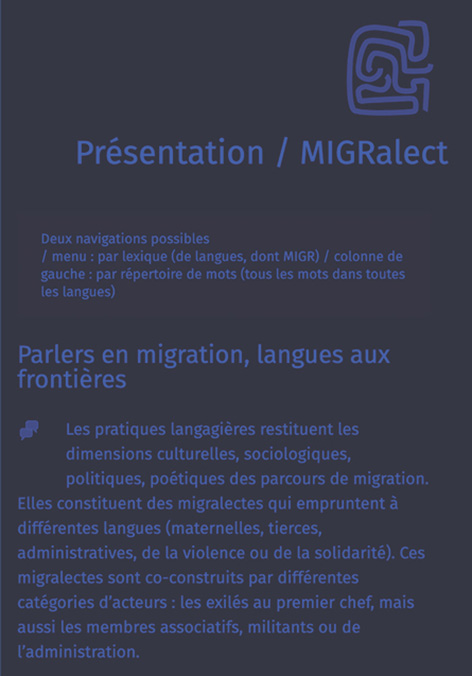
Parlers en migration, langues aux frontières, ANR LIMINAL (Linguistic and Intercultural Mediations in a Context of International Migrations)
Ce site inspirant et exemplatif montre comment une rencontre interculturelle dans des conditions extrêmes peut se traduire linguistiquement. Il a été réalisé dans le cadre de l’ANR LIMINAL (Linguistic and Intercultural Mediations in a Context of International Migrations). Ce programme traite des interactions et médiations langagières et culturelles entre acteurs en situation de crise migratoire (2017-2021).
Le vocabulaire, relevé au plus près des situations des exilés, dans la région parisienne, aux frontières entre l’Italie et la France ainsi qu’entre la France et l’Angleterre, a permis de constater l’existence d’une lingua franca partagée par les exilés, les solidaires, les travailleurs sociaux, les personnels de justice et administratifs, désignés ici sous le nom de migralecte. Le migralecte désigne ainsi les parlers des migrations contemporaines en France, étroitement liés aux politiques migratoires récentes, nationales et européennes, tout autant que les parlers en migration, transformés par l’expérience migratoire. En ce sens, il constitue un état des lieux des termes de la période 2016-2021.
D’emblée, on peut parler de migralectes au pluriel tant ces parlers sont tributaires d’une géographie et d’une démographie particulière. Par exemple, dans le Calaisis, prévaut un lexique du froid, des sous-bois (jungle) et du feu. Dans la vallée de la Roya ou à proximité du col de l’Échelle (Briançon) qui relie l’Italie à la France, le lexique y intègre un vocabulaire de montagne, avec des références topographiques et d’orientation, mais aussi d’un lexique du transit et des stratégies solidaires. Ces pratiques langagières restituent les dimensions culturelles, sociologiques, politiques, poétiques, des parcours de migration.
Article à lire en ligne sur MIGRalect.org
¶
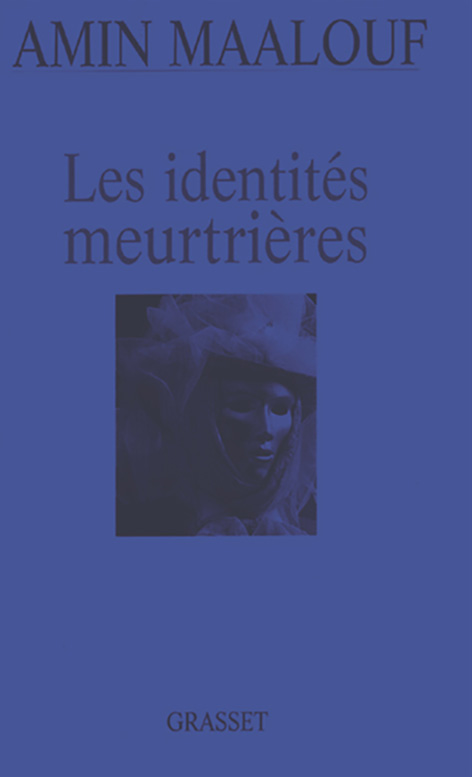
Maalouf Amin, Les identités meurtrières, Grasset, 1998, 212 pages
Les Identités meurtrières est un essai particulièrement abordable qui refuse la définition simpliste, dite « tribaliste », trop courante, de l’identité. Et c’est à partir de son expérience personnelle, de la diversité de ses appartenances qu’Amin Maalouf a souhaité entamer cette réflexion.
L’identité est forcément complexe ; elle ne se limite pas à une seule appartenance : elle est une somme d’appartenances plus ou moins importantes, mais toutes significatives, qui font la richesse et la valeur propre de chacun, rendant ainsi tout être humain irremplaçable, singulier. Elle n’est pas innée, ni immédiatement donnée ; elle s’acquiert via l’influence d’autrui. Aucun individu au monde ne partageant toutes ses appartenances (ni même avec son père ou son fils), il apparaît extrêmement dangereux et non pertinent d’englober des individus sous un même vocable, a fortiori de leur attribuer des actes, des opinions ou des crimes collectifs. L’identité reste incontestablement un tout : elle n’est ni un « patchwork » ni « une juxtaposition d’appartenances autonomes » ; quand une appartenance est attaquée, toute la personne est touchée.
Les identités peuvent devenir meurtrières, lorsqu’elles sont conçues de manière tribale : elles opposent « Nous » aux « Autres », favorisent une attitude partiale et intolérante, exclusive et excluante. Le choix proposé par cette conception est extrêmement dangereux, il implique soit la négation de l’autre, soit la négation de soi-même, soit l’intégrisme, soit la désintégration. En ce sens, les individus hybrides semblent devoir jouer un rôle clé : celui de traits d’union, de médiateurs. Mais ils sont généralement les premières victimes de cette conception tribale. Ils peuvent constituer alors des relais, ou au contraire les pires tueurs identitaires s’ils sont dans l’incapacité d’assumer cette diversité : à l’heure de la mondialisation, une nouvelle conception de l’identité s’impose à tous. « Pour aller résolument vers l’autre, il faut avoir les bras ouverts et la tête haute, et l’on ne peut avoir les bras ouverts que si l’on a la tête haute » (p. 53).
¶
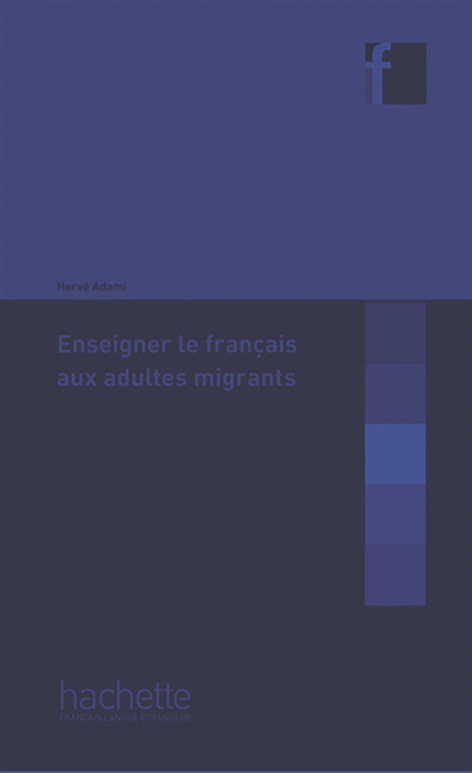
Hervé Adami, Enseigner le français aux adultes migrants, Hachette/Français Langue Etrangère, 2020, 174 pages
Il est quasiment impossible de parler de l’alphabétisation pour non-francophones sans faire référence à Hervé Adami, sociolinguiste et didacticien, professeur des universités à l’Université de Lorraine. Ses travaux de recherche portent sur l’intégration et la formation linguistiques des migrants, mais également sur les questions tournant autour de la problématique « langage, travail et formation » et plus généralement sur les formes d’insécurité langagière chez les adultes. Il publie depuis de nombreuses années des articles et ouvrages sur la question. Celui mentionné ici est la dernière acquisition de notre centre de documentation. Toutes ses publications, dans leurs dimensions sociolinguistiques, sont un apport précieux dans notre domaine de travail. Elles montrent l’importance de l’histoire et du contexte politique des pays accueillant des migrants pour comprendre les politiques linguistiques mises en place, politiques qui vont déterminer les logiques et cadres de subventions des associations. Il donne des balises pour situer les différents dispositifs d’accompagnement et de formation des migrants et fournit une analyse des types de documents utilisés en formation. Cependant, ses travaux étant davantage ancré dans un contexte français et spécialiste du Français Langue Etrangère, nous devrons nous tourner vers d’autres références pour ce qui de l’apprentissage de la lecture et de l’écriture.
¶
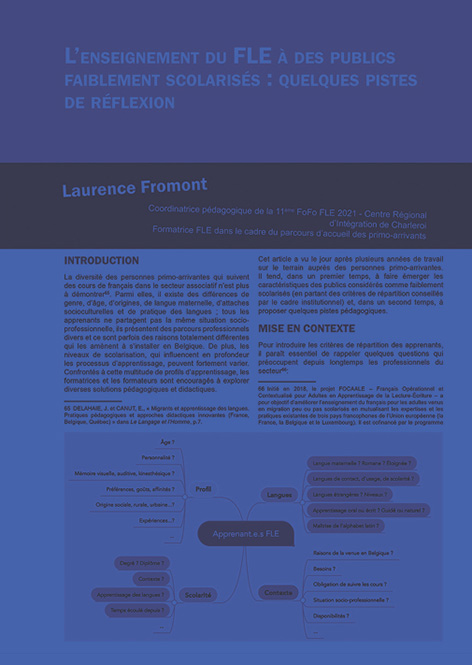
Laurence Fromont, L’enseignement du FLE à des publics faiblement scolarisés : quelques pistes de réflexion, 14 pages in L’apprentissage de la langue française en contexte migratoire des outils, des démarches et des activités par et pour les formateurs et formatrices FLE
En dehors du document de référence établi par le Conseil de l’Europe, le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL), le monde de l’édition met régulièrement sur le marché, pour le domaine du Français Langue Etrangère, de nombreux manuels en tous genres, livres de grammaire, de communication, de vocabulaire, etc. Parmi ces livres coûteux, peu sont réellement pertinents pour nous en alphabétisation. À l’inverse, les recherches en linguistique, sociolinguistique, en sciences de l’éducation et en didactique des langues apportent beaucoup à notre pratique professionnelle. Car contrairement au FLE, nous n’avons pas de « méthodes » toutes faites et ne pouvons travailler avec des feuilles d’exercices pensées en dehors des groupes. L’alpha est tout autant un voyage vers et dans la langue française, orale et écrite, qu’une exploration du monde de l’écrit en général, vers les savoirs des disciplines qui offrent des concepts pour penser. Surtout, l’alpha a comme point de départ les savoirs et réalités des apprenants. Ceci étant souligné, le texte de Laurence Fromont proposé ici offre des pistes de réflexion et une démarche pour les publics dits FLE faiblement scolarisés. Car qui a une pratique avec des groupes alpha et FLE sait combien la frontière est floue et en miroir des parcours de vie2. Il me semble ainsi important et pertinent de faire connaitre cette publication auprès des acteurs·rices de l’alpha. En effet, elle explicite en premier lieu les différents profils de personnes en contextes migratoires, rencontrés en formation et donne des critères pour les distinguer. Elle décrit également, avec précision, étape par étape, une séquence de formation, ce qui peut donner des clés à tous·tes formateurs·rices débutants·es ou en recherche d’exemples structurants pour construire leurs propres démarches en alpha.
https://objectif-fle.be/wp-content/uploads/2024/06/PUBLI-FONDEMENTS-METHODO-37-50.pdf
¶
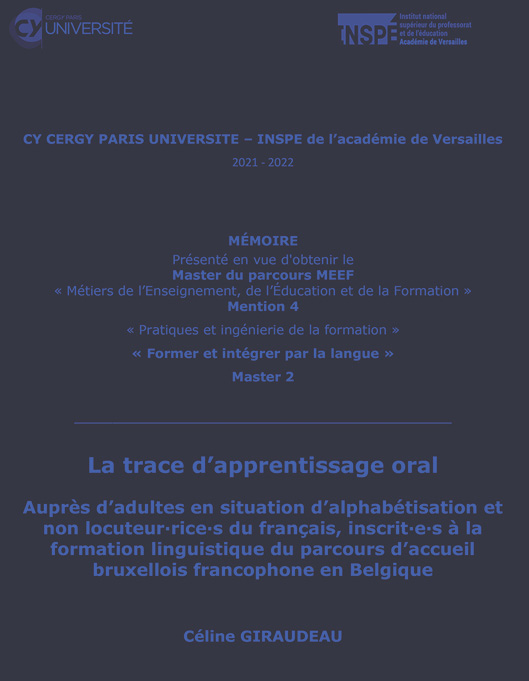
Céline Giraudeau ; Bénédicte Kachee (dir.), La trace d’apprentissage oral auprès d’adultes en situation d’alphabétisation et non locuteur·rice·s du français, inscrit·e·s à la formation linguistique du parcours d’accueil bruxellois francophone en Belgique, 2022, 122 pages
Ce mémoire est une source rare, car nous avons jusqu’ici peu d’ouvrages sur cette question en phase avec nos réalités. Il a pour objet de questionner les enjeux didactiques de l’apprentissage oral auprès de personnes en formation d’alphabétisation, non-locutrices du français et inscrites à la formation linguistique du parcours d’accueil bruxellois francophone en Belgique. Le cadre théorique définit le contexte, les didactiques de l’oral et les spécificités du public primo-arrivant en alphabétisation, puis s’intéresse à l’élaboration de situations d’apprentissage de l’oral riches et constructives. Le cadre pratique présente une expérimentation portant sur les traces d’apprentissage dans deux démarches pédagogiques auprès d’un groupe d’apprenants·es. Les étapes d’intervention et la symbolisation des traces dans les processus langagiers sont observées pour identifier les éléments favorisant l’alphabétisation dans son approche socialisante.
http://www.cdoc-alpha.be/GED_BIZ/19502579132
¶
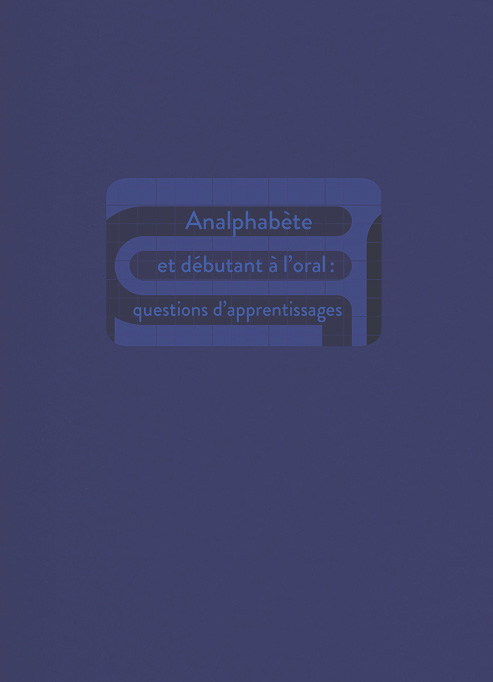
Jean Constant (coord.), Analphabète et débutant à l’oral : questions d’apprentissages. Abécédaire du formateur, Lire et Écrire, 2014, 103 p.
Constatant à quel point les formateurs·rices peuvent se sentir démunis·es face aux adultes débutants à l’oral et à l’écrit en l’absence de méthodes spécifiques vraiment satisfaisantes et manque d’ouvrages réflexifs, un groupe de travail, composé de formateurs et de conseillers pédagogiques de Lire et Écrire, a été chargé de réfléchir aux questions de l’apprentissage du français oral par des personnes analphabètes non francophones et de proposer des pistes d’action. Le résultat de leurs discussions a été formalisé sous forme d’abécédaire. Ce document, conçu comme un outil de partage, de questionnement et de débat, l’objectif de ce document est de mettre en évidence la multitude des réponses qu’il est possible d’apporter aux questions de l’apprentissage de la langue orale en raison des nombreux facteurs à prendre en considération : l’apprenant (son âge, son histoire, ses représentations de l’apprentissage, son insertion et ses interactions avec la langue…), le formateur (sa formation, ses représentations de l’apprentissage…), les conditions dans lesquelles a lieu la formation (horaire, local, matériel,…).
En ligne : https://lire-et-ecrire.be/IMG/pdf/abecedaire_du_formateur.pdf
¶
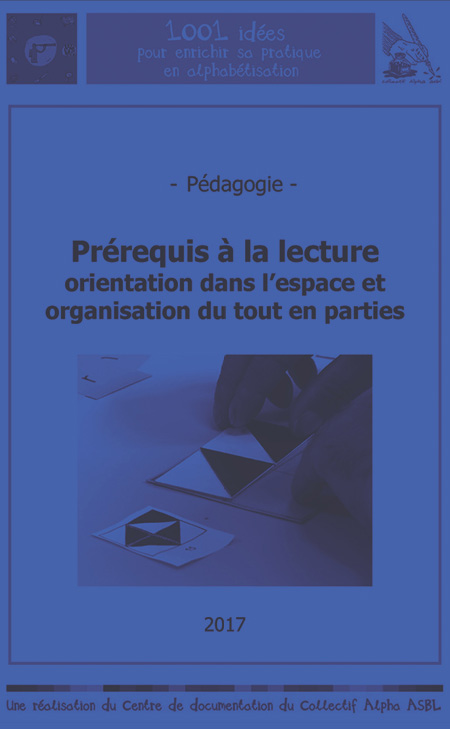
Patrick Michel et Marie Fontaine, Prérequis à la lecture orientation dans l’espace et organisation du tout en parties, Collectif Alpha, 2017
Patrick Michel, concepteur, avec Nathalie De Wolf et Jacques Borzykowski de Du Sens au Signe, une méthode intégrative pour apprendre à lire et devenir lecteur à l’âge adulte est spécialiste de l’apprentissage de la lecture, formateur avec une longue expérience en alphabétisation au Collectif Alpha. Parmi ses écrits et pour souligner la spécificité de l’entrée dans le monde de l’écrit à l’âge adulte, il propose ici de découvrir des aspects souvent oubliés de l’apprentissage, comme le souligne l’introduction de ce dossier pédagogique : « En alphabétisation, on n’a jamais établi un « programme » comme c’est le cas dans l’enseignement officiel. C’est une pratique « qui rassemble de fait de multiples pratiques différentes qui s’inventent, se créent et se recombinent […] cela peut ressembler à du “bricolage”, ou tout du moins à un objet complexe et mouvant ». Lorsqu’on se trouve confronté à des blocages chez les apprenants, il faut donc se mettre en recherche pour en identifier les causes et imaginer ou se réapproprier des pratiques pour y trouver des solutions. Ce dossier propose un exemple concret de cette dynamique, autour des prérequis à l’apprentissage de la lecture. Ces bases sont comme des fondations : invisibles (on n’y pense plus), mais indispensables (garantes de la solidité de l’édifice). Ces prérequis, nous les avons tellement intériorisés qu’ils nous semblent naturels, et non le résultat d’un apprentissage. Difficile dans ce cas de les identifier…
Téléchargeable sur : http://www.cdoc-alpha.be/GED_BIZ/192821391000/Prerequis_a_la_lecture.pdf
¶
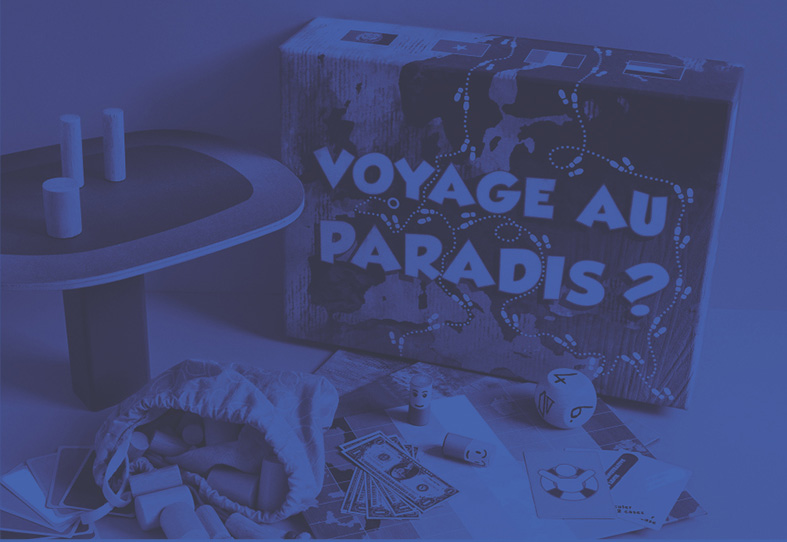
Voyage au paradis ?, Lire et Ecrire Luxembourg, CRILUX et Ludothèque de Bastogne, 2024
Comprendre, interroger, ouvrir le débat et enrichir sa vision du monde :tels ont été les maîtres-mots de la création de ce jeu qui allie plaisir de jouer et volonté pédagogique. Ce sont les témoignages des apprenants sur leur parcours migratoire qui en ont nourri la construction. Des hommes et des femmes, jeunes et moins jeunes, voyageurs solitaires ou non, aux raisons du départ aussi diverses que les profils se sont livrés sur les conditions de l’exil, les embûches, les craintes, les blessures. Pas question pour autant de raviver un passé douloureux, « Voyage au Paradis ? », dans sa philosophie, est une invitation à l’expression et au dialogue interculturel.
Voyage au Paradis ? comporte 3 parties. Chacune correspond à une étape du voyage des personnes migrantes. Au départ, chaque joueur endosse l’identité d’un migrant.
Le chemin, le passeur — étape 1
Cette première partie met en lumière les expériences vécues par les personnes à partir du moment où elles ont pris la décision de quitter leur pays : les filières de passeurs, l’engagement de leurs biens et de leurs économies, les arrestations ou les renvois vers le pays d’origine. La fin de cette partie marque le début de la traversée en mer vers une terre d’espérance.
Le bateau, la mer, passage d’un monde à l’autre — étape 2
Cette deuxième partie illustre, par un défi collectif, la périlleuse traversée en bateau jusqu’aux portes de l’Europe. Tous les joueurs sont dans le même bateau. Le sort de chacun est donc étroitement lié à celui des autres. Soit tout le monde tombe à l’eau, soit tout le monde parvient à destination.
La vie en Europe — étape 3
Cette troisième partie est consacrée à la vie dans le pays d’accueil. Quelles aides existantes sur lesquelles prendre appui pour démarrer une nouvelle vie ? Mais aussi : les nombreux obstacles auxquels il faut faire face.
Pour avoir des informations sur le jeu : https://lire-et-ecrire.be/Voyage-au-Paradis
¶

Aurélie Audemar, Cécile Bulens et Claire Kuypers, Toi, moi et tous les autres, tissons le vivre ensemble, 2016. 9ème mallette de la série « Bienvenue en Belgique », Lire et Ecrire Communauté française
Comment travailler les questions de citoyenneté dans une perspective à la fois d’émancipation et d’intégration de tous, par tous et pour tous ? Proposée par Lire et Écrire dans une réflexion sur le fonctionnement de notre société, cette mallette est destinée aux animateurs, formateurs, enseignants, etc., travaillant avec des groupes d’adultes ou d’élèves du secondaire. Alors que l’on appelle ici et là au « vivre ensemble », la société se fragmente, connait de profonds clivages identitaires, se replie sur elle-même. Qu’est-ce qui coince ? Par quoi les habitants de la Belgique sont-ils liés aujourd’hui ? Qu’est-ce qui les éloigne ? Comment construire du commun ? Et si l’on parlait de soi, des autres, que l’on remontait le cours de nos histoires, de l’Histoire pour interroger les pratiques culturelles, les normes et les valeurs ? Que dit le droit ? Qu’en est-il dans les faits ?
La mallette contient les outils suivants :
- Le livret de l’animateur. Il propose un descriptif détaillé des animations.
- Le livret annexe. Il vient compléter le livret de l’animateur. Il contient des documents à utiliser en animation ainsi que des éléments à destination des animateurs, des éléments de mise en contexte de l’aspect de la thématique abordée, des informations sur un point traité, des définitions possibles de concepts.
- Différents types de documents prêts à être utilisés : des photos, des dessins, des schémas, une grande carte du monde, un plateau de jeu et une clé USB compilant des documents vidéos et audios.
Téléchargeable sur : https://lire-et-ecrire.be/Toi-moi-et-tous-les-autres-Tissons-le-vivre-ensemble
Centre de documentation
148 rue d’Anderlecht 1000 Bruxelles
02 540 23 48 cdoc@collectif-alpha.be
- https://www.francophonie.org/
- Pour mieux cerner les différences entre l’alpha et le FLE tout en les envisageant avec nuances, un forum a été organisé par Lire et Ecrire et Proforal. Vous pouvez le retrouvez en suivant ce lien : https://lire-et-ecrire.be/Forum-Alpha-et-FLE-points-communs-et-divergences-14553