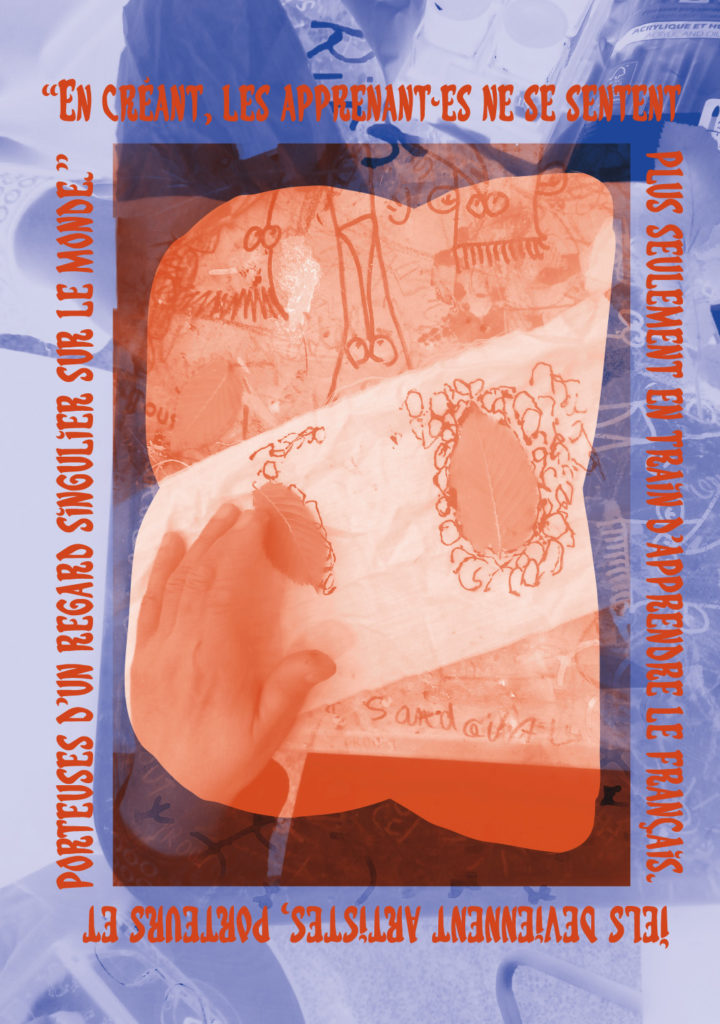Lorsque Axane (formatrice en alphabétisation à l’Entr’Aide des Marolles) et Alix (responsable des publics et de la pédagogie au Art et marges musée) font connaissance lors d’une première prise de contact entre voisines et décident de travailler ensemble, elles ne savent pas exactement comment faire mais bien ce qu’elles espèrent. Ce qui les motivent, toutes les deux, c’est la volonté solide de franchir des frontières, faire vaciller quelques cimaises et ouvrir les portes des classe d’apprentissage. C’est comme ça que d’octobre 2023 à juin 2024, une fois par mois, une dizaine d’adultes apprenant·es en alphabétisation pour non-francophones vont côtoyer l’Art brut au musée tout proche et s’investir dans des ateliers créatifs et artistiques au sein de leur centre de formation.
L’exposition en cours à ce moment-là, au Art et marges musée, « N’appelez pas ça Art brut », tombait à point nommé. En effet, elle remettait en question les frontières et la définition même de l’Art brut à partir d’une sélection renouvelée d’œuvres de la collection du musée.
Oui, le médium des arts plastiques et plus particulièrement l’Art brut a suscité un vrai intérêt de la part du groupe entier (apprenant·es et intervenant·es) en raison de son absence de filtre et de ses abords non discriminants. Il a aussi permis de détourner l’enjeu de l’apprentissage d’une langue — le français — et de ses codes. Le désir de confier la création d’un objet de préhension symboliquement fort — une création plastique improbable — entre les mains des apprenant·es a garanti l’usage de mots de langue française comme soutien à la création collective. L’engagement dans un projet commun a éveillé des perceptions, mobilisé des savoirs et provoqué des points de vue insoupçonnés ou en attente de manifestation.
Nous nous sommes réunis au total 11 fois, la moitié du temps au musée, l’autre moitié au centre de formation ou dans ses alentours. Des moments de monstration, par les apprenant·es, du travail en cours ont également eu lieu. Le projet a gagné petit à petit en consistance.
Chacun·e d’entre nous se sera autorisé·e, par le déroulement de ce projet, à sortir de son cadre de fonctionnement, à bouleverser ses habitudes, à provoquer un nouveau contexte, à sortir d’un rôle pour en assumer un autre, à se questionner autant que questionner, à apprendre de soi, des autres, entre pair·es. Des apprentissages-cibles en alphabétisation comme la prise de parole pour exprimer une émotion, un souvenir, une analogie dans la langue étrangère ou la présentation de son travail à un public seront aussi à retenir. Démultiplier les étapes et les traces du projet aura sans aucun doute enrichi notre pratique pédagogique toujours en construction.
L’expérience collective enfin ! Grisante, stimulante, pour se matérialiser modestement dans la sensation de plaisir et de bien-être en communauté !
Regards croisés entre les artistes bruts et les apprenant·es en alphabétisation
Au milieu des années 80, dans un contexte belge tout à fait particulier qui a vu émerger des ateliers artistiques dans le milieu de la santé mentale et dans le secteur du handicap mental aux quatre coins du pays, Françoise Henrion fondait l’asbl Art en marge. La structure avait alors pour objet de diffuser l’œuvre des personnes marginalisées créant dans ces ateliers mais également en autonomie. Le propos était de faire entrer dans les milieux culturels des œuvres issues des marges et qui n’y trouvaient alors pas encore leur place. Au début des années 2000, Carine Fol, qui a alors œuvré au sein des Musées royaux des Beaux-Arts et aux expositions du Botanique, reprend la direction du lieu.
C’est sous l’impulsion de cette directrice qu’Art en marge (jusqu’alors « lieu de recherche et de diffusion ») devient le Art et marges musée. Au-delà de la volonté d’institutionnalisation, elle perçoit dans cette opportunité une possibilité de rendre le projet encore plus dynamique et tourné vers l’extérieur. Comme elle l’exprimera à l’occasion de la publication des 10 ans du musée : « Pour moi la notion du musée est à l’opposé d’une institution statique, repliée sur elle-même. L’idée était d’en faire un outil pour défendre ces artistes et pour s’interroger sur les limites de l’art. »1
Des parallèles évidents apparaissent entre les apprenant·es en alphabétisation et les artistes bruts, tant iels sont, à l’origine, soit ignoré·es, absent·es de l’espace public et inconsidéré·es par les politiques, soit réduit·es à l’appartenance à des groupes dits fragilisés, définis par des caractéristiques spécifiques qui les cantonnent à s’exprimer sur des thèmes imposés ou, pire encore, à être perçu·es comme les versions non ou mal abouties de ce qu’un parcours de vie “naturel”, réalisé dans des conditions sociales optimales — de préférence occidentales — serait censé produire en tant qu’individus.
Pourtant, il existe aussi un point commun dans la volonté des personnes, quelles qu’elles soient, d’avoir une parole, d’avoir quelque chose à dire en utilisant d’autres codes ou outils que ceux traditionnellement valorisés.
Le musée fonctionne sur la base de cette double intention : donner à voir des créations, mais également œuvrer à la valorisation du public marginalisé à l’origine de ces œuvres.
Selon Céline Delavaux, qui a consacré sa thèse aux écrits de Jean Dubuffet, et au concept d’Art brut, l’Art brut, en tant que concept, permet de penser la marge, et depuis cette marge, de questionner le centre. Une démarche qui, poussée un peu plus loin, prend tout son sens lorsqu’on l’applique à la société dans son ensemble. Elle interroge la manière dont la différence vient questionner l’ordre établi, et tous les enseignements que l’on pourra tirer de cette confrontation pour une société plus équilibrée.
En alphabétisation, accorder du temps à l’apprentissage par l’auto-socio-construction, orientée par les apprenant·es, implique un temps long dans lequel il ne faut pas perdre de vue que, parallèlement à ce temps nécessaire aux individus, des pans entiers de la société restent à modeler et remodeler chaque jour pour plus de diversité, d’acceptation et de coexistence.
Pour Dubuffet (artiste et collectionneur, inventeur de l’appellation « Art brut » au milieu du XXe siècle), il fallait souffler un vent nouveau sur l’« asphyxiante culture ». Selon lui, l’art qu’il nomme « culturel » est sclérosé par l’entre-soi.
C’est donc ainsi que s’est articulé le travail de médiation : proposer un lien entre la sensibilité des apprenant·es et celle de l’artiste. L’Art brut est un outil merveilleux pour cela puisqu’il s’agit souvent d’un art non intellectualisé par son auteur·ice. Le spectateur ou la spectatrice est invité·e à faire confiance à son propre ressenti face à l’œuvre. Il n’y a rien à comprendre. Le rôle du médiateur ou de la médiatrice sera donc d’inviter le public à une forme de disponibilité qui permette la rencontre avec l’œuvre. Cette démarche est particulièrement précieuse, quand auprès de publics, nous parvenons à faire comprendre qu’iels détiennent eux-mêmes les clés pour appréhender l’œuvre qu’ils ou elles ont devant les yeux. On peut noter aussi qu’à l’absence de discours s’ajoute souvent une proximité entre ces œuvres et le monde dans lequel nous vivons avec des références à la culture populaire comme la bande dessinée, le fan art, la science-fiction, les actualités, la radio et l’appropriation d’images produites par la société de consommation.
Voici ce que dit Gérard Preszow de la spécificité des œuvres d’Art brut dans le premier numéro du Bulletin Art en marge publié en 1984 : « Chaque œuvre commande une disposition distincte du regard et de la pensée. Elles présentent une vitalité sauvage qui ruine toute antécédence discursive et ouvrent à d’autres possibles de l’imaginaire. […] Elles sont d’une esthétique surprenante. Nées hors des circuits de transmission formelles et des soucis référentiels, elles interrogent les modèles de culture et de mode. »2
Peut-on dès lors envisager des actions d’alphabétisation innovantes, dans lesquelles on expérimenterait, ou à tout le moins tiendrait compte, des différents cheminements humains, en ce compris ceux qui se réalisent « par manque de » ?
Pour des adultes en alphabétisation qui ne disposent que de peu de mots en français, Isadora Minicucci, coordinatrice de la maison de quartier le CARIA ASBL, voisine du musée, soulignait que « Les œuvres [exposées] prêtent à la discussion, même avec un champ lexical réduit les personnes osent et peuvent s’exprimer, dire ce qu’il et elle pense, ressente. Il s’agit là clairement de s’exprimer oralement, de donner un avis, de s’ouvrir à l’autre et à soi. Mais aussi de tenir un pinceau, un crayon (pour la première fois) et exprimer son point de vue autrement qu’à l’oral ou à l’écrit ».
Principe de co-construction et partage de compétences
Chaque atelier était conçu l’un après l’autre, afin de poursuivre et consolider ce qui avait été entamé et semblait avoir suscité de l’enthousiasme et de l’intérêt. Le contenu des ateliers était alimenté par les œuvres exposées au musée, dont l’accrochage a été renouvelé à quatre reprises au cours du projet. Nous avions pour ambition de constituer un répertoire de formes, de couleurs et de matières, un nouvel alphabet pour élaborer un langage collectif expérimental.
Idéalement, nous aurions souhaité que le projet soit façonné à tout moment par chacun·e d’entre nous, que les intervenantes, autant que les apprenant·es, co-construisent chaque étape de nos rencontres. Cependant, bien que nous ayons tenté de réfléchir et d’agir sensiblement pour être au plus près des compétences et des ambitions des apprenant·es, ce sont les intervenantes qui ont orienté la direction finale du projet.
La co-animation des ateliers voulue par les intervenantes a apporté plusieurs bienfaits. L’absence de finalité ou de résultat défini préalablement nous garantissait une plus grande agilité mentale. En effet, le seul temps qui comptait était le présent, débarrassées de l’inquiétude d’un échec éventuel, nous étions entièrement tournées vers l’expérimentation et le jeu. Cela favorisait une ouverture aux propositions et aux sensibilités de l’autre dans son rapport au groupe, une prise de conscience de sa complémentarité, une disposition particulière à un temps riche en respiration. Une attitude bénéfique, tant pour les intervenantes que pour les apprenant·es, qui découvraient librement et sans contraintes la création d’un artiste et l’apprentissage d’une technique inconnue.
Dès le départ, il y eut la volonté de mobiliser les savoir-faire dans le groupe hétérogène. Le fait de sortir du cadre routinier d’apprentissage rendait visibles des aptitudes nouvelles ou des acquis cachés. Ce changement offrait l’opportunité de voir les apprenant·es sous un autre jour et tout simplement mieux les connaître. Puis, l’engagement des apprenant·es dans la création plastique mettait en relief, comme en filigrane, la singularité de la personnalité de chacun·e. Nos éventuels a priori sur les un·es et les autres pouvaient s’effacer.
L’amorce des expérimentations plastiques passait par la découverte d’une œuvre au musée. Citons comme exemple le lien qui a été établi entre le graphisme des dessins de l’artiste exposée, Margot, et celui des motifs de dessins au henné. Très vite, il est apparu que tous·tes partageaient cette pratique, présente dans différentes parties du monde, ce point de départ commun a ouvert le chemin vers l’exercice du trait dont nous parlerons plus bas. Parlons ensuite de la découverte du syncrétisme singulier de l’artiste Marion Oster qui nous a peut-être amené·es à retracer les contours d’une croyance intime. Pour finir avec l’étoffe magique, la force des vœux brodés en lettres de Caroline Dahyot qui nous a exhorté·es à vouloir — nous aussi, et collectivement — tracer des signifiés-signifiants brodés ou dessinés.
Évoquons enfin, pour clôturer ce point, les propos de Myriam Lemonchois, professeure de didactique des arts à l’université de Montréal et chercheuse en sciences de l’éducation : « La participation à la culture dans un projet d’émancipation implique de partir de l’égalité et non de chercher à y arriver : elle repose sur la reconnaissance du pouvoir qu’a chacun de traduire à sa manière son rapport à lui-même, aux autres et au monde (sa culture), en l’invitant à faire appel à sa nécessité intérieure pour le partager. Prendre pour point de départ l’égalité, c’est donc partir non pas de ce que la personne ignore, mais de ce qu’elle sait et de vérifier si elle a usé de son intelligence. »3. Ce principe des égalités des intelligences était au cœur de notre projet.
La création et l’expression artistique, son rôle dans l’alphabétisation
L’expression artistique a certainement permis de partir à la recherche d’un meilleur équilibre dans le rapport des apprenant·es à leur parcours d’apprentissage en alphabétisation. En s’éloignant des méthodologies habituelles destinées à un groupe débutant non-francophone — troquant tour à tour l’écoute et l’expression orale contre la vision accrue et le geste manuel — et en s’approchant d’univers narratifs issus du quotidien, de la routine, du familier mais aussi d’univers plus composites.
En improvisant des traits d’encre colorée sur de la musique se dessinait en amont un collier, qui se défaisait ensuite en lacets de lignes, pour s’achever en pointillés, comme du sens au signe, avançant pour et vers l’abstraction. Et lorsque, à partir d’une tâche symétrique abstraite obtenue en pliant le papier (comme celle du test de Rorschach) les apprenant·es traçaient des prolongements végétaux symétriques ou résolument asymétriques, apparaissait subitement un être, peut-être proche ou effrayant, comme du signe au sens, de l’abstraction naissait la figuration et éventuellement les mots pour la dire.
De fait, créer consiste moins à s’exprimer soi qu’à exprimer quelque chose au travers de soi, la mise en participation se retrouvant quelque peu en décalage avec un dit attendu, la possibilité d’interprétation s’en trouve élargie, plus accessible, plus ouverte.
À l’entame d’un processus de création, tout·e auteur·rice se rend disponible à ce qui la/le traverse, l’œuvre d’art se place toujours dans une situation complexe où les solutions individuelles doivent être partageables et reconnues par d’autres dans un état de lâcher-prise généralisé. L’expression artistique ne représente plus alors un pont entre les cultures, mais bien un mélange de différents rapports culturels. La créativité peut donc se vivre comme une force sociale essentielle.
L’expérimentation était au cœur des ateliers. Manipuler des matériaux inhabituels ou se saisir de techniques pour faire quelque chose d’inédit : les apprenant·es s’engageaient dans une exploration de leurs potentiels, sans se brider, invité·es à se servir de leurs « erreurs » comme de trouvailles ou comme une invitation à emprunter un chemin inattendu.
Chaque expérimentation accompagnait l’apprenant·e dans un chemin de création inédit qui contribuait à l’émergence ou au développement d’une série de compétences.
Citons, par exemple, l’exercice de reproduire, in situ, avec un stylo-bille sur un petit carnet, un détail d’une fresque murale qui mêle le figuratif et l’abstraction, ici celle de la station de pré-métro Lemmonier, puis de reproduire librement ces motifs prélevés à une autre échelle avec un pinceau et de l’encre sur un papier japonais. Motifs qui évoquent à la fois ceux du henné et ceux de l’artiste exposée Margot. Un exercice qui aborde à la fois l’écriture, la figuration, l’abstraction, la copie, l’interprétation, l’utilisation de médiums différent et la création libre et singulière.
Il y aussi eu encore la fabrication de tampons sur gomme en gravant un motif avec une gouge pour ensuite exécuter des compositions constituées d’une multitude d’empreintes, d’abord seul·e, puis collectivement, sur des papiers de formats différents.
Une expérimentation qui a contribué, d’une part, à l’apprentissage d’une technique particulière : la gravure en relief et de l’usage, parfois complexe, d’une gouge. Et, d’autre part, à la notion de composition ou comment occuper la surface d’une feuille, sur laquelle il s’agit de composer avec d’autres créativités un ensemble.
Ajoutons l’avant-dernière étape de synthèse, où chaque apprenant·e devait se saisir d’un morceau de tissu pour y inscrire, dessiner, broder, coller les motifs accumulés au fil des ateliers. Les apprenant·es devaient réactiver l’ensemble des apprentissages pour emprunter une direction personnelle. Ces morceaux ont ensuite été assemblés collectivement, comme un grand puzzle abstrait, une mise en commun où chacun·e a pu prendre sa place.
Ce projet a été une porte ouverte sur un des mondes de l’écrit. Un monde différent de celui de la langue, de l’alphabet ou de la syntaxe dans lequel chacun·e a trouvé une liberté. Celle de traduire une impression, floue ou nette, mais toujours soignée. En calligraphie, on dit que l’importance du dessin de la lettre peut l’emporter sur le sens du graphème… Et si c’était cette idée de pouvoir écrire sans écrire, écrire sans impérieuse exactitude, écrire minutieusement ce qui tend à l’incompréhensible, écrire ce que l’on sait d’emblée, qui avait fédéré le groupe autour de cette création collective ?
Pour conclure notre propos, nous pouvons reprendre les mots de l’article de François Emmanuel Tirtiaux. Écrivain et psychiatre, il a exercé comme psychothérapeute au sein du club Antonin Artaud qui s’adresse à des adultes souffrant de difficultés psychologiques et tentant de retrouver un rythme de vie, des liens, une place active et plus autonome au sein de la société, notamment par le biais d’ateliers artistiques.
« L’œuvre comme une «parole d’humain à humain» qui invite au respect, à la suspension de tout jugement, et donc à une forme d’accueil «silencieux», tandis que le processus se doit d’être appréhendé avec tact, délicatesse, comme un mouvement que l’on peut induire sans orienter, stimuler sans forcer, susciter sans prescrire. Lorsque le processus a été mené à son terme et que l’objet est là dans une forme qui semble achevée, il donne au créateur l’impression d’être à soi et à soi irréductiblement étrange. À la fois fruit d’un travail personnel et portant sa marque intime, il se donne au regard de l’autre et s’autorise à «parler» à l’humanité de cet autre à ce niveau d’humain et d’universel qui est celui de toute forme d’art.
On pourra dire : Quelque chose est détaché, quelque chose est donné. Le surcroît alors évoqué devient un surcroît de sens, soit quelque chose qui donne sens à notre présence en ce monde et suscite l’envie de renouveler l’expérience, relancer le processus et tenter avec lui de se porter peut-être plus loin4 ».
Un projet qui a occupé différents lieux : un musée, une salle de classe et une station de métro.
Enfin, dans cette dernière partie, nous souhaitions souligner le côté itinérant du projet, pour montrer combien l’alternance des lieux de rencontre et de création a contribué à de nouveaux apprentissages.
Au musée, on se regroupait autour des œuvres d’un·e ou deux artistes en particulier, on sondait leur genèse, commentait les possibles sources d’inspirations de l’artiste, scrutait, notait des détails et l’on pouvait se prendre à rêver. Chaque visite nous promettait de voir de nouvelles créations, parfois nous retournions devant des œuvres précédemment vues, comme devant de vieilles connaissances, dont quelques détails nous avaient échappé ou que nous souhaitions revoir.
À l’occasion, le musée devenait un lieu d’atelier. Des tables étaient dressées dans les salles d’exposition, et la création avait lieu là, sous l’œil bienveillant des œuvres exposées.
La clôture de nos rencontres s’est également déroulée au musée. L’œuvre finale, le patchwork constitué de nos morceaux de tissus, a été suspendu dans une des salles du musée. C’est à cet endroit que nous avons tenté de rendre compte collectivement de ce que nous avions vécu ensemble.
Progressivement, le musée devenait un lieu familier d’apprentissage et de découverte.
En début de parcours, l’idée de s’aventurer au-delà des frontières du quartier et de laisser les apprenant·es guider le groupe nous est venue. Iels se sont montré·es aux usager·ères de la station de pré-métro Lemonnier comme des étudiant·es aux beaux-arts qui observent et croquent sur le vif les détails d’une fresque murale sur les quais du tram. Cet atelier était inattendu, proposé sans annonce préalable mais iels se sont emparé·es de la consigne avec une grande facilité et tranquillité et cela nous a confortées dans le sentiment qu’iels étaient curieux·ses d’explorer des territoires inhabituels.
Au centre de formation, c’était « après-midi atelier », on y manipulait crayon, pinceau, gouge, aiguille, pistolet ou encore marteau, cela laissait des traces qui, mises bout à bout, rappelaient les étapes de leur engagement et de leur présence au monde.
La temporalité offerte au projet a également permis d’en approfondir le sens : inscrire le travail d’expression orale à partir de supports visuels comme des œuvres brutes, mener une analyse réflexive sur ce que l’on est en train de faire, ce que l’on obtient, ce que ça représente pour nous, saisir la sensibilité d’un·e artiste en la liant à sa vie personnelle ou à l’histoire du quartier, prendre la parole, avec pour soutien une collection d’images insolites créées, gages de respect et d’authenticité quant aux paroles qui étaient formulées.
Entre chaque rencontre mensuelle, visite ou atelier, la formatrice utilisait dans le cadre de ses cours, des créations d’Art brut comme support visuel à des descriptions d’impressions ou à des ouvertures d’échanges d’idées. Elle revenait régulièrement sur la conception de ce qui fait art et sur les parcours de vie des artistes, créant un fil conducteur pour se remémorer, commenter et évaluer le projet en cours. Parce que la création d’Art brut, comme nous l’avons évoqué au premier point, permet la confrontation avec des images directes et franches facilitant l’expression des apprenant·es, il fallait y avoir recours le plus souvent possible.
Progressivement, au centre de formation, on s’ouvrait au monde.
Le musée et le centre de formation ont accueilli, à différentes étapes du projet, les créations réalisées — qu’elles soient en cours d’élaboration ou abouties. Ces moments de présentation publique n’étaient pas anodins : ils ont offert à chacun·e l’occasion de se rendre disponible, de valoriser son travail, de le partager avec d’autres.
Les allers-retours féconds entre les deux lieux ont modifié nos postures, nos regards, nos rôles — aussi bien du côté des intervenantes que des apprenant·es.
Ce va-et-vient a aussi déplacé les fonctions symboliques des espaces : le centre de formation s’est transformé en atelier vivant ; le musée, en lieu d’accueil, de création et de rencontre. Et pour les apprenant·es, ce lieu — au départ perçu comme extérieur, institutionnel, intimidant peut-être — est devenu peu à peu un espace du quartier, familier, investi, habité.
Conclusion
L’alphabétisation, c’est apprendre à lire, écrire et calculer. Mais c’est aussi, pour Lire et Écrire, acquérir des outils pour comprendre le monde et y agir socialement, culturellement, politiquement. À ce titre, nous pouvons considérer que cette initiative a été une réussite. La confrontation avec les créations brutes du Art et marges musée ont surpassé ou déjoué le référent culturel, l’aspect expérimental a rendu visible l’importance d’un processus, le geste artistique a témoigné d’un monde autre, plus vaste, que celui des mots usuels, les allers-retours au-dehors et au-dedans ont amené à considérer les espaces sous un angle neuf où les rôles de chacun·e ne sont pas préétablis ou déterminés mais en construction. Et de cette manière, nous, intervenantes, étions tout autant apprenantes que les apprenant·es du groupe.
Pour la suite, on pourra tenir en mémoire ce qui aura été favorable au projet : l’absence d’attentes et de moyens financiers, la mise en sourdine de l’exigence de résultats et d’objectifs précis et surtout la possibilité d’échouer !
En bref, ce que le projet a été :
- Un incubateur de rencontres (avec un musée, des œuvres, un itinéraire, une fin, avec soi et d’autres) ;
- Un instant de grande simplicité, un vivre ensemble sincère ;
- Trois bouts de ficelle, un pistolet à colle, beaucoup d’enthousiasme ;
- Un sac fourre-tout, un montage vidéo dans lequel les apprenant·es nous interpellent avec quelques phrases énigmatiques, de brefs échanges plaisants avec des passant·es à la station Lemonnier, des rires et des pleurs, des coups d’œil amusés chez les autres, de la concentration en boîte, des visiteur·euses intrigué·es, un résultat tangible, une joyeuse clôture !
- Sarah Kokot et Coline de Reymaeker Le « ET » de Art et marges », entretien avec
Carine Fol, dans Art et marges musée, Bruxelles, 2020. p.70 - Gérard Preszow dans Bulletin Art en marge n°1, 1985, p.3.
- Myriam Lemonchois. Projets artistiques et culturels en milieu scolaire : quelle participation pour quelle émancipation ? dans Journal 32, Périodique de l’asbl Culture & Démocratie. Décembre 2013. p.8-9.
- François Emmanuel Tirtiaux dans Philosophie des ateliers créatifs. 2008, https://www.clubantoninartaud.be/wa_files/Philosophie_20des_20ateliers_20cre_CC_81atifs.pdf