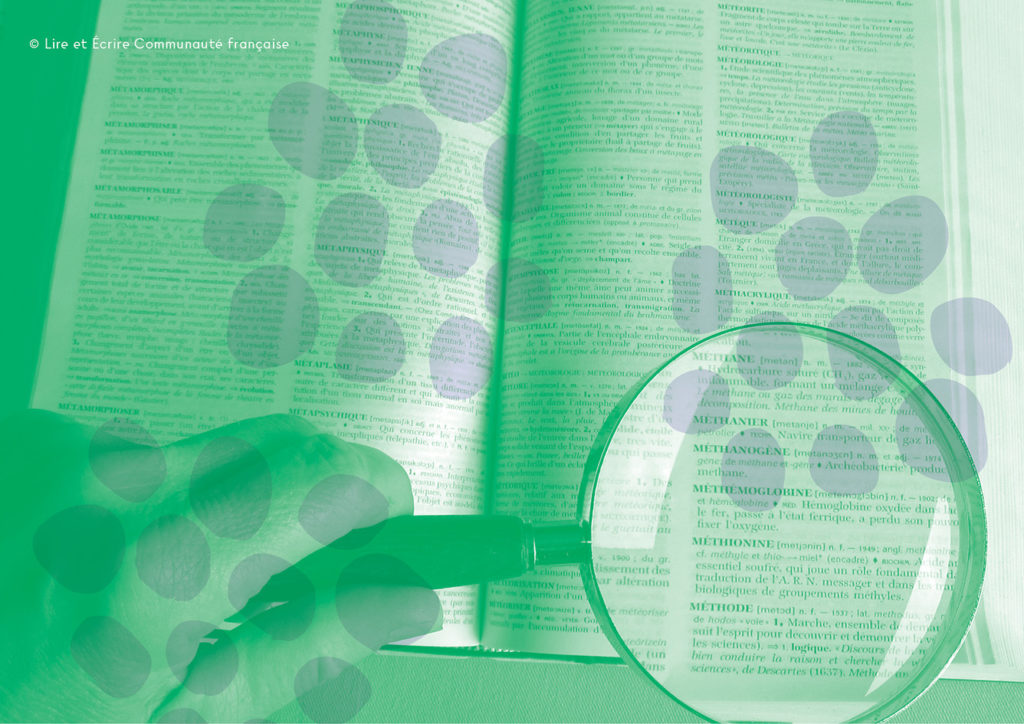Pédagogie
Selon le cadre de référence pédagogique de Lire et Écrire, « la pédagogie est une ‘théorie-pratique’ qui articule, en tentant de les relier avec cohérence :
- des intentions politiques reposant sur des convictions, des finalités, des valeurs, une philosophie et une éthique sociale ;
- des conceptions sur l’apprentissage ;
- des pratiques basées sur un choix de méthodes, d’outils et de techniques et sur un dispositif organisant leur mise en œuvre. »2
En d’autres termes, la pédagogie comprend la définition des buts éducatifs, en lien avec des finalités sociales, et leur articulation avec l’ensemble des moyens et des stratégies pour atteindre ces buts.
Ou encore, selon Philippe Meirieu, « la pédagogie permet de penser la question du ‘passage à l’acte’ en éducation, dans un aller-retour interrogatif entre les fins et les moyens. Elle s’efforce de parcourir la chaine des finalités aux pratiques, obstinément et dans les deux sens. »3
Pédagogie émancipatrice
Une pédagogie est émancipatrice si4 :
- Elle modifie les représentations du public quant à son avenir, en lui permettant de se donner un futur.
- Elle lui donne les moyens de décoder la réalité et les mécanismes qui y opèrent, ainsi que d’analyser sa condition, sa position sociale et ses représentations.
- Elle modifie les images que l’apprenant a de lui-même et lui permet d’augmenter sa confiance en soi, de réhabiliter une image de soi positive, de découvrir ses ressources propres, etc.
- Elle lui permet de prendre conscience qu’il peut être un acteur social, individuel et collectif, qu’il peut avoir prise sur lui-même et sur la réalité.
- Elle l’outille pour mener une action : définition d’un but à atteindre, planification d’une activité, mobilisation de ressources, réalisation.
- Elle lui permet d’acquérir des connaissances, des capacités cognitives, des habiletés manuelles et des attitudes qui lui permettront d’évoluer dans l’environnement (environnement proche et sociétal), d’user de multiples ressources : lire, écrire, calculer mais aussi induire, déduire, comparer, synthétiser, analyser, formaliser, vérifier…
- Elle lui permet de développer des capacités de communication et d’expression, de s’entrainer à la prise de parole et à l’écoute sous toutes leurs formes, de développer une certaine maitrise affective et émotionnelle.
- Elle lui permet de se construire une nouvelle identité, en relation avec d’autres dans le cadre des groupes où il est impliqué, tout à la fois en continuité et en rupture avec l’ancienne, et en articulation avec l’environnement.
- Elle lui permet de voir la réussite comme une construction tâtonnante dans laquelle il est permis de connaitre des échecs, qu’il pourra utiliser comme des points d’appui pour rebondir.
Méthode pédagogique
Avec Philippe Meirieu, on peut considérer qu’il existe trois définitions du concept de méthode pédagogique qui vont du plus général au plus précis5 :
- un courant pédagogique servant à promouvoir certaines finalités éducatives et suggérant pour ce faire un ensemble cohérent de pratiques (le socioconstructivisme par exemple) ;
- un certain type d’« activité » visant à permettre certains apprentissages ou à développer certaines capacités et mettant en œuvre des situations et des outils identifiés (la méthode naturelle de lecture-écriture par exemple) ;
- une technique dont l’usage est codifié et qui est liée à des objectifs déterminés (une situation-problème par exemple).
- Constats qui en découlent :
- On peut situer sur cet axe à peu près toutes les propositions pédagogiques.
- Chaque définition est inclusive par rapport aux autres : la première contient la seconde et la troisième, et ces dernières, même si elles ne le précisent pas explicitement, renvoient toujours à des finalités et statuent, d’une manière ou d’une autre, sur ce qu’il convient de mettre en place comme rapport aux savoirs, rapport au formateur et rapport des apprenants entre eux.
Francis Tilman et Dominique Grootaers6 situent quant à eux les méthodes pédagogiques entre les pédagogies et les techniques didactiques (voir ci-après). Plus globalisantes que ces dernières, « les méthodes pédagogiques regroupent des pratiques qui supposent des choix d’objectifs clairs, sous-tendus par une philosophie de l’éducation ; elles reposent également sur une conception de l’apprenant et du formateur et en déduisent pour eux des rôles spécifiques ; elles utilisent plusieurs techniques pédagogiques, rarement une seule, et les intègrent dans un dispositif (organisation de l’espace et du temps) nettement caractérisé ». Ils ajoutent néanmoins que la limite entre pédagogie et méthode pédagogique est difficile à définir et proposent de situer le passage des méthodes aux pédagogies à partir du moment où les premières sont dotées de manière explicite de leurs finalités sociales. Un bon exemple est la pédagogie du projet qui est à la fois une pédagogie dans sa dimension « finalités » et une méthode dans sa dimension « dispositif pédagogique ».
Pour compléter ces définitions, voici un relevé non exhaustif des méthodes pédagogiques émancipatrices : les méthodes naturelles de lecture-écriture et de calcul (pédagogie Freinet), le chef-d’œuvre, le texte libre et les ateliers ECLER, le langage intégré, les intelligences citoyennes (dire le Juste et l’Injuste), le projet (tel que conçu par la pédagogie du projet), Reflect-Action, les pédagogies interculturelles, les ateliers d’écriture et d’arts plastiques, les ateliers ou cafés philo, l’entrainement mental, la pédagogie institutionnelle, le croisement des savoirs et des pouvoirs, la formation-action-recherche, l’éducation nouvelle et le socioconstructivisme, l’approche autobiographique7.
Techniques didactiques et outils
Plus concrètes que les méthodes, les techniques didactiques sont des façons de faire, des activités « dont le but est l’apprentissage et qui reposent sur certaines procédures clairement définies. Les techniques didactiques utilisent parfois des outils mais ne se réduisent pas à ceux-ci puisqu’elles prévoient la manière d’en faire usage. »8 Comme exemples, on peut citer les exercices d’entrainement systématique, les mises en situation, les jeux de rôle, les schématisations, les recherches documentaires, les situations-problèmes, les techniques d’animation de débats, les techniques de créativité utilisées notamment en atelier d’écriture, etc.9
Isolé, l’outil n’a quant à lui aucun sens pédagogique, il peut accompagner de nombreuses techniques, elles-mêmes mises au service de différentes méthodes, articulées chacune à une ou plusieurs pédagogies, émancipatrices ou non.
Avec les outils, nous sommes ainsi arrivés à l’élément le plus praticopratique des notions liées à la conception et à la mise en œuvre d’un dispositif pédagogique.
Action pédagogique
En alphabétisation populaire, le formateur, la formatrice construit son action pédagogique en mobilisant/articulant à sa manière des théories-pratiques, des pédagogies, des méthodes et en utilisant de nombreux outils et techniques10.
Autrement dit :
- Il, elle mobilise pédagogies, méthodes, techniques et outils à partir de ses connaissances théoriques et savoirs d’expérience.
- Il, elle mobilise des ressources humaines (les siennes, celles des apprenants, celles d’autres personnes).
- Il, elle mobilise des situations (le contexte proche ou lointain, des évènements, des situations vécues…).
- Il, elle mobilise des ressources matérielles et les organise.
L’action pédagogique est aussi faite de mille « petits riens »11 : des êtres particuliers, un contexte à nul autre pareil, une rencontre singulière, un courage, une envie, des chemins buissonniers, une posture, des paroles, une manière d’être… qui font qu’un dispositif est habité et peut aboutir à une création, à la réussite d’un projet. Une action pédagogique se réalise dans une temporalité et un espace où se structurent un possible, des échecs, des réussites, des décisions, des reprises, des interrogations, des angoisses, des doutes, du risque, de l’intelligence… Elle ne correspond donc pas à un travail de reproduction d’un dispositif ou à l’application d’une méthode mais est en construction perpétuelle.
La diversité des pédagogies, des méthodes et des outils ne signifie pas le relativisme pédagogique. Toutes les méthodes, outils et techniques ne sont pas équivalents dans la poursuite d’un objectif. Construire un mode d’action implique d’être au clair avec la nature de la relation pédagogique proposée, les modalités d’évaluation envisagées, les situations utilisées, les techniques et outils mobilisés. Cela implique aussi d’en analyser la cohérence
avec les finalités et les buts poursuivis.
Lien entre méthode, mode d’action et pédagogie émancipatrice
Pour évaluer si une méthode ou un mode d’action est en cohérence avec des enjeux d’émancipation, on peut se référer aux différents points caractérisant une pédagogie émancipatrice, en se posant notamment les questions suivantes :
- La méthode, le mode d’action est-elle, est-il fondé sur une approche collective ?
- Part-elle, part-il d’une ou de situations concrètes à transformer, de questions de recherche à traiter, de projets à mener… dont les enjeux sont réels ?
- Met-elle, met-il les apprenants et le formateur en situation de prise de parole, de mise en problème, en recherche, en action ?
- Permet-elle, permet-il aux apprenants de passer d’un rôle de dominé à celui de sujet-acteur/auteur de sa vie, du silence à la prise de parole, de la négation de soi à l’acceptation et à l’affirmation de soi, d’un sentiment d’incapacité à un sentiment de capacité, de l’acceptation de la fatalité au désir de construire son avenir ?
- Participe-t-elle, participe-t-il aux visées de l’alphabétisation populaire (égalité, participation, émancipation, accès aux droits, changement social) ?
- Pose-t-elle, pose-t-il le pari de l’égalité et du « tous capables ! » ?
- Développe-t-elle, développe-t-il le pouvoir d’agir des apprenants et du formateur ?
- Permet-elle, permet-il l’acquisition de savoirs libérateurs comme ceux issus du croisement des savoirs d’expérience (de vie et d’action) et des savoirs théoriques qui permettent de passer de l’individuel au collectif, du particulier au général ?
- Leur permet-elle, leur permet-il de développer leur réflexivité12 et leur créativité ?
- Contribue-t-elle, contribue-t-il à leur développement cognitif et favorise-t-elle, favorise-t-il la métacognition grâce à laquelle on prend conscience des opérations mentales qu’on mobilise ?
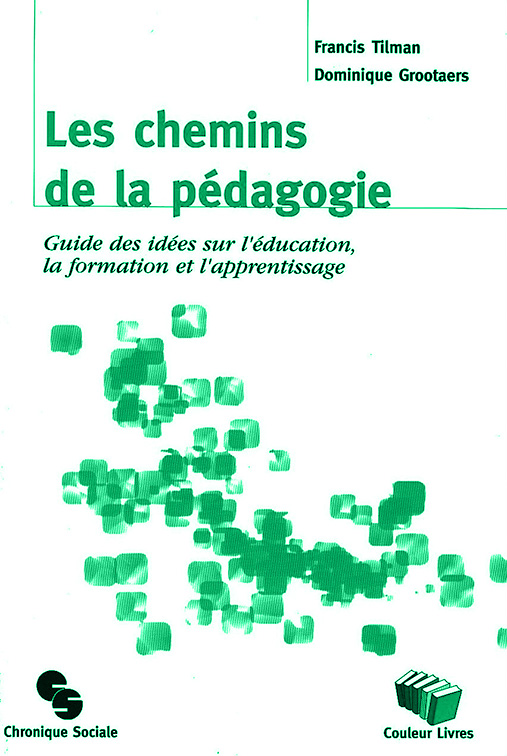
À lire pour en savoir plus sur les pédagogies, les méthodes et les techniques didactiques, auxquelles s’articulent modes et ressorts d’apprentissage (la motivation en tant que facteur d’engagement et de maintien en formation) :
Francis TILMAN et Dominique GROOTAERS, Les chemins
de la pédagogie. Guide des idées sur l’éducation, la formation et l’apprentissage, Chronique Sociale / Couleur Livres, 2006, en particulier la première partie, pp. 5-98
Au-delà de son intérêt pour qui se soucie d’éducation, de formation et d’apprentissage, cet ouvrage fournit des grilles de lecture permettant à tout·e formateur·rice de situer ses pratiques pédagogiques en lien avec ses objectifs et finalités. Chacun y trouvera des éléments qui lui permettront de « se situer et choisir, en meilleure connaissance de cause, les conceptions et démarches pédagogiques qu’il jugera les plus indiquées, par rapport à ses propres convictions et son contexte de formation » (p. 5). Mission accomplie, sans aucun doute !
- C’est le cas par exemple du cadre de référence pédagogique de Lire et Écrire, Balises pour l’alphabétisation populaire, où le terme « théories-pratiques » est utilisé p. 66, le terme « pédagogies » p. 167 et le terme « méthodes » p. 169 (voir note 2 pour les références).
- Aurélie AUDEMAR et Catherine STERCQ (coord.), Balises pour l’alphabétisation populaire. Comprendre, réfléchir et agir le monde, Lire et Écrire, 2017, p. 81, https://lire-et-ecrire.be/IMG/pdf/balises_pour_l_alphabtisation_populaire.pdf
- Philippe MEIRIEU, Sciences de l’éducation et pédagogie, www.meirieu.com/COURS/pedaetscienceseduc.pdf
- Francis TILMAN et Dominique GROOTAERS, La pédagogie émancipatrice dans le cadre des formations d’insertion socioprofessionnelle (I), octobre 2009, www.legrainasbl.org/index.php?option=com_content&view=category&id=9&Itemid=103
- Philippe MEIRIEU, Méthode pédagogique, www.meirieu.com/DICTIONNAIRE/methodepedagogique.htm
- Francis TILMAN et Dominique GROOTAERS, Les chemins de la pédagogie. Guide des
idées sur l’éducation, la formation et l’apprentissage, Chronique Sociale / Couleur Livres,
2006, p. 67. - La presque totalité de ces méthodes ont fait l’objet de dossiers ou d’articles dans le Journal de l’alpha. Si vous souhaitez en connaitre les références, vous pouvez les demander à la rédaction : journal.alpha@lire-et-ecrire.be
- Francis TILMAN et Dominique GROOTAERS, Les chemins de la pédagogie, op. cit., p. 57.
- Ces techniques peuvent aussi être considérées comme des méthodes selon la définition
de Philippe Meirieu puisque ce chercheur donne une définition plus extensive des méthodes que Francis Tilman et Dominique Grootaers. - Aurélie AUDEMAR et Catherine STERCQ (coord.), op. cit., p. 165 et suivantes.
- Mireille CIFALI, Transmission de l’expérience entre parole et écriture, in Éducation permanente, n°127, 1996-2, pp. 183-200, mireillecifali.ch/Articles_(1976-1996)_files/transmission.pdf
- Aptitude de tout acteur social à analyser sa propre activité.