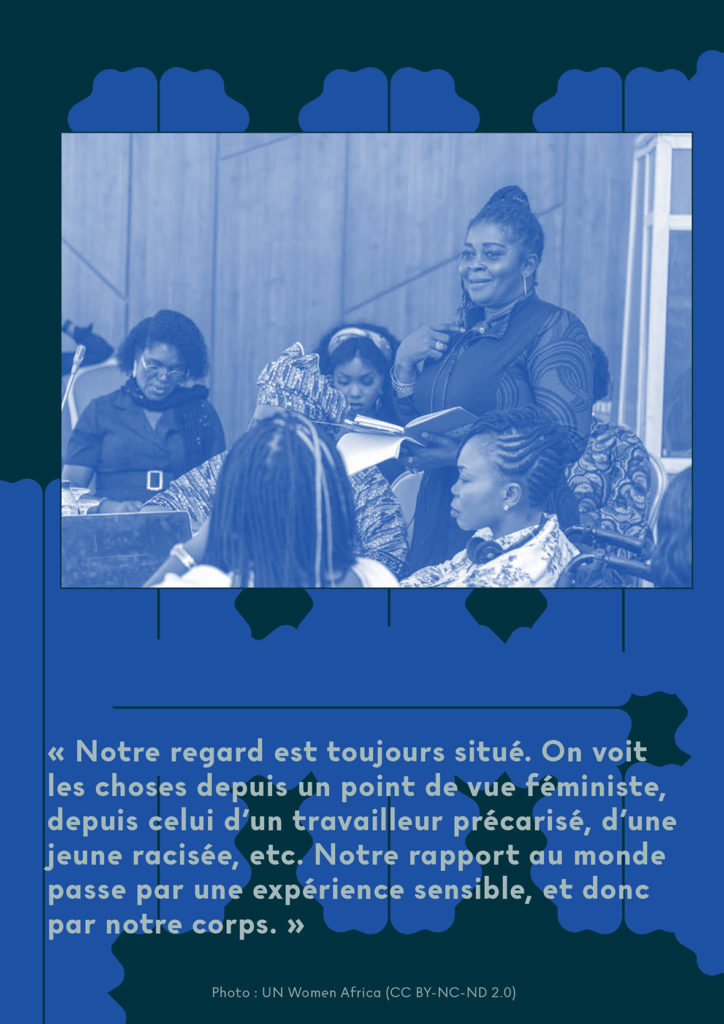Il y a quelques mois de cela, la RTBF diffusait un débat intitulé Les guérisseurs face à la science. Sur le plateau avaient été conviés un oncologue, un anthropologue, un magnétiseur-énergéticien et une coupeuse de feu. En écoutant ce débat, ou en déambulant dans les rayons « sciences sociales » des grandes enseignes, on constate à la fois le succès des croyances surnaturelles et la porosité des frontières qui distinguent sciences (naturelles ou sociales) et croyances.
Les discours scientifiques sont des constructions sociales. Il est difficilement contestable qu’ils sont produits par des chercheurs et des chercheuses en chair et en os, qui font ce qu’ils et elles peuvent dans des conditions de travail données et dans les limites autorisées par l’état des connaissances de leur époque. Il n’en reste pas moins que la science n’est pas tout à fait un discours comme un autre. Elle se distingue par l’ambition de produire des « connaissances vraies » et de le faire à partir de moyens rationnels.
C’est précisément de ces moyens que je voudrais discuter dans cet article, en limitant mon propos aux sciences sociales. Il est d’usage de considérer l’objectivité et la neutralité comme des indicateurs essentiels de la qualité d’un travail scientifique. Pourtant, on constate que différents courants de pensée mettent en doute la pertinence de ces indicateurs, et que d’autres interrogent la signification qu’il s’agit de leur donner. Qu’est-ce qu’une analyse objective ? Et que recouvre précisément l’exigence de neutralité dans le travail de recherche ?
S’il me semble utile d’aborder ici ces questions très présentes dans les débats académiques, c’est parce qu’on les croise aussi ailleurs qu’à l’université : dans les collectifs militants, dans la vie associative ou dans le monde de la culture de façon plus générale. Il n’y a aucune raison que le secteur de l’alphabétisation fasse exception.
Dans les lignes qui suivent, je procèderai en trois temps. Je commencerai par aborder brièvement le concept de neutralité axiologique attribué à Max Weber. J’évoquerai ensuite la manière dont la question de l’objectivité des connaissances se pose dans des travaux de philosophie féministe. J’essaierai enfin de tirer de ce qui précède quelques réflexions plus personnelles.
Il est peut-être utile de préciser que mon intention n’est pas d’entrer dans les subtilités des débats académiques, que ce soit à propos de l’œuvre de Weber ou de la philosophie féministe. Je les aborderai avec un opportunisme assumé, dans le but de discuter d’enjeux qui peuvent concerner chacun de nous dans son rapport au savoir.
La neutralité axiologique
En novembre 1917, à Munich, Max Weber prononce une conférence intitulée La science, profession et vocation1. On y retrouve le concept de neutralité axiologique2 auquel tout étudiant en sciences sociales se voit rapidement confronté durant sa formation. On retient généralement de ce concept la chose suivante : la pratique des sciences sociales suppose de conserver une posture de neutralité. Les chercheurs n’ont pas à porter de jugement de valeur (et donc de jugement politique) sur les phénomènes sociaux qu’ils étudient.
Voilà en tout cas la manière dont est le plus souvent présenté le concept de neutralité axiologique dans les manuels de sciences sociales. Non sans raison : Weber rappelle en effet qu’une analyse sociologique est autre chose qu’un jugement moral ou qu’une opinion politique. Elle n’est pas non plus assimilable à une dissertation dans laquelle l’auteur expose méthodiquement ses propres convictions. Il s’agit, quand on fait des sciences sociales, d’analyser le monde tel qu’il est et non tel qu’on aimerait qu’il soit.
Ces précisions sont donc importantes. Mais elles ne rendent compte que très imparfaitement de l’esprit général du propos de Weber. Pour s’en convaincre, on peut se référer au travail réalisé par la sociologue française Isabelle Kalinowski qui, il y a une petite vingtaine d’années, publiait un commentaire approfondi de la conférence de 19173.
Que constate-t-on ? Quelle est précisément la position de Weber sur l’impératif de neutralité axiologique ?
Tout d’abord, dans l’esprit de Weber, cet impératif concerne davantage les activités d’enseignement que de recherche. Dans l’Allemagne du début du 20e siècle, il n’est pas rare que des cours universitaires se mettent à ressembler à des sermons ou à des meetings politiques. Ce à quoi s’oppose Weber dans des termes sans équivoque : « Le vrai professeur se gardera bien [d’imposer à l’étudiant], du haut de sa chaire, une quelconque position, que ce soit explicitement ou par la suggestion – car la manière la plus déloyale est évidemment de ‘laisser parler les faits’. »4 On peut en effet chercher à imposer ses convictions explicitement (en les assumant) ou implicitement (en donnant l’illusion de ne présenter que des faits qui « parlent d’eux-mêmes »). Dans tous les cas, Weber dénonce cet abus de pouvoir qui consiste à profiter d’une situation asymétrique, et d’un public captif, pour imposer ses convictions.
Dans les activités de recherche, la chose est déjà bien différente. Non qu’il faille selon lui se résoudre à abdiquer tout effort de neutralité mais Weber est tout sauf un adepte d’une science tiède, frileuse, donnant des gages de neutralité par sa seule modération. La neutralité axiologique ne doit d’ailleurs pas être confondue avec la recherche du « juste milieu », lequel « n’est pas le moins du monde une vérité plus scientifique que les idéaux les plus extrêmes des partis de droite ou de gauche »5. Bien plus, « l’idée selon laquelle il conviendrait de faire ‘taire toute passion’ dans une chaire universitaire et qu’en conséquence il faudrait éliminer tout sujet qui risquerait de faire naître d’ardentes discussions ne pourrait être (…) qu’une opinion de bureaucrate que tout professeur indépendant devrait repousser »6.
On ne s’étonnera donc pas que Weber, lui-même plutôt à droite sur l’échiquier politique, ait pu défendre ardemment la légitimité d’un anarchiste à enseigner le droit. Il souligne l’intérêt pour l’université d’accueillir quelqu’un qui ne partage pas, sur sa discipline, des présupposés qui paraitraient évidents à d’autres. Il est clair, pour Weber, que la science progresse avant tout par la confrontation des idées. On ne s’étonnera pas davantage qu’il se soit énormément investi dans les débats politiques de l’époque : publications de tribunes dans les journaux, participation à la fondation d’un parti politique, etc. Ses interventions politiques sont nombreuses. Au point, rappelle Isabelle Kalinowski, d’avoir été réunies dans un épais volume de 586 pages. Voilà, minimalement, de quoi complexifier le rapport de Weber à la neutralité axiologique et faire réfléchir à la manière dont est présenté son travail dans certains manuels de sciences sociales.
Des savoirs situés
Évoquons à présent quelques travaux issus de la philosophie féministe. Il me semble intéressant de s’y pencher dans la mesure où ces travaux exercent aujourd’hui, directement ou indirectement (à travers des réappropriations militantes, de la vulgarisation scientifique, etc.), une influence importante sur la manière dont est posée la question de l’objectivité.
Aux États-Unis se sont développés, à partir des années 1980, un ensemble de travaux qui accordent beaucoup d’attention au caractère situé de nos connaissances. S’appuyant à l’origine sur un héritage marxiste, ces travaux ont emprunté à Marx l’idée que le point de vue des opprimés devait être privilégié dans une perspective de transformation sociale. Au même titre que l’étaient les « prolétaires » chez Marx, « les femmes » (ou « les féministes ») sont envisagées comme moteur de l’histoire7.
Des chercheuses, telles que Sandra Harding ou Donna Haraway, ont par la suite apporté une contribution importante à ce courant intellectuel souvent qualifié en français d’épistémologie du positionnement8. Elles soutiennent que la situation sociale de quelqu’un délimite ce qu’il lui est possible de connaitre du monde social. Il n’existe pas de vision omnisciente. On ne peut pas tout
voir, sous tous les angles et depuis toutes les perspectives possibles, nous dit Haraway9. Sa critique vise la conception traditionnelle de la neutralité et de l’objectivité scientifique qui considère qu’il n’y a de connaissance solide qu’à travers une démarche apolitique et expurgée de toute subjectivité.
En réalité, notre regard est toujours situé. On voit les choses depuis un point de vue féministe, depuis celui d’un travailleur précarisé, d’une jeune racisée, etc. Il y a derrière cette affirmation un parti pris matérialiste : notre rapport au monde passe par une expérience sensible, et donc par notre corps. Or un certain nombre de facteurs différencient les vécus : le cadre de vie confortable du bourgeois n’est pas celui de l’ouvrier, être un homme ou une femme n’est pas indifférent quand on regagne son domicile par un chemin mal éclairé, les risques encourus lors d’une garde à vue sont sans commune mesure quand on est racisé et quand on ne l’est pas, et ainsi de suite. D’où l’intérêt de prendre en considération l’influence de la matérialité de l’existence sur les productions de l’esprit : nos idées, nos valeurs, nos croyances, etc.
Voilà qui conduit Sandra Harding à soutenir, avec d’autres, l’idée d’un privilège épistémique des dominées. Elle estime que leur situation marginale, leur éloignement des centres de pouvoir, constitue un atout pour identifier les points aveugles des savoirs institués. Pensons par exemple au sexisme qui imprègne un certain nombre de savoirs mais qu’à force d’avoir sous les yeux, on finit par ne plus voir10. D’un point de vue féministe, il importe de réinterroger ces savoirs, de les déconstruire, de leur opposer d’autres approches, en particulier des approches féministes.
Harding soutient d’ailleurs que le « positionnement » politique ne constitue pas un frein à la production du savoir. On ne produit pas de bonnes connaissances malgré un ancrage féministe mais grâce à cet ancrage. Il n’est donc pas question de se résigner à un savoir de moindre qualité. Il s’agit, au contraire, de réhausser nos standards en termes de rigueur, de rationalité, et même d’objectivité. Harding parle à ce propos d’objectivité forte11, un concept important qui a été beaucoup discuté12.
Précisons tout de même qu’avec cette défense d’une objectivité forte, Harding prend assez explicitement le contrepied d’autres propositions féministes qui invitent à rompre avec les exigences de rationalité et d’objectivité que l’on assigne habituellement au discours scientifique. Et, disons-le, qui me semblent moins pertinentes pour comprendre le monde social. On retrouve d’ailleurs dans certaines réapparitions militantes de la philosophie féministe cette sensibilité plus radicalement relativiste : l’idée qu’il n’y a pas d’objectivité possible, que l’on ne peut parler que de ce qu’on expérimente à la première personne (le racisme, le sexisme, la violence au travail, etc.), et par conséquent que cette réalité reste inaccessible à celles et ceux qui n’en font pas l’expérience directe. C’est de ces enjeux qu’il sera question dans les prochains paragraphes.
Les dangers d’un relativisme radical
Qu’il s’agisse de la relecture de Max Weber par Isabelle Kalinowski, des travaux menés par des philosophes comme Donna Haraway ou Sandra Harding, on trouvera dans ces analyses matière à réfléchir sur la dimension incarnée des savoirs.
Qu’on le veuille ou non, les sciences sociales restent produites par des êtres humains qui importent forcément quelque chose d’eux-mêmes dans leurs analyses. On peut se montrer méticuleux lors de la récolte de données et d’une implacable rigueur au moment de les analyser, il n’empêche que les questions que l’on pose, la manière de les poser et l’angle privilégié pour y répondre ne vont jamais de soi. Ne serait-ce qu’en cela, les sciences sociales ne sont pas aussi apolitiques que certains aiment le croire. En ce compris lorsque les partis pris interprétatifs sont discrètement enfouis sous le tapis. Ni vu, ni connu.
Cela étant, il me semble important d’avancer prudemment sur ce terrain. Je rappelais, en introduction, que nos connaissances sont davantage que de simples croyances. La distinction entre ces deux termes est fondamentale. Une croyance, rappelle Bertrand Russell, est un fait qui a ou peut avoir une relation avec un autre fait. Je peux croire un jeudi, ou n’importe quel autre jour de la semaine, qu’aujourd’hui est jeudi. Alors qu’une connaissance suppose une certaine congruence avec le réel : s’il y a de solides raisons d’affirmer qu’aujourd’hui est jeudi, je peux alors raisonnablement le penser, jusqu’à ce qu’un élément nouveau me conduise à réviser mon jugement13.
À vrai dire, rien ne nous contraint à jeter le bébé avec l’eau du bain. On peut être attentif aux partis pris (théoriques, politiques, idéologiques, etc.) d’une analyse. L’aborder d’un œil critique en se demandant ce qu’elle doit aux modes intellectuelles du moment, aux convictions ou aux préjugés de son auteur·rice. Et, pour autant, ne pas tout réduire à des rapports de force et à des choix subjectifs. Il faut prendre garde à ce saut de raisonnement, malheureusement assez courant, qui consiste à passer du constat que « l’état de nos connaissances n’est jamais complètement étranger aux rapports de pouvoir » à cette autre idée que « les rapports de pouvoir déterminent entièrement ce qui est considéré comme vrai ».
Le grand absent de ce sophisme, c’est le réel. Et plus précisément, le rapport étroit que nos connaissances entretiennent avec le réel. Rien ne m’interdit de mettre en doute la loi de la gravitation. Je peux n’y voir qu’une simple narration, légitimée par le statut social de certains physiciens et la crédulité de leurs auditoires. Toutefois, si je décide de passer de la théorie à la pratique, en sautant du 17e étage d’un gratte-ciel, le réel se rappellera douloureusement à moi14. Comme le faisait remarquer Norbert Elias, « les philosophes, qui cherchent à savoir s’il peut arriver que les connaissances soient conformes à la réalité, ou ‘vraies’ (comme on disait autrefois), devraient plutôt se demander dans quelle mesure les êtres humains, qui dépendent totalement pour leur orientation de connaissances acquises, auraient pu survivre s’ils n’avaient pas hérité sans cesse de leurs mères et de leurs pères une bonne part de connaissances ‘vraies’, c’est-à-dire congruentes à la réalité »15.
Penser contre soi-même
Un autre enjeu mérite quelques mots à ce stade de la réflexion. Prendre conscience de ce que nos analyses doivent à notre propre rapport au monde requiert un important effort de réflexivité : d’où nous vient cet intérêt pour telle ou telle question ? Qu’est-ce qui nous pousse à l’aborder sous cette perspective ? Que nous permet-elle de voir et que nous incline-t-elle à ignorer ?
La réflexivité ne suppose pas simplement de mettre des mots sur ses affects. Elle invite toujours à penser « un peu à côté » de ce qui nous vient le plus spontanément à l’esprit. L’énervement que je ressens, et éventuellement que j’exprime, en découvrant un reportage du journal télévisé, n’est pas congédié au moment de l’analyser sociologiquement. Mais il est réinvesti dans une analyse à froid. Je m’efforce de prendre plus méthodiquement en compte les paramètres de la situation, de confronter ma première réaction à d’autres grilles d’analyse, etc. Frédéric Lordon a raison d’insister sur le fait que « la pensée n’est pas de l’ordre d’une réception du monde, mais d’un effort », et un effort à penser toujours un peu contre soi-même. « On ne pense jamais qu’à partir de ses affects – mais si possible sans s’y arrêter ni faire de la pensée leur simple réexpression. »16
Cet effort suppose aussi de regarder crument la réalité. Et de décrire, autant que possible, les choses comme elles sont, y compris lorsque cette description heurte nos convictions intimes. C’est sans doute l’une des choses les plus difficiles qui soit : ne pas confondre l’affinité (théorique ou politique) que l’on éprouve pour une idée avec sa capacité à rendre compte avec justesse de la réalité. C’est d’ailleurs, il me semble, une recommandation qui n’est pas étrangère à la pensée de Sandra Harding et à la manière dont elle conçoit l’objectivité scientifique : « La notion d’objectivité est une façon utile de penser le décalage qui doit exister entre ce que tout individu ou groupe veut que le monde soit, et ce qu’il est de fait. »17 En somme, faire des sciences sociales, c’est toujours prendre le risque d’être déçu par ce que l’on observe et analyse.
Dis-moi d’où tu parles
Cette exigence de réflexivité est donc omniprésente dans les travaux issus de l’épistémologie du positionnement, et plus généralement dans la pratique des sciences sociales. On la retrouve aussi dans les milieux militants, notamment lors de certaines prises de parole publique. Le souci de « se situer » socialement, de dire « d’où l’on parle », n’est pas sans lien avec l’idée, déjà évoquée, que personne ne s’exprime « depuis nulle part ».
Cet effort de réflexivité n’a toutefois rien d’évident. La difficulté consiste à exprimer, souvent en quelques mots, les déterminants qui dictent notre pensée ou notre action. Énumérer quelques indicateurs conventionnels (la classe, le genre, la couleur de peau, l’orientation sexuelle), comme on déclinerait son état civil dans un commissariat, n’apporte en réalité pas grand-chose. Et a même toutes les chances de produire l’effet inverse de celui recherché : satisfait d’en avoir terminé avec cet exercice de style, on peut passer à la suite, dans l’illusion d’être au clair sur soi-même et d’avoir été transparent pour autrui.
Le problème de ces grands marqueurs identitaires est au moins double. D’une part, on finit par les mobiliser par réflexe, sans se questionner sur ce qui influence de façon déterminante la manière dont nous nous comportons dans un contexte précis. Ainsi, le concept d’« intersectionnalité » perd de son intérêt quand il ne sert qu’à répéter mécaniquement qu’il faut « penser ensemble la classe, le genre et la ‘race’ ». On cesse d’interroger la pertinence de ces facteurs, dans un contexte donné, une fois que l’on en a fait un syntagme figé. Tout autre chose consiste à penser concrètement (empiriquement) la manière dont s’imbriquent un ensemble de facteurs dans une relation de domination.
D’autre part, la connaissance de soi passe par la capacité à se situer relationnellement, dans un espace social qui nous englobe, mais qui n’englobe pas que nous. Notre « point de vue », c’est-à-dire littéralement le lieu topographique « d’où l’on parle »18, n’est pas un point fixe situé sur une carte inamovible. Politiquement, on peut ainsi être « de gauche » à une époque très réactionnaire, puis de « centre-droit », vingt ans plus tard quand émergent de nouvelles pensées contestataires, tout en ayant conservé exactement les mêmes convictions politiques.
Dans le même esprit, on peut aussi questionner l’idée qu’on ne parle avec justesse que de ce qu’on a vécu à la première personne. Si l’on suit ce raisonnement, on devrait en déduire que chacun serait le mieux placé (et le plus légitime) pour parler de ce qu’« il est » ou « de là d’où il vient ».
Les choses ne sont pourtant pas si simples. Il est vrai que la familiarité avec ce dont on parle comporte bien des avantages. Une aide-soignante ou un ouvrier de la voirie, par exemple, ont de leur profession une connaissance pratique. Dans un sens, ils connaissent, même sans avoir à la verbaliser, la dureté du métier, la fatigue ressentie après une journée de travail, la nature des relations entre collègues ou avec les supérieurs hiérarchiques, etc.
Mais passer de l’expérience à la connaissance théorique n’a rien d’automatique. C’est d’ailleurs une critique que l’on retrouve, au sein même de la philosophie féministe, à l’égard de la notion de privilège épistémique. Des chercheuses relèvent ainsi que l’expérience de l’oppression ne fournit pas, en soi, une interprétation théorique fiable et une lecture politique de ce qui est en jeu19. Ce travail d’interprétation requiert, entre autres, de prendre suffisamment de distance à l’égard de son vécu pour être capable d’en identifier les causes et de le restituer dans des dynamiques collectives.
De plus, la proximité avec le réel que l’on questionne ne comporte pas que des avantages. C’est ce que laisse entendre Ludwig Wittgenstein quand il écrit : « Les aspects des choses les plus importants pour nous sont cachés du fait de leur simplicité et de leur banalité. (On peut ne pas remarquer quelque chose – parce qu’on l’a toujours sous les yeux). »20 Nous faisons d’ailleurs tous et toutes régulièrement l’expérience de cette difficulté qui consiste à se mettre au clair avec ce que l’on vit et à réellement « voir » ce que l’on a déjà sous les yeux.
En définitive, la difficulté consiste à ne pas se raconter d’histoires. La réflexivité qu’enseignent les sciences sociales permet-elle de s’en raconter un peu moins ? On peut en tous cas l’espérer.
- Une traduction française de cette conférence est publiée dans l’ouvrage référencé dans
la note 3. - Le terme « axiologie » fait référence à l’étude des valeurs morales.
- Max WEBER, Isabelle KALINOWSKI, La science, profession et vocation. Suivi de Leçons wébériennes sur la science et la propagande, Agone, Marseille, 2005.
- Ibid., p. 40.
- Ibid., p. 197.
- Max WEBER, Essai sur la théorie de la science, Plon (Pocket), Paris, 1965, p. 368.
- Voir notamment Artemisa Flores-Espinola, Subjectivité et connaissance : réflexions sur les épistémologies du ‘point de vue’, in Cahiers du Genre, n°53, 2012/2, pp. 99-120, www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2012-2-page-99.html
- Ou « épistémologie du point de vue », selon les traductions. Le terme « épistémologie » renvoie aux conditions nécessaires pour produire de la connaissance.
- Donna Haraway, Savoirs situés : la question de la science dans le féminisme et le privilège de la perspective partielle, in Donna Haraway, Manifeste cyborg et autres essais, Exils, 2007 (1re édition en 1988), pp. 107-142, https://monoskop.org/images/1/13/Haraway_Donna
- « Comment puis-je prétendre porter un jugement global et sérieux sur une population dont je m’acharne depuis cinquante ans à découvrir les mœurs et les croyances si je néglige d’en observer de près une moitié ? », s’interrogeait le médiéviste Georges Duby. En cause, pas tant (ou pas seulement) le regard (situé) d’un homme sur le passé, mais la difficulté de réunir des sources témoignant de la vie quotidienne des femmes à l’intérieur de sociétés où ce sont les hommes (et surtout les hommes d’Église) qui ont accès à l’écrit. Voir Georges DUBY, L’histoire continue, Odile Jacob, Paris, 1991, pp. 211-212.
- Sandra Harding, Repenser l’épistémologie du positionnement : qu’est-ce que ‘l’objectivité forte’ ?, in Manon Garcia (dir.), Philosophie féministe. Patriarcat, savoirs, justice, Vrin, Paris, 2021, pp. 129-187.
- De manière générale, des critiques de cette épistémologie du positionnement pointent entre autres la rareté des référents empiriques, le flou de certaines propositions, le caractère autarcique de discours qui ne favorisent guère la cumulativité du savoir. On retrouvera certaines de ces critiques dans Julie PATARIN-JOSSEC, Comment ne pas construire un discours scientifique. Note exploratoire sur les ‘épistémologies féministes’ du point de vue, in Le Carnet Zilsel, décembre 2015, https://shs.hal.science/halshs-02304910/document
- Bertrand Russell, Histoire de mes idées philosophiques, Gallimard, Paris, 1988 (1re édition en 1959), p. 234.
- J’emprunte cet exemple à Samuel Joshua, De la portée politique du débat sur les relations entre les ‘sciences’ et le ‘réel’, in Contretemps, n°1, mai 2001, pp. 115-125,
www.contretemps.eu/wp-content/uploads/Contretemps-01-59-64.pdf - Norbert Elias, La dynamique sociale de la conscience. Sociologie de la connaissance et des sciences, La Découverte, Paris, 2016, pp. 279-280. Bernard Lahire, qui cite Elias pour appuyer son propos, développe dans un ouvrage récent une longue et érudite défense de cet argument « réaliste » (Bernard Lahire, Les structures fondamentales des sociétés humaines, La Découverte, Paris, 2023).
- Frédéric LORDON, Imperium. Structures et affects des corps politiques, La fabrique, Paris, 2015, p. 31.
- Sandra HARDING, op. cit., p. 183.
- Cette métaphore du « point de vue » est aussi souvent utilisée par Bourdieu. Voir notamment Pierre Bourdieu, L’objectivation participante, in Actes de la recherche en sciences sociales, n°150, 2003/5, pp. 43-58, www.cairn.info/revue-actes
- C’est notamment le cas de Joan Scott et de Paula Moya. Voir à ce propos Sarah BRACKE, Maria PUIG DE LA BELLACASA, Isabelle CLAIR, Le féminisme du positionnement. Héritage et perspectives contemporaines, in Cahier du Genre, n°64, 2013/1, p. 45-66, www.cairn.info/revue-cahiers
- Ludwig Wittgenstein, Recherches philosophiques, Gallimard, Paris, 2004 (1re édition en 1953), p. 88.