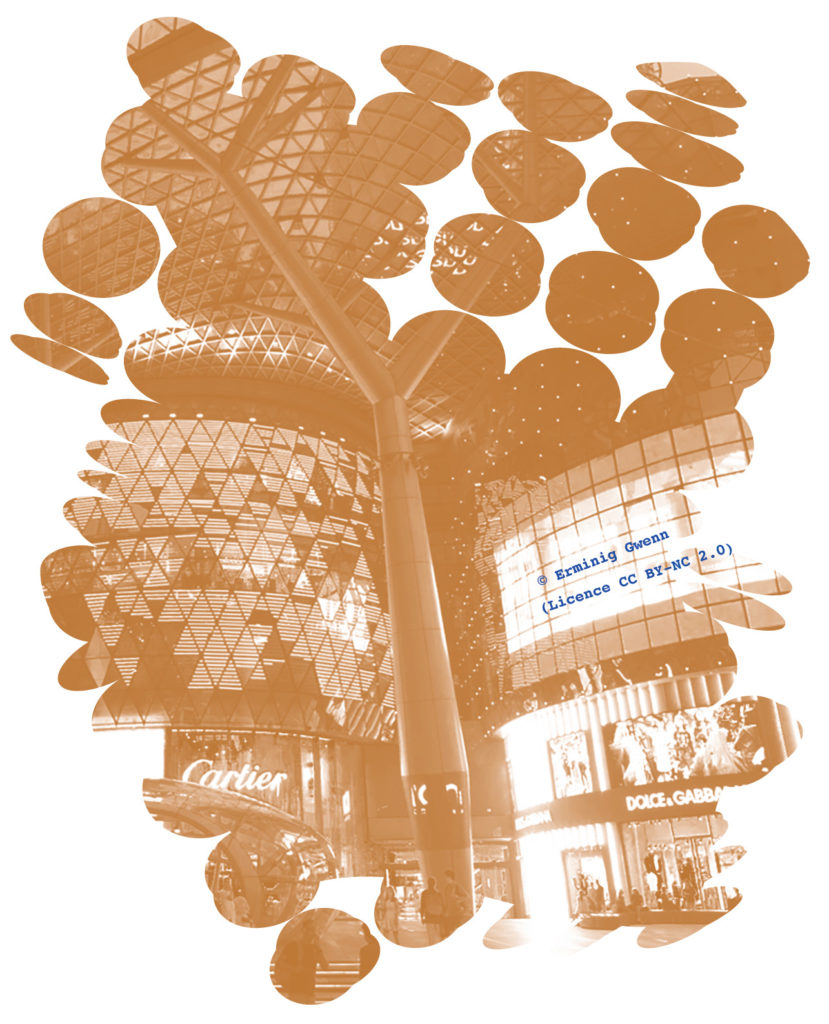La pauvreté est présente, vécue, pensée, évaluée, bien qu’elle semble inéluctable. Souvent appréhendée de manière comparative, elle est d’autant moins évidente à définir. Son caractère multidimensionnel fait naitre un nombre incalculable de débats qu’ils soient théoriques, empiriques ou politiques, montrant la difficulté de faire face au mal chronique et grandissant que la pauvreté engendre. Ces approches sont interdépendantes bien souvent de celles de la précarité, de l’inégalité, de l’exclusion et de la discrimination mais on ne sait parler de pauvreté sans définition officielle parce qu’elle nécessite des indicateurs, des critères, qu’ils soient d’ordre économique, social ou encore culturel, qu’ici et ailleurs semblent tout autant difficiles à repérer, à choisir et à institutionnaliser.
Une approche sociologique de la pauvreté est celle qui m’intéressera ici dans un premier temps parce qu’elle contextualise, elle permet de clarifier ce qu’on entend par pauvreté ici et maintenant. La question que le sociologue Serge Paugam a qualifiée d’essentielle « est simple : qu’est-ce qui fait qu’un pauvre, dans une société donnée, est pauvre et rien que pauvre ? Autrement dit, qu’est-ce qui constitue le statut social de pauvre ? »1. Formatrice comme citoyenne, je m’interroge : qu’est-ce qui peut me faire penser que les apprenant·e·s sont pauvres ? Qu’est-ce qui constitue ce statut ? Se voient-ils·elles comme pauvres ? Qu’en sera-t-il de ma posture de formatrice ? Quelle sera la tendance dans mes approches pédagogiques ?
Dans un second temps, je tenterai de puiser des éléments de réponse dans une approche philosophique de la pauvreté pour les associer à nos réalités et pour questionner voire bousculer nos postures. Formatrice auprès d’un public primo-arrivant en situation d’analphabétisme, ces questionnements me donnent matière à réfléchir sur ma posture et mes approches didactiques et pédagogiques.
De la sociologie aux critères institutionnels
Début du XXème siècle, le sociologue allemand Georg Simmel aurait été le premier à clarifier les problèmes posés par la définition de la pauvreté. Ses écrits sont considérés comme le premier éclairage de la sociologie de la pauvreté, c’est-à-dire que le statut de pauvre se définit par la réaction sociale et non au regard de sa seule situation qui pourrait être mesurée, « celui qui reçoit l’assistance ou qui devrait la recevoir étant donné sa situation sociologique (…) »2. La situation de pauvreté s’entend par recevoir assistance de la collectivité selon les normes sociales instituées, par là même s’entend une dépendance vis-à-vis des autres, voire une forme de dévalorisation : « Le pauvre, récipiendaire de secours qui lui sont spécialement destinés, doit accepter de vivre, ne fût-ce que temporairement, avec l’image négative que lui renvoie la société, et qu’il finit par intérioriser, de n’être plus utile, de faire partie de ce que l’on nomme parfois les “indésirables”»3. Dans ce concept sociologique, il s’agit d’étudier, non pas la pauvreté à travers des perspectives descriptives et quantitatives, mais plutôt la relation d’assistance, c’est-à-dire les dépendances entre les pauvres et la société. Ainsi le concept de pauvreté dite relative est né, se distinguant alors de celui de pauvreté absolue. Le premier considère des niveaux de besoins variables auxquels les personnes pauvres ne peuvent répondre, en prenant compte des indicateurs variables, liés aux personnes, aux milieux, aux revenus de tous, etc. Le second, lui, fixe un niveau de besoin, le plus souvent monétaire et qui correspond davantage à un seuil de survie.
C’est ainsi que la pauvreté prend des formes différentes selon les sociétés et leurs évolutions. En Europe, les politiques nationales et communes sont guidées par la pauvreté relative : le seuil de pauvreté repose sur un indicateur d’inégalité de la répartition des revenus c’est-à-dire qu’il est fixé à 60% du revenu médian, ce revenu est celui qui coupe la population en deux parties égales. D’autres indicateurs sont encore utilisés pour mesurer, au-delà de l’aspect monétaire (privation matérielle, intensité du travail, etc.)4. Dans les années 1980, l’Union européenne décrit alors comme pauvres « les personnes dont les ressources (matérielles, culturelles et sociales) sont si faibles qu’elles sont exclues des modes de vie minimaux acceptables dans l’État membre dans lequel elles vivent »5. La réalité de la pauvreté se définit donc à un moment donné dans une société donnée.
L’étude de la pauvreté a amené alors à catégoriser, distinguer, qualifier, décrire toutes les formes d’inégalité, d’exclusion, de précarité, parce qu’en tous points la pauvreté est insupportable comme inacceptable en particulier dans nos démocraties prospères. Je ne tenterai pas ici de présenter l’exhaustivité des études sur le sujet tant elles sont riches et nombreuses, mais j’essaierai de transférer ces questionnements dans mon métier.
Nos apprenant·e·s sont majoritairement des personnes primo-arrivantes, peu ou non scolarisées dans leurs pays, inscrites au parcours d’accueil bruxellois francophone. À l’échelle de mes observations en tant que formatrice en alphabétisation, mes groupes sont composés de femmes et d’hommes, dont la plupart ont le statut de réfugié·e et bénéficient d’une aide sociale ici en Belgique. Loin de moi l’idée de fouiller dans les statistiques et les indicateurs, mais je pourrais d’ores et déjà déduire selon certains critères que ces personnes sont institutionnellement et sociologiquement désignées comme pauvres.
Désigner les pauvres ou considérer les riches histoires de vie
Si l’approche sociologique de Georg Simmel entre autres a montré que le statut de pauvre était finalement donné par l’extérieur du fait de la nécessaire assistance de la collectivité, l’approche philosophique s’intéresse davantage aux individus et à leurs représentations.
L’identification du pauvre par l’extérieur, par la réaction sociale est ce qui m’a particulièrement questionnée dans mon métier de formatrice. Et si la situation de pauvreté est identifiée à partir des normes sociales instituées, quelles sont-elles ? Notre public connait-il ces normes ? Les comprend-il ? Les accepte-t-il ? Quel est mon regard sur eux·elles ? Et quels seront les impacts sur mon attitude et ma posture de formatrice ?
Au-delà de l’aspect linguistique, nos cours sont des lieux, des moments où s’installe la confiance à travers les échanges et témoignages que nous, formateur·rice·s, installons et recevons. Quel regard portent les apprenant·e·s sur leur situation ?
Lors d’une démarche pédagogique avec un groupe en alphabétisation s’ouvre la question « quel est ton rêve ? ». Une libre discussion s’en suit alors, le lexique s’élargit et je pose la question franchement, à savoir s’ils·elles se sentent riches ou pauvres. Si la plupart des réponses se mêlent à la gratitude (au sens spirituel voire religieux) « Pas riche, pas pauvre, tout va bien », d’autres réponses se mêlent à la tristesse voire à la colère, car leur situation d’aujourd’hui est marquée par un changement, une rupture, un appauvrissement brutal et j’entends « qu’avant tout allait bien ». La réalité est que nos groupes sont composés majoritairement de personnes réfugiées. Le statut de ces personnes contraintes à fuir a subi une mobilité socioéconomique descendante et à leurs yeux comme aux nôtres dans le pays d’accueil, elles deviennent vulnérables et dépendantes. Dans la société d’accueil et ses normes instituées, ces personnes sont devenues pauvres.
Mes réflexions me portent à m’éloigner de ce regard institutionnel et sociologique et me mènent à une approche philosophique. Dans un essai publié en octobre 2022, le philosophe Guillaume Le Blanc propose de considérer l’histoire des vies pauvres comme riches de sens politique et philosophique à l’heure du primat économique. D’après lui, « On a trop tendance à plaquer sur les vies pauvres la grille de l’homme économique et, en les appréhendant seulement à partir de l’aisance matérielle, du travail et des loisirs, à n’y voir ainsi que des vies en défaut, des vies de manque »6. Son analyse est fondée sur la question du regard d’un non-pauvre sur les pauvres et m’invite à réfléchir sur l’implicite des termes. L’assimilation du fait d’être pauvre à une pauvre vie peut se voir contredite lorsqu’on met en lumière la richesse dans la pauvreté au travers de la littérature, de la philosophie, de la politique, de la spiritualité, de la culture et des traditions. Il propose de restituer cette richesse sans omettre la réalité de la pauvreté : « Les vies pauvres ne sont pas de pauvres vies : il y a urgence à considérer l’histoire des vies pauvres comme riche de sens politique et philosophique à l’heure du primat économique ». Son intention est de rendre les personnes pauvres visibles, audibles, que l’ensemble de leurs paroles soit organisé et porté. Ainsi, dans mes réflexions et en tant que formatrice, je comprends que cette intention se recoupe avec le projet politique et philosophique qu’est l’alphabétisation populaire : « Au-delà de l’acquisition de savoirs, elle vise une reprise de pouvoir sur sa vie et le changement social. Le but du formateur n’est plus seulement d’apprendre quelque chose à son interlocuteur mais de rechercher avec lui les moyens de transformer le monde dans lequel il vit »7.
Considérer la richesse des vies dans les pratiques didactiques
Dans un article en 2008 concernant la formation linguistique des adultes migrants, Mariela de Ferrari, didacticienne des langues questionne la notion de difficulté : « la prégnance de la notion de “difficulté” comme caractéristique présupposée de ces publics aura accentué la représentation minorée de ces populations. Confusion entre difficultés sociales et besoins linguistiques en situation de communication : incompréhension avec les agents de l’administration, compréhension partielle des courriers institution-nels… Au lieu d’envisager l’analyse des “difficultés” comme extérie-ures aux personnes car on rencontre des difficultés, on aura fait glisser les besoins vers les personnes elles-mêmes, comme si les difficultés leur étaient propres : “elles sont en difficulté” ; “publics en difficultés” »8 . Les difficultés ne se voient plus comme rencontrées, mais se voient comme propres aux personnes.
Si nos normes sociales instituées font entrer nos apprenant·e·s dans les désignations de « pauvres », « précaires », « fragiles », « vulnérables », les normes pédagogiques les font-elles entrer dans la désignation « en difficulté » ? Je peux me poser la question autrement : ne sont-ils·elles pas plutôt fragilisé·e·s par les conditions de vie ici dans la société d’accueil que véritablement fragiles ? En est-il de même dans la formation linguistique et particulièrement en alphabétisation ? Quel regard je porte, en tant que formatrice, sur les apprenants·e·s ? Le choix des approches pédagogiques tend-il à les percevoir comme fragiles ? Ou bien, ne devrais-je pas plutôt porter mon attention à reconnaitre leur courage, leur volonté, leurs savoirs, leurs stratégies et à considérer leur vie riche de sens ?
À travers ces derniers questionnements, je souhaitais mettre en lumière ce que beaucoup d’entre nous essayons de mettre en œuvre, à savoir refuser la désignation, la stigmatisation et le fatalisme, à savoir prendre conscience qu’il existe différentes manières de voir et percevoir, à savoir prendre de la distance par rapport à ce qui nous semble évident pour accompagner, faciliter, soutenir et ne pas renoncer. Il n’y a pas de réponse toute faite, il s’agit, pour moi, d’essayer d’envisager la richesse des personnes apprenantes et d’intégrer à nos démarches, leurs richesses culturelles, leurs savoirs artistiques, culinaires comme linguistiques, leur force de vie, leur courage, leur sens du partage, leur volonté et tant d’autres richesses humaines. Nul besoin de grand projet, il suffit peut-être de les garder en tête, de les voir, de les faire émerger un peu ou grandement à des moments opportuns des processus d’apprentissage.
Conclusion
D’un apport sociologique, qui identifie et désigne les pauvres, à un apport philosophique, qui propose de considérer la vie pauvre comme riche de sens, on pourrait voir émerger les concepts de la pédagogie libératrice, celle de Paulo Freire. À l’échelle qui est la mienne, celle de formatrice et de citoyenne, ces lectures pluridisciplinaires ont mis à l’épreuve mes regards, mes considérations, mes actes et ma pratique. Dès lors, la question ne sera pas de savoir s’ils·elles se sentent riches ou pauvres, mais de faire en sorte, au travers de la pratique pédagogique, que leur parole soit portée et entendue, pour lire et écrire leur réalité.
- Serge PAUGAM, Science et conscience de la pauvreté, in L’Économie politique, n°26, 2005/2, pp. 66-79, https://www.cairn.info/revue-l-economie-politique-2005-2-page-66.htm.
- Georg SIMMEL, Les Pauvres (1re éd. en allemand : 1907), coll. « Quadrige », PUF, 1998.
- Serge PAUGAM, op.cit.
- Voir sur cette question l’article d’Aurélie LEROY, La mesure de la pauvreté, une question technique mais aussi sociale, pp. 17-26.
- Conseil des ministres de l’Union européenne, 19 décembre 1984.
- Guillaume LE BLANC, La solidarité des éprouvés : pour une histoire politique de la pauvreté, Éditions Payot, 2022.
- Aurélie AUDEMAR et Catherine STERCQ (ss.coord.), Balises pour l’alphabétisation populaire. Comprendre, réfléchir et agir le monde, Lire et Écrire, 2017, p 82, https://lire-et-ecrire.be/balises.
- Mariela DE FERRARI, Penser la formation linguistique des adultes migrants en France. Nommer autrement pour faire différemment, in Le Français dans le monde/Recherches et applications, n°44, juillet 2008, pp. 20-28.