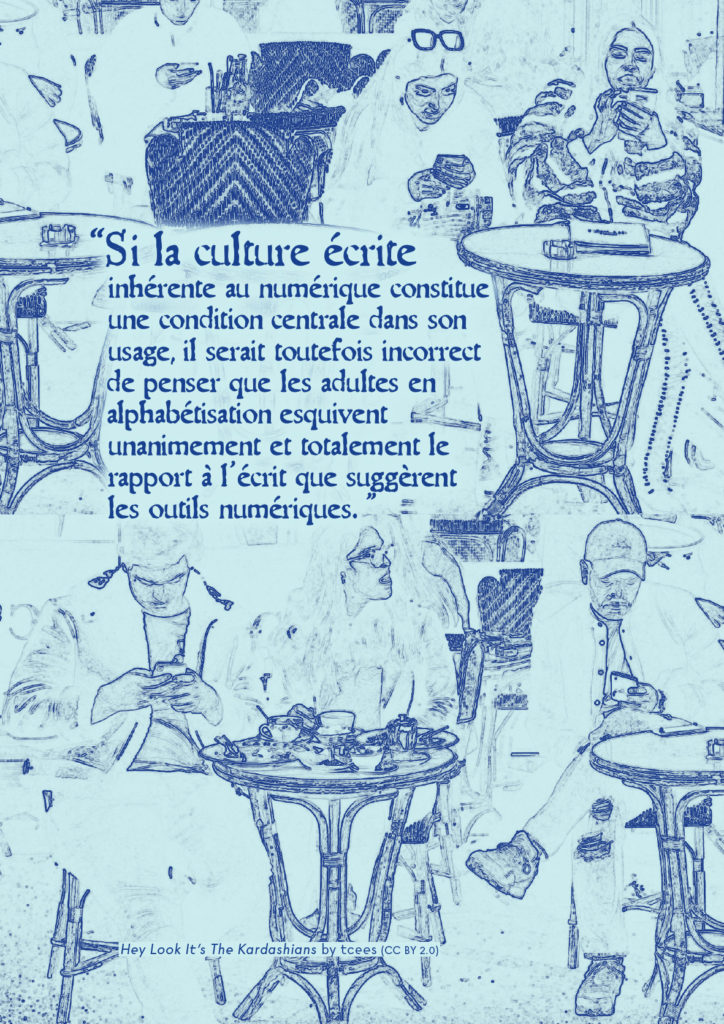La culture écrite serait hermétique aux personnes en situation d’illettrisme. Le texte ne représenterait qu’un code à déchiffrer. La lecture ne serait dès lors réservée qu’aux populations diplômées et le franchissement de cette frontière culturelle ne pourrait être admis qu’à travers le passe-droit de la culture scolaire.
Ce postulat tend toutefois à être ébranlé face à l’avènement du numérique et de sa présence dans l’ensemble des activités de la vie quotidienne. En effet, si l’écrit tient les personnes peu scolarisées éloignées des biens littéraires et s’érige indéniablement en rempart pour une compréhension soutenue et continue de l’information, les TIC (technologies de l’information et de la communication), de leur côté, offrent différentes possibilités de rapprochement entre deux mondes couramment tenus à distance : celui de l’illettrisme et celui de la lecture. Cet article nous permettra de mettre en lumière ce phénomène en prenant appui sur les usages numériques de quelques personnes en formation d’alphabétisation à partir de résultats tirés d’une étude publiée fin 20221. Étant donné que les outils numériques représentent des biens culturels, nous allons d’abord voir dans quelle mesure ceux-ci sont appropriés, ou du moins abordés, par les apprenant·es avant de s’attarder sur les pratiques de lecture à travers ces supports.
Une proximité sous conditions
Comment des outils dont l’utilisation dépend essentiellement du texte arrivent-ils dans les mains de personnes peu familières avec la forme scripturale ? La question se doit d’être posée préalablement, car comme pour d’autres médias culturels, à l’instar de la photo-graphie2, de la télévision3 ou de la littérature4, l’appropriation se déroule différemment selon la classe sociale dont chacun·e est issu·e.
Dit autrement, elle est fonction de la position sociale occupée par chacun·e, c’est-à-dire, de manière schématique, du métier exercé et du niveau de diplôme atteint au regard des autres professions et types de diplômes.
À ce titre, « l’informatique connectée »5 a d’abord été appropriée à grande échelle par les populations qui en ont fait la rencontre à travers leur scolarité et l’occupation de professions essentiellement situées dans le secteur tertiaire6. C’est dans un second temps qu’elle s’est peu à peu frayé un chemin au sein de la population dans son ensemble et qu’elle a percé dans les classes populaires. Pour une partie significative des apprenant·es rencontré·es7, nous pouvons ainsi observer que le numérique s’est fait une place dans leur vie par le biais de membres de la famille comme leurs conjoint·es, enfants et petits-enfants.
Dans ces différentes situations, l’initiative n’est pas individuelle, elle prend forme en raison de différentes contingences difficilement esquivables. Cela concerne par exemple l’obtention d’un smartphone car le·la conjoint·e ou les enfants s’en procurent un nouveau ; la réception d’un téléphone portable afin de faciliter l’organisation familiale ; l’installation d’applications mobiles par les enfants et petits-enfants, premier·es investi·es par ce type d’utilisation. Dans d’autres cas, le rapprochement avec les TIC s’opère par le biais de formations au numérique proposées dans les cadres scolaires ou d’insertion socioprofessionnelle. Il peut aussi apparaitre comme une nécessité pour d’autres afin de rester en contact avec les proches vivant dans le pays d’origine. Tous n’ont cependant pas d’ordinateur, fixe ou portable. De même, la possession d’un tel outil n’implique pas toujours son utilisation.
De la lecture par expérience et habituation
Si la culture écrite inhérente au numérique constitue une condition centrale dans son usage, il serait toutefois incorrect de penser que les adultes en alphabétisation esquivent unanimement et totalement le rapport à l’écrit que suggèrent les outils numériques. Divers types de pratiques de lecture peuvent ainsi être déployés par les apprenant·es rencontré·es via l’utilisation de l’informatique connectée8.
Ces pratiques se cristallisent autour de deux types d’usage. D’une part, dans un rapport « éthico-pratique »9 à l’objet numérique, c’est-à-dire à travers ce que Bernard Lahire désigne par « un ancrage plus immédiat aux éléments de l’expérience quotidienne », appuyant par là « leur intérêt pour les choses locales, les “choses de la vie” »10. D’autre part, « le faible niveau de culture technique s’avère souvent suffisant pour satisfaire les attentes que l’acteur investit dans son usage »11. À ce titre, comme on l’a déjà illustré, « les usages s’insèrent dans des pratiques sociales et familiales préexistantes »12. Ainsi, la plupart des apprenant·es sont inscrit·es sur des réseaux sociaux numériques, comme Facebook pour la majorité. L’emploi de ces sites/applications occupe une place essentielle dans le développement de pratiques de lecture. Cela s’observe notamment à travers la diffusion d’informations par ce canal. De fait, les réseaux sociaux numériques conduisent à une rencontre directe avec l’écrit. Indépendamment de toute recherche, « l’information est devenue immédiatement et partout disponible »13. Alors qu’avec le support papier, c’est à la personne de faire le pas vers l’information, avec les réseaux sociaux virtuels, c’est l’information scripturale qui vient à l’utilisateur·rice. Cette transmission se fait par exemple par le partage de contenus entre contacts et depuis des « pages » de référence. Christophe, 53 ans, rencontré dans une des régionales de Lire et Écrire, déclare lire à son rythme tout ce que ses contacts ou les pages suivies publient sur le réseau : « Je lis tout ce qu’on met sur Facebook, mais j’y vais doucement. Ouais, doucement. (…) Je lis tout ce qui passe, mais je [ne clique pas sur les liens], je lis ce qui est mis et puis je passe. »
De son côté, Aïssa, 40 ans, estime, par comparaison, que son utilisation des réseaux sociaux l’incite à s’améliorer dans la lecture. Dynamique dans laquelle l’engage également sa formatrice par ses encouragements :
« Je lis [insistant] beaucoup quand je suis sur Facebook. Je pense que c’est ça qui m’a fait [progresser]. J’ai même dit ça à [notre formatrice], elle m’a dit que c’était bien. Au début, mon homme se plaignait que j’étais sur les réseaux, mais en attendant, il oublie que quand je suis sur les réseaux, je lis ! Je lis. Donc j’ai même dit ça à [notre formatrice], elle m’a dit : “Du moment que tu lis ! Sur les réseaux, au fond, du moment que tu lis, tout ce que tu vois, tu vas le lire, tu vas te mettre dans la chose”. Elle avait raison. “Sur les réseaux, tu lis, donc il n’y a pas de mal à ça ! ; Quand tu es attentif, tu lis tout ce qui est sur les réseaux, pour finir, tu vas lire facilement, sans problème, ne l’écoute pas ! Dis à ton mari que ça ne dérange pas ta formatrice !”. Et maintenant, même lui, il se rend compte que je lis mieux. »
Ces pratiques reposent sur des lectures difficilement quantifiables, elles sont « non comptabilisées [et] s’attachent à des écrits à faible légitimité culturelle »14. Cependant, cette habituation à de la culture écrite tenue dans le creux de la main représente un ressort supplémentaire pour s’engager dans des pratiques de lecture. En effet, comme l’exprime Roger Chartier, « ceux qui sont désignés comme non-lecteur·rices lisent, mais autre chose que ce que le canon scolaire définit comme une lecture légitime »15. L’historien du livre et de la lecture fait à ce sujet référence aux « pratiques infinies, disséminées et multiples qui s’emparent de multiples matériaux imprimés et écrits, tout au long d’une journée ou d’une existence16. »
Les faits divers diffusés par la presse en ligne sont aussi susceptibles d’inciter à la lecture. En effet, par leur évocation du local et de « choses de la vie », ils se rapprochent d’inclinations davantage caractéristiques des populations peu diplômées. Ce type de lecture peut par exemple être observé avec Colette, 78 ans :
« J’essaie de lire quand même les [insistant et riant] bêtises qu’ils marquent ! Et après, je ris toute seule. (…) Donc c’est juste pour lire leurs bêtises ou alors quand il y a eu un attentat ou l’accident à Jemeppe, j’ai le journal et les photos et… et ça, j’essaie de lire aussi. Ce qui s’est passé, la brocante ou… Tout ça, j’essaie de lire un petit peu. À mon rythme. »
Un début d’« appétence »17 pour la lecture peut d’ailleurs être développé par Colette grâce à la fréquente rencontre avec l’écrit que suggère internet. Renforcée par son suivi de la formation en alphabétisation, elle en vient à mettre en œuvre une forme domestique d’apprentissage de la lecture à travers une dynamique d’essai-erreur et d’exposition, quand elle le souhaite, de sa propre mise à l’épreuve afin de se corriger :
- Colette : « Parfois, quand je suis sur l’ordinateur, je lis, par exemple “Il y a eu un accident à Jemeppe” et s’il y a des mots que je ne sais pas lire tout de suite, je les marque, je les écris sur un bout de papier et après, quand j’ai mon esprit bien tranquille, j’essaie de le lire. Et après, quand je l’ai lu, je vais près de mon mari et je dis : – “J’ai lu ça, c’est bien ça ?” ; “Oui”. Et donc je le lis devant mon mari. Je lis le mot, sans savoir de… Parce que j’ai très difficile, il y a des mots, ça va tout seul et il y a des mots que c’est du chinois pour moi. »
- Et ça, tu le faisais avant, quand le journal était posté chez vous ?
- Colette : « Non, non, je faisais pas tout ça. C’est depuis que je viens à [Lire et Écrire] que je fais ça. Souvent c’est sur Facebook. Ou sur le journal L’avenir et tout ça, parce que j’ai L’avenir, alors je clique sur L’avenir et j’essaie de lire ce qui est marqué, quoi. (…) Et avant [de venir en formation], on l’avait aussi sur Facebook, quand il y a le journal, je ne regardais même pas. Je n’ouvrais même pas la page. Alors que maintenant, je l’ouvre. J’essaie, c’est pour me forcer à lire un petit peu. Alors que bien souvent quand il y a des feuilles à achever à la maison, que [la formatrice] nous a données, je le ferai pas. Tandis que ça, je vais l’ouvrir, depuis que je viens ici, je vais sur le PC et je lis (…) ça, je vais l’ouvrir. Le journal dans le PC, je l’ouvre et je lis ce qu’il y a, quoi. »
C’est aussi dans une dynamique d’apprentissage que Gérard, 70 ans, a décidé de procéder à de brefs écrits sur des logiciels de traitement de texte. Ainsi, il recopie des recettes de cuisine, ce qui l’amène à s’exercer au clavier d’ordinateur mais aussi, comme il l’exprime, et dans le cadre qui nous préoccupe, « à [le] faire lire en même temps ».
Une autre stratégie domestique de familiarisation avec la lecture peut également être relevée chez les apprenant·es. Elle consiste à développer son autonomie par l’utilisation d’applications orales en vue de renforcer son orthographe. C’est ce qu’illustre Aïssa avec son emploi de l’assistant Google, assistant personnel « intelligent » disposant d’une interface vocale :
« Avec mon téléphone, je vais sur Google et par exemple, quand je dois aller faire des courses au supermarché, je connais les noms des aliments mais je sais pas les écrire. Donc je prends Google et je fais ma liste de courses. Et ça, c’est depuis que je suis à Lire et Écrire que j’ai commencé à faire ça. Par exemple, si je veux écrire “poireau” : “Google, comment on écrit ‘poireau’ ?”. Je parle à Google et Google écrit. Et quand Google écrit, [insistant] il faut savoir lire. Je lis et je note sur mon bout de papier. (…) “Comment tu écris ‘petits pois’ ?”, et puis j’écris. Avant d’aller au magasin, je prends ma feuille blanche, je fais ma liste avec Google. Je note tous les aliments. Quand j’arrive au supermarché, ma feuille est là et puis je rentre dans le rayon. (…) Une fois que je fais ma liste, si je dure longtemps, c’est une demi-heure. Quand je fais pas ma liste, je tourne et je tourne en rond dans le magasin. (…) À force d’écrire, j’écris peut-être à 2-3 reprises comme ça, maintenant, il y a des choses que j’écris même sans demander à Google. “Les œufs”, “la farine”… Si tu as fait trois fois les courses, tu retiens ! Et ça, il a fallu que je vienne à Lire et Écrire. Parce que tu peux demander à Google, il l’écrit, mais si tu sais pas lire, comment tu veux savoir si c’est le bon mot ? Il faut savoir lire pour pouvoir l’écrire sur ta feuille. Mais c’est grâce à la formation que je sais faire ça. Donc j’utilise beaucoup mon téléphone en-dehors de Lire et Écrire pour faire certaines choses. »
Des pratiques à légitimer sans les magnifier
Les quelques exemples de dialogue avec les textes dressés précédemment ne doivent pas nous leurrer et nous porter à croire que le numérique n’induit aucune difficulté dans son utilisation. Bien au contraire, l’écrit démobilise ou empêche la majorité des apprenant·es dans l’utilisation du numérique, et il en va de même pour la navigation depuis un moteur de recherche et la mauvaise ergonomie de nombreuses pages web. De la même manière, l’accès à un équipement et à une connexion internet peut être compliqué, notamment pour des raisons financières. La technique amène également son lot de complexité pouvant entraver son usage. Venant concentrer ces difficultés, les services d’intérêt général proposant de plus en plus leur offre via un accès en ligne provoquent de nouveaux types d’inégalités sociales.
Toutefois, comme on l’a vu avec les apprenant·es rencontré·es, les supports numériques peuvent aussi, par leurs modalités d’usages, constituer un outil supplémentaire, diversement dépliable, pour développer des pratiques de lecture et susciter ainsi un début d’appétence.
S’il convient d’être attentif à ne pas assimiler les apprenant·es concerné·es à des lecteur·rices chevronné·es et à de « grand·es lecteur·rices », autrement dit à ne pas célébrer à outrance les pratiques mises en avant, il apparait en parallèle nécessaire de les légitimer et ce au moins pour trois raisons majeures. D’une part, car la différence de forme entre une page web et une page papier peut être bien relative. Par exemple, « la complexité de la page web se retrouve également dans les manuels scolaires imprimés tels que les maisons d’édition les conçoivent aujourd’hui »18. Donc l’assimilation du texte n’est pas systématiquement inhérente à un type de format. D’autre part, les pratiques de lecture évoquées ici ont une valeur intrinsèque. Il importe à ce sujet de ne pas entrer dans un légitimisme excédé au regard de la lecture littéraire19. De fait, pour reprendre Katherine Hayles, « tant que cette croyance [d’une supériorité de la “lecture proprement littéraire”] exerce son emprise, la lecture numérique sera perçue au mieux comme périphérique par rapport à nos préoccupations principales, repoussée dans les marges comme n’étant pas “véritablement” de la lecture ou en tout cas pas de la lecture intéressante ou attirante »20.
En outre, et nous finirons là-dessus, les apprenant·es lisent parfois sans le verbaliser ou sans se rendre compte que ce qu’ils font, à travers des usages numériques, intègre de la lecture, pouvant d’ailleurs être « plus ou moins constante et profonde »21. Cette conscientisation s’avère pourtant cruciale en termes de valorisation de soi et de perception de sa propre compétence22. À ce sujet, Cécile Rabot fait part d’une « vertu symbolique par les possibles » à laquelle ouvre les fonctionnalités de dispositifs numériques : « il n’est pas impossible que le seul fait de pouvoir faire (et savoir qu’on peut) joue parfois autant que la pratique elle-même »23. Et savoir qu’on peut. Savoir qu’on peut, c’est se savoir capable et s’autoriser. S’autoriser et donner du crédit, in fine, à ses propres pratiques.
- Sébastien VAN NECK, Des adultes en alphabétisation au rendez-vous avec le numérique en formation. À la croisée des apprentissages utilitaires et des bénéfices sociaux, Lire et Écrire en Wallonie, 2022, https://lire-et-ecrire.be/Des-adultes-en-alphabetisation-au-rendez-vous-avec-le-numerique-en-formation.
- Pierre BOURDIEU (dir.), Un art moyen. Essai sur les usages sociaux de la photographie, Paris, Éditions de Minuit, 1965.
- Richard HOGGART, La culture du pauvre [The uses of literacy], Paris, Éditions de Minuit, 1970 [1957] ; Nous nous reporterons aussi plus récemment à Olivier MASCLET, L’invité permanent. La réception de la télévision dans les familles populaires, Paris, Armand Colin, 2018.
- Claude POLIAK, Gérard MAUGER et Bernard PUDAL, Histoires de lecteurs, Paris, Éditions du Croquant, 2010.
- Fabien Granjon définit l’informatique connectée comme « tout dispositif technique constitué, a minima, d’un système d’exploitation informatique et d’une connexion internet (smartphone, tablette, ordinateur, etc.) ». Voir : Fabien GRANJON, Classes populaires et usages de l’informatique connectée. Des inégalités sociales-numériques, Paris, Presses des Mines, 2022, p. 13.
- Dominique PASQUIER, Le numérique à l’épreuve des fractures sociales, in Informations sociales, n° 205, vol 1, 2022. DOI : https://doi.org/10.3917/inso.205.014.
- Précisons cependant que le niveau des groupes rencontrés est un niveau « écrit », c’est-à-dire situé entre intermédiaire et avancé en termes d’acquisition des savoirs de base.
- Il en va de même pour des pratiques d’écriture, mais cela constitue un sujet à part entière que nous n’aborderons pas dans cet article.
- Bernard LAHIRE, La raison des plus faibles. Rapport au travail, écritures domestiques et lectures en milieux populaires, Lille, Presses universitaires de Lille, 1993, p. 115.
- Ibidem, p. 109.
- Josiane JOUËT, Retour critique sur la sociologie des usages, in Réseaux. Communication – Technologie – Société, 100, 2000, p. 503. DOI : https://doi.org/10.3406/reso.2000.2235.
- Ibidem, p. 500.
- Gérard MAUGER, Le numérique : une révolution dans les pratiques de lecture ?, in Biens symboliques/ Symbolic Goods, n° 7, 2020, p. 6. DOI : https://doi.org/10.4000/bssg.480.
- Ibidem, p. 8.
- Cité par Mauger, ibidem.
- Ibidem.
- Bernard LAHIRE, Portraits sociologiques. Dispositions et variations individuelles, Paris, Armand Colin, 2002, pp. 32, 414.
- Cécile RABOT, Ce que le numérique fait à la lecture. Distinguer les supports, questionner les usages, in Biens symboliques/Symbolic Goods, 7, 2020, p. 13. DOI :
https://doi.org/10.4000/bssg.475. - Seul mode de lecture facilement perçu comme « lent et attentif à la langue ». Ibidem, p. 10.
- Citée par Cécile RABOT, ibidem, p. 10.
- Ibidem, p. 13.
- Pour une observation de la perception de compétence en alphabétisation, on peut se reporter à : Sébastien VAN NECK, Sur l’engagement et la persévérance d’apprenants issus de l’immigration. Un travail de cohérence entre la formation, soi et ses contextes sociaux, 2023, Lire et Écrire en Wallonie, En ligne https://lire-et-ecrire.be/Sur-l-engagement-et-la-perseverance-d-apprenants-issus-de-l-immigration-en.
- Cécile RABOT, ibidem, p. 18.